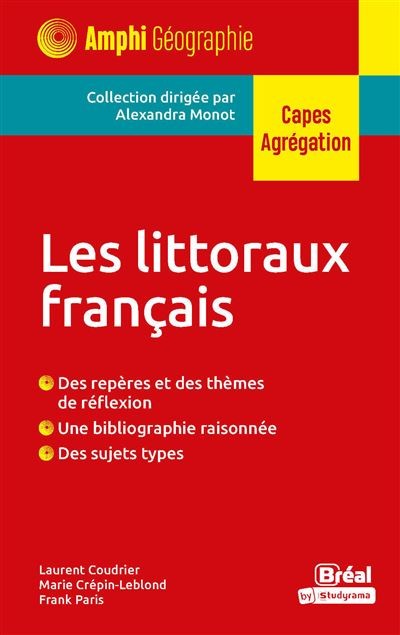Chiffres-clés : 5500 km de littoraux en France, 6,16 millions d’habitants résident dans les communes littorales, soit 9,5% de la population sur 4% du territoire.
Chapitre 1 : Les littoraux français, des milieux variés et fragiles
Il faut différencier :
- Le littoral qui est le trait de côte.
- Le milieu littoral qui s’étend à l’ensemble de l’espace influencé par les dynamiques marines et atmosphériques liées à la présence de la mer.
Les forces en action
Le système morphogénique littoral
Différents facteurs définissent et influencent le système littoral et les phénomènes d’érosion :
- Le climat : le vent qui transporte les sédiments et influence la houle et les vagues
- Le budget sédimentaire : il s’agit du rapport entre la quantité de sédiments qui existe en un lieu donné et la capacité qu’ont les agents marins (le vent, les vagues, le courant) à les déplacer. On le voit notamment dans les formes d’accumulation comme les plages : en hiver les plages maigrissent à cause de la houle mais elles engraissent en été. On dénombre trois principales sources de sédiments :
- Le bassin-versant : sédiments apportés par les fleuves
- Le trait de côte : l’attaque des falaises par la mer apporte des matériaux aux plages
- La mer elle-même : apport de sable.
- L’action anthropique :
- Accélère le changement climatique avec une plus grande intensité des phénomènes météorologiques
- Modifie le bilan sédimentaire par des constructions. Par exemple, les barrages ou les enrochements limitent l’apport en sédiment et favorise l’amaigrissement des plages.
- L’utilisation de matériaux de constructions (sable, galets) aggrave le déficit sédimentaire.
- Pollution des écosystèmes marins. Par exemple, les herbiers à posidonie en Méditerranée sont en recul à cause de la pollution, alors qu’ils permettent de diminuer l’action de la houle sur les plages, entrainant un démaigrissement des plages.
- L’urbanisation et les ports perturbe le transit des sédiments.
Exemple : une dune bordière est sensée être érodée lors des tempêtes et restaurée lors des périodes de beau temps. Or si l’on installe un mur de protection, les échanges de matériaux entre la dune et la plage vont être bloqués, entraînant un démaigrissement de la plage, qui finit par disparaître.
Les actions liées aux vagues
Les vagues et la houle subissent des déformations une fois arrivés à la côte, liées au relèvement du fond ou à la rencontre d’obstacles.
Le déferlement des vagues a des effets érosifs sur le trait de côte, notamment sur les plages et les falaises.
L’action de mitraillage est lorsque la mer, qui dispose de galets, mitraille les roches du littoral.
La dérive littorale : un courant de dérive, parallèle à la côte. C’est le cas notamment sur les côte des Landes et des Charentes. La dérive littorale transporte des sédiments (sable, graviers, galets).
Les courants de marée : apparaissent lorsque les hautes et basses de deux lieux voisins n’interviennent pas en même temps, provoquant des différences des niveaux de la mer. Exemple du Raz Blanchard au large du Cotentin.
Les variations du niveau de la mer
Sur le temps long, les variations du niveau de la mer sont liées aux grandes glaciations. On peut retenir :
- La glaciation du Würm (niveau sensiblement plus bas, régression marine)
- La transgression flandrienne : fonte des grands glaciers, ayant amené les mers à leur niveau actuel
L’accumulation de sédiments augmente pendant une régression marine alors qu’une transgression marine est marquée par une érosion plus intense.
Les principaux types de formes littorales
Les côtes à falaise
L’action des vagues entraine un recul généralisé de l’escarpement qui laisse devant lui un platier rocheux. On trouve au pied des falaises des éboulis qui protègent le pied de la falaise mais participent au mitraillage lors des tempêtes.
L’érosion diffère selon le type de roche (faible pour le granit, important pour le calcaire). Par exemple, certaines falaises du pays de Caux reculent de manière importante (30m par siècle), mais pas les falaises d’Etretat.
Les plages et les dunes : des côtes d’accumulation
a) Les plages
Ce sont des côtes d’accumulation avec une partie émergée et une partie immergée. Il existe différents types de plages comme :
- Les plages de fond de baie en arc de cercle
- Les flèches littorales : accumulations sableuses allongées dans le sens de la houle et qui tendent à barrer l’entrée d’une baie. Les cordons littoraux sont une forme de flèche littorale qui isolent parfois une étendue d’eau, la lagune.
La dérive littorale peut contribuer à éroder les plages qui subissent de fait un démaigrissement lorsque l’apport des fleuves et rivières n’est pas suffisant.
b) Les dunes littorales
Elles s’expliquent par la présence de grands vents venant du large. On trouve généralement une dune bordière de quelques mètres de haut avec une végétation capable de résister à l’enfouissement. Plus dans les terres, on peut trouver des dunes intérieures fixées par des Pins.
Il existe naturellement un équilibre entre dunes et plages en termes d’échanges de sédiments. Mais si l’homme fixe la dune par la végétation ou par des constructions (routes, maisons), l’érosion s’aggrave. Ainsi la dune ne peut plus reculer alors que la plage est attaquée par les vagues et les vents. Si l’on construit un enrochement pour protéger la dune, la plage tend à disparaître car elle attaquée par la mer et ne reçoit plus les matériaux de la dune.
Les marais maritimes
Ce sont des étendues basses, formées d’alluvions récentes, situées à proximité des mers à marée.
Wadden ou slikke : des étendues à faible pente, dépourvues de végétation et périodiquement submergées à marée haute (exemple dans la baie du Mont-Saint-Michel)
Le schorre : situé à quelques dizaines de centimètre plus haut que la slikke et occupée par une végétation halophyte. Ce sont d’excellents pâturages pour les ovins.
Les polders : lorsqu’on endigue le schorre. A noter que les polders, même protégés, peuvent être inondées lors de grandes tempêtes, comme par exemple en Picardie.
Rias, estuaires et deltas
Côtes à rias : vallées fluviales envahies par la mer en partie ou en totalité, présentes sur les côtes bretonnes. On trouve souvent des slikkes et des schorres sur les bordures. L’eau est salée à l’embouchure.
Estuaires : ils ont des dimensions plus considérables que les rias et se caractérisent par la présence d’eaux douces et salées mélangées (estuaire de la Loire et de la Seine par exemple). On retrouve également des paysages de slikke et de schorre sur les bordures.
Deltas : se caractérisent par l’avancée en mer des dépôts apportés par les fleuves, dépôts qui s’accumulent sur place au lieu d’être redistribués par la mer (delta du Rhône)
Littoraux intertropicaux ultramarins
Mangrove : végétation arborée qui pousse dans la zone de battement des marées dans les zones d’abris (exemples en Guyane ou en Polynésie française). Elles présentent une forte biodiversité mais sont des écosystèmes fragiles : tempêtes, cyclones, action de l’homme (bois de palétuviers très apprécié).
Atolls : ce sont des récifs annulaires de corail entourant un lagon peu profond surplombant un édifice volcanique devenu sous-marin. Ils sont à la base d’écosystèmes très riches mais fragiles, sensibles à la hausse des températures de l’eau ou des pollutions littorales.
La France détient la quatrième plus grande surface de récifs coralliens au monde, 20% des atolls. La barrière récifale en Nouvelle-Calédonie est la seconde plus grande du monde.
Des milieux littoraux fragiles et protégés
8 communes sur 10 soumises à un risque naturel majeur en France.
Les risques lithosphériques liés à la tectonique des plaques :
- Volcans explosifs et séismes dans les Antilles. Exemple de la Montagne Pelée en Martinique.
- Risque de séisme également présent en Méditerranée. La présence de métropoles comme Toulon ou Marseille rend ce territoire vulnérable.
- Des points chauds dans certains territoires ultramarins : cas du volcan du Piton de la Fournaise à La Réunion.
- Risque de tsunamis en Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna
- Les autres littoraux français sont moins concernés, même si ces cas surviennent : exemple d’un séisme de magnitude 5,7 en Charente-Maritime en 2023.
Les risques atmosphériques liés aux vents
- Les cyclones de la zone intertropicale (Antilles, Mayotte etc…). Exemple du cyclone Irma en 2017 à Saint-Martin : 90% des constructions touchées, effondrement du tourisme.
- Tempêtes en métropole : exemple de la tempête Lothar en 1999 ou Xynthia en 2010 (53 morts). Le risque est majeur lorsque qu’une forte tempête se cumule à une très grande marée : rupture de digues, submersion marine etc…
- En méditerranée : les épisodes cévenols caractérisés par l’accumulation de masses nuageuses chaudes et humides sur plusieurs jours, entrainant une rapide concentration des écoulements des cours d’eau et des innodations.
- Le changement climatique : multiplie les aléas climatiques extrêmes, entraîne une élévation du niveau de la mer et remet en cause l’habitabilité de certains secteurs. Exemple à Saint-Pierre et Miquelon : le village de Miquelon est en cours de déménagement.
Les risques liés aux dynamiques marine :
o Selon le CEREMA (centre d’étude et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement), ¼ des côtes françaises subit des phénomènes d’érosion et 20% du trait de côte est en recul.
o Les côtes basses sableuses sont les plus touchées
o La Bretagne est la plus exposée au recul du trait de côte (1/3 des communes exposées), mais aussi la Charente-Maritime, la Gironde et la Camargue.
o L’érosion littorale est aggravée par le changement climatique. Selon le rapport du GIEC 2023, si les températures augmentent de 4°C d’ici 2021, la montée des eaux serait de 93cm.
o Risque de submersion marine par franchissement, débordement au-dessous d’ouvrages de protection ou par rupture d’un ouvrage.
Les menaces anthropiques
- La littoralisation de la population française et l’urbanisation favorise l’érosion et la vulnérabilité aux aléas, ainsi que des déséquilibres pour l’environnement.
- La construction d’ouvrages interrompt les échanges sédimentaires et amplifie l’érosion
- Sur 5500 km de côtes en métropole, 2840 km sont artificialisés ou aménagés.
- Pollution : polluants chimiques, déchets terrestres, rejets des navires
- Activités en mer et sur le littoral : pêche professionnelle, extractions de granulats etc…
Conséquences des actions humaines : risques d’inondations amplifiés, érosion du trait de côte, perte de biodiversité, pollutions.
Exemple des algues vertes en Bretagne : l’agriculture intensive et l’élevage utilisent des engrais conduisant à la pollution des cours d’eau côtiers et des nappes phréatiques par les nitrates et les phosphates. Les nutriments favorisent en mer la prolifération d’algues vertes lorsque l’eau en surface se réchauffe et qui libèrent des gaz toxiques.
Outre les conséquences sanitaires, cela entraîne des conséquences économiques pour la pêche et le tourisme.
On peut lister 5 principales politiques visant à adapter le littoral au recul du trait de côte et aux risques :
Le repli des constructions vers l’intérieur des terres. La loi Littoral encadre les possibilités d’urbanisation dans une bande côtière de 15km de large.
- La renaturation des espaces littoraux : exemple de la dépoldérisation des marais maritimes pour reconstituer les schorres.
- Maîtriser l’urbanisation des zones vulnérables par des plans de prévention des risques littoraux (PPRL) ou des plans de submersion rapide (PSR). Ces plans limitent voire interdisent les nouvelles constructions.
- Les techniques douces de recharge des plages : apporter du sable ou drainer la plage afin de limiter son érosion
- Les ouvrages de protection :
- Epis : ouvrages disposés perpendiculairement au rivage pour freiner et dévier la dérive littorale qui est alors contrainte de déposer sa charge sédimentaire. Mais cela aggrave l’érosion du secteur à l’aval.
- Murs de protection parallèles à la côte mais qui perturbent les échanges de sable entre la dune et l’estran
- Digues côtières contre la submersion marine.
Enrochements pour maintenir la dune bordière et protéger les terres de la submersion, mais limite le transit du sable entre la plage et la dune, favorisant l’érosion de la plage. - Brise-lames parallèle à la côte mais en mer afin de casser les vagues.
=> Ces ouvrages ont un effet protecteur localement mais peuvent générer des phénomènes d’érosion ou d’accumulation.
=> Ils coûtent cher et détériorent le paysage.
Les principales politiques pour protéger les espaces naturels
- Années 1970 : prise de conscience que le littoral est largement approprié par des particuliers, de l’urbanisation parfois inesthétique, de la pollution.
- Le rapport Piquart en 1973 est le point de part d’une réflexion politique sur la protection et propose une politique d’aménagement des littoraux.
- Les réserves naturelles : protection renforcée de terrains de petite dimension à forte spécificité écologique. Exemple du parc des Glorieuses dans les Terres australes et antarctiques françaises
- Les parcs nationaux autour de trois missions : assurer la protection des espaces naturels ; accueillir le public et l’informer ; promouvoir le développement durable économique et social. Exemple du parc des Calanques de Marseille.
- Les parcs naturels marins autour de trois objectifs : connaissance du milieu marin ; protection ; développement durable des activités. Permet d’arbitrer les conflits d’usages locaux.
- Les parcs naturels régionaux : protéger le patrimoine d’une territoire tout en assurant son développement économique et social ainsi qu’une mission d’accueil, d’information et de recherche. Exemples : PNR Marais du Cotentin, PNR Armorique en Bretagne.
- Le Conservatoire du littoral : il intervient sur des espaces naturels, sensibles et sauvages selon une logique de sanctuaire, de conservation et de patrimonialisation. Cela se fait via une politique d’acquisition des espaces : 1450km de rivages (13% des côtes), 750 sites naturels.
- La gestion intégrée des zones côtières (GIZC) : favoriser un développement économique et social durable tout en sauvegardant les équilibres biologiques et écologiques ainsi que les paysages. Il existe une stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte (SNGITC)
- La loi littoral de 1986 :
- Concilier les fonctions résidentielles, productives et périproductives avec la protection d’un patrimoine naturel fragile et menacé.
- Limiter l’extension de l’urbanisation sur la bordure littorale
- Interdiction de nouvelles implantations qui ne nécessitent pas la proximité immédiate de la mer sur la bande de 100m.
- Le Grenelle de la mer en 2009 : débouche sur le développement d’aires marines protégées.
Les limites de ces politiques
- Elles n’ont pas permis d’arrêter l’artificialisation des espaces (côte méditerranéenne)
- Induisent un report des constructions vers l’arrière-pays ou les espaces non-protégés à proximité
- Phénomène de cabanisation : implantation de façon permanente sans autorisation dans des constructions destinées à être occupées épisodiquement.
Cas de la loi littorale : les restrictions ne s’appliquent qu’en dehors des zones urbaines. La loi a donc encouragé la densification des zones urbaines existante plutôt que l’étalement urbain. La loi ne vise donc pas à réduire la densification des zones urbaines mais empêcher l’urbanisation non maîtrisée. De plus, certaines notions comme « bande littorale » restent floues, laissant les décideurs locaux la possibilité d’adapter la loi au territoire.
Chapitre 2 : Populations et espaces littoraux en France
Expliquer et caractériser l’attractivité résidentielle des littoraux
On parle de prime démographique des littoraux français du fait de leur capacité à attirer des résidents.
Mais on note des disparités fortes entre littoraux :
- Le littoral méditerranéen : les plus fortes concentrations démographiques, jusqu’à parler de saturation de bord de mer, voire d’azurisation (référence à la baléarisation espagnole). A noter par contre que les littoraux de Corse sont parmi les moins peuplés. 48% de la population littorale réside sur la côte méditerranéenne.
- Le littoral atlantique : moins dense et moins saturé mais la population y augmente plus rapidement (rattrapage démographique). Exemple de Biarritz-Anglet-Bayonne.
- Le littoral de la Manche et de la mer du Nord : croissance inférieure à la moyenne nationale, voire une perte d’habitants dans certains espaces (Le Havre, Dieppe).
- Un net contraste nord-sud : population qui stagne ou diminue du nord jusqu’au Finistère / population qui augmente dans l’Arc Atlantique et en Méditerranée.
- Le cas des DROM et COM : population qui a doublé depuis 1962 dans les DROM.
La progression de la population littorale est nettement plus forte qu’en métropole dans les COM (collectivités d’outre-mer)
Une densification littorale et rétrolittorale
La densité augmente au fur et à mesure que l’on s’approche du littoral (haliotropisme). On parle d’effet rivage renforcé par l’héliotropisme dans le Sud.
Le ruban littoral évolue dans son épaisseur : les arrière-pays ou rétrolittoraux (communes non littorales des cantons littoraux) affichent une croissance démographique plus forte.
Les facteurs explicatifs de la dynamique d’étalement :
- Coût élevé de l’immobilier en bord de mer
- Saturation urbaine
- Politiques de protection des espaces naturels
L’étalement est particulièrement marqué en Manche-mer du Nord, dans les Alpes-Maritimes, les Côtes-d’Armor et le Finistère.
Des exceptions : Corse, Landes, Pyrénées-Atlantiques (croissance plus forte sur le littoral).
Caractéristiques des nouveaux résidents :
- 70% proviennent des métropoles, phénomène accentué suite à la pandémie
- Une population plus âgée que la moyenne métropolitaine :
- Des revenus médians plus élevés pouvant induire des fragmentations sociales littorales. Exemple des communes de Berck-sur-Mer et du Touquet-Paris-Plage : Le Touquet attire des populations aisées, son taux de pauvreté est nettement inférieur.
- Un fort taux de résidences secondaires. 1/3 des logements sont des résidences secondaires dans les communes littorales du Pays de la Loire ou de Corse, jusqu’à 50% dans l’île de Ré ou le bassin d’Arcachon. Cela s’explique par le vieillissement de la population ou encore le télétravail.
=>Les résidences secondaires contribuent à la vitalité des territoires (tourisme, activité économique) mais la saisonnalité pose problème et les résidents sont perçus comme une contrainte pesant sur la demande de logements
Les formes de concentration : littoralisation, urbanisation, métropolisation
Un système littoralisation-urbanisation
Le niveau d’artificialisation des communes littorales est de 14,6%.
A la pression démographique d’ajoute une pression urbaine : ¾ de la population littorale vit en zone urbaine (90% en Méditerranée). Dans les années 1970, la pression urbaine se fait sentir et face à la pénurie d’espaces disponibles, les terres agricoles tendent à disparaître (cas de la côte d’Azur) au fur et à mesure que le front urbain avance.
Gérard-François Dumont : concept de « litturbanisation », une urbanisation spécifique aux littoraux :
- Multiplication des infrastructures littorales (ports, industrie, tourisme, loisirs)
- Urbanisation spécifique des littoraux : exemple de la transformation des friches portuaires en quartiers patrimonialisés
Cas particulier de la Bretagne : un essoufflement voire une inversion de croissance sur certains littoraux, dus à plusieurs facteurs :
- Loi Littoral
- Prix du foncier et de l’immobilier qui empêcher les familles et jeunes de s’installer
- Un solde naturel plus réduit dû au vieillissement très marqué de la population littorale.
Une métropolisation spécifique des villes littorales
Métropole : plus de 200 000 habitants et concentration de fonctions structurantes productives, supérieurs (direction, décision, connaissance).
Plusieurs métropoles littorales : Nantes, Bordeaux, Montpellier, Marseille et Nice avec une attractivité régionale forte.
L’influence de la mer dans la métropolisation de ces villes :
- L’importance des structures de communication sont directement liées aux fonctions commerciales et touristiques littorales. Exemple de Nice avec son port international estival (Port Lympia) et son aéroport international.
- Des structures de commandement économique liées aux fonctions portuaires. Exemple de Bordeaux où plusieurs fonctions métropolitaines sont liées à sa fonction portuaire : négoce et import-export autour du vin, industrie pétrochimique etc…
- Des fonctions culturelles liées à la mer. Exemple de Marseille avec le Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM) dans une volonté de faire de Marseille un symbole de plaque tournante de la culture méditerranéenne.
Exemple de Nantes : la ville a perdu son moteur autour de la construction navale et a initié une reconversion économique et urbanistique :
- Reconversion des anciennes fonctions navales, portuaires et industrielles : l’usine LU qui devient le « Lieu Unique » consacré aux manifestations culturelles
- Les hangars du quai des Antilles transformés en restaurants et bars
- Réaménagement piétonnier des quais
- Lancement d’un technopôle et un pôle de compétitivité (Atlanpole) : affirmer les fonctions métropolitaines autour de l’économie de la connaissance et l’innovation
Essai de typologie des villes littorales
2 critères clés : les fonctions dominantes et la notion de maritimité.
a) Premier type : les villes de tradition maritime qui exploitent les ressources de la mer
- Villes de la pêche. Exemple de Boulogne-sur-Mer, centre majeur de l’industrie de la pêche
- Villes de la conchyliculture : exemple d’Arcachon
- Ville de la saliculture : exemple de Noirmoutier et l’île de Ré, même si cette fonction est devenue davantage touristique
b) Deuxième type : les villes et stations balnéaires
- Les stations bourgeoises de la côte normande, proches de Paris et desservies par le train (Deauville, Cabourg, Honfleur etc…) et qui sont des réaménagements complets de petits villages de pêcheurs. Elles s’organisent autour du front de mer, du casino et de la gare et comprennent des palaces et une grande place bordée de commerce.
- Les stations familiales de Bretagne, Vendée et Charente-Maritime : sur le modèle des stations bourgeoises mais à destination d’une fréquentation familiale. Les palaces disparaissent au profit de maisons individuelles. Exemple des Sables-d’Olonne.
- Les stations répondant à une politique d’aménagement touristique par l’Etat :
- Par la transformation de stations existantes avec la construction de nouveaux quartiers en périphérie, d’immeubles de front de mer et de maisons à l’intérieur des terres. On note également une modification du trait de côte en utilisant des terrains gagnés sur la mer par endiguement, opérations interdites depuis 1973.
- Par la création de stations balnéaires intégrées ex nihilo à grande capacité d’accueil dans des littoraux à l’écart du développement touristique (Aquitaine, Corse, Outre-mer…). L’aménagement ne concerne plus seulement la station mais la région touristique entière avec des infrastructures (autoroutes, aéroports).
Exemple de la côte du Languedoc : 7 stations nouvelles, 14 ports de plaisance. Cas de la Grande-Motte ou du Cap d’Agde.
c) Troisième type : les villes portuaires
- Les ports maritimes majeurs générant un grand nombre d’emplois directs et indirects : Dunkerque, Le Havre, Saint-Nazaire…
- Les ports de commerce reliant arrière-pays et marchés régionaux ou mondiaux : Rouen, Bordeaux…
- Les ports de passagers comme Calais, Marseille ou Toulon
- Les ports militaires : Toulon, Brest, Lorient, Cherbourg.
Exemple de Dunkerque : le port est stratégiquement placé le long de la route maritime la plus fréquentée au monde. Dunkerque reste aujourd’hui le grand port de la sidérurgie. Ses dynamiques sont directement liées à son hinterland nordiste. Mais l’étalement portuaire a induit une fragmentation fonctionnelle forte de l’espace. Le projet Neptune lancé en 1989 vise à réconcilier la ville et le port en réinvestissant les friches portuaires par de nouvelles fonctions, notamment universitaires.
Les facteurs d’occupation des littoraux
3 facteurs endogènes liés aux effets de site
- La topographie côtière :
- Le profil longitudinal : les hommes ont plutôt recherché des concavités (baies, estuaires, criques etc…) qui constituent des sites d’abri et des ports naturels.
- Le profil transversal : le relief côtier empêche ou limite les flux avec l’avant et l’arrière-pays. D’où une recherche privilégiée d’une plaine littorale permettant le développement de l’agriculture et de la pêche. Mais le relief côtier peut aussi faciliter la surveillance.
- Le degré d’ouverture du rivage comme par exemple la présence d’un estran favorable à l’implantation initiale.
- Les inégales potentialités biologiques, agronomiques, minérales et esthétiques : la question des ressources littorales et maritimes et du littoral comme ressource :
- Le potentiel biologique : la pêche, l’exploitation des champs d’algues, l’aquaculture. Exemple de l’exploitation des laminaires (algues) autour de Roscoff en Bretagne.
- Les aptitudes agricoles : cas du delta du Rhône ou des espaces poldérisés de la baie du Mont-Saint-Michel. Mais la mise en valeur de ces espaces nécessite des adaptations : endiguement, assèchement etc…
- Les matières premières minérales : cas de l’exploitation des sables et des graviers des estuaires.
- Le capital esthétique littoral : on note un « retournement imaginaire » (Alain Corbin) des littoraux, perçu en premier lieu comme des espaces hostiles, et devenus des espaces attractifs.
Les facteurs exogènes liés aux effets de situation
- Facteurs relevant de l’avant-pays marin (foreland) :
- Les littoraux insulaires peuvent présenter une situation d’isolement, mais qui peut devenir une aménité touristique, notamment pour les îles proches du continent (exemple de Noirmoutier)
- La proximité des routes maritimes (exemples du Havre et Dunkerque mais qui perdent leur centralité au détriment des ports d’Anvers, Rotterdam et Hambourg)
- La proximité des ressources vivantes et énergétiques offshore
- Facteurs relevant de l’arrière-pays (hinterland) :
- Le degré d’isolement par rapport aux centres économiques et aux métropoles intérieures. Exemple : volonté des élus de mieux connecter certaines stations de la côte de Jade à Nantes par le train.
- Les aménagements de l’arrière-pays : poldérisation, protections des inondations, aménagement portuaires, industriels et touristiques jouent sur l’occupation.
Les littoraux, espaces convoités objets de tensions
La convoitise transparaît dans les termes utilisés : surconcentration, surartificialisation, surfréquentation, surtourisme…
Exemple du surtourisme : en 2023, le gouvernement a défini un plan pour réguler les flux touristiques. Exemple de l’île de Bréhat où le seuil de fréquentation quotidien est fixé par arrêté municipal en juillet et août.
Les pressions ont des conséquences environnementales
- L’artificialisation des terres littorales progresse au détriment des terres agricoles et des milieux naturels
- Destruction ou dégradation des habitats fragiles et riches en biodiversité. Exemple : les vasière et marais maritimes ont régressé en France suite à la construction de polders.
Plusieurs facteurs : déchets, émissions polluantes, urbanisation diffuse qui morcelle le paysage et les espaces de vie de certaines espèces, l’érosion et submersion marine (voir chapitre 1)
Les conséquences de la pression urbaine
- Les espaces restants ouverts à l’urbanisation sont plus rares et plus chers (coût de l’immobilier)
- Les populations aisées s’approprient le littoral
- Les résidences secondaires : près de 70% dans le pays de Saint-Malo
- Cela entraîne une migration de 20 à 30km de certaines populations vers l’intérieur des terres pour continuer de concilier travail et habitat, exemple du Morbihan.
- Des réactions violentes : exemple de tags sur les résidences secondaires en Bretagne par le collectif indépendantiste « Dispac’h ».
- Risque d’avoir des villes mortes en basse saison.
Chapitre 3 : Une économie littorale française entre traditions et innovations
Chiffres
– Les activités littorales : 1,5% du PIB français (seulement)
– 3,5% du volume pêché en Europe
– 56% du chiffre d’affaires provient du tourisme
– 13 % : services parapétroliers et para-gaziers offshore
– 8% : secteur public non marchand
– 7% transport maritime et fluvial
– 7% : construction et réparation de navires
– 6% : produits de la mer
Les ressources nourricières de la mer
Les différents types de pêche
- Pêche à pied
- Pêche côtière
- Pêche au large ou hauturière : 3 à 10 jours au large
- Grande pêche : plus de 20 jours dans un secteur océanique différent du port d’attache
- Pêche artisanale : méthodes traditionnelles (filets, casiers), entreprises familiales.
- Pêche industrielle : bateaux de plus de 40m, grands groupes agroalimentaires.
La grande pêche et la pêche hauturière
Quelques ports sont spécialisés dans l’accueil des bateaux de plus de 40m :
- Boulogne-sur-Mer : port le mieux équipé avec des industries de transformation des produits de la mer et qui bénéficie de sa proximité avec les centres de consommation, le Bassin parisien et les zones de pêche
- C’est le premier port européen en produits de la mer transformés. Exemple de l’usine Findus
- La ville tente de se diversifier avec comme exemples l’ouverture de Nausicaa ou la création d’un pôle de compétitivité (Aquimer).
- Lorient : premier port en termes de chiffre d’affaire. Il accueille notamment le salon professionnel de la filière halieutique, Itechmer.
- Le Guilvinec : majoritairement de la pêche hauturière et côtière
- Les Sables d’Olonne : port très polyvalent pour la pêche.
La pêche artisanale, cœur de l’activité de pêche en France mais en difficulté
Cela concerne notamment les ports du littoral atlantique et de la Manche. L’activité de pêche se combine très souvent avec la présence de conserveries.
Mais en 30 ans, la flotte a perdu 53% de ses navires avec un fort recul de l’emploi.
La Bretagne : 53% des volumes pêchés, comme le thon (espèce la plus vendue), la coquille Saint-Jacques ou le maquereau.
Les difficultés
- La Politique commune de la pêche (européenne) a créé des mesures drastiques de gestion des zones de pêche, de respect des saisons de pêche ou encore la taille des filets. Mais dans un but de durabilité.
- Surpêche
- Pollution : macrodéchets plastiques, espèces invasives (cas du barracuda en Méditerranée)
La transformation des produits de la pêche
- Produits salés, fumés, séchés, en saumure : 31%
- Produits préparés ou conservés : 29% du chiffre d’affaires
- Produits frais, congelés, entiers : 22%
- Plats cuisinés : 17%
En mer, les navires de grande taille peuvent être équipés pour la transformation directe.
Sur terre, une industrie agroalimentaire s’installe au plus près des ports de pêche.
Exemple des conserveries de Quiberon : 2 des 15 principaux sites de conserveries sont situés à Quiberon, dont la Belle-Iloise qui comprend 90 boutiques en France.
L’essor des ressources énergétiques marines en France
On parle d’énergies marines : énergie hydrolienne, énergie houlomotrice, énergie thermique et énergie marémotrice. Le potentiel français est encore peu exploité.
- L’usine marémotrice : fonctionne par flux et reflux de la marée. La France est pionnière dans ce domaine : exemple du barrage de la Rance entre Saint-Malo et Dinard. Mais les coûts sont élevés avec des difficultés techniques (ensablement des équipements).
- Les éoliennes en mer : exemple du parc éolien offshore au large de Saint-Nazaire. Mais la France est en retard par rapport à l’Europe du Nord, malgré une volonté de rattrapage avec 16 projets de parc éolien prévus d’ici 2031. Mais des difficultés rencontrées :
- Bouleverse la faune avicole, marine et sous-marine
- Détruit des frayères et des habitats pour les espèces
- Modifie les paysage (problème d’acceptation par les riverains). Exemple en Manche de l’association SOS pour (Sans offshore).
- Coût élevé
- L’énergie hydrolienne : liée aux courants marins dont la force est captée par des turbines fixées au fond des mers. Exemple des essais d’EDF dans la baie de Paimpol. La France possède parmi les courants les plus forts du monde (cas au large de l’île d’Ouessant) donc un fort potentiel.
- Des centrales nucléaires sur certains littoraux (besoin d’eau pour leur refroidissement). Exemple de Flamanville dans le Cotentin.
L’utilisation ancienne et diversifiée des estrans
La saliculture et les marais salants
Exemples des marais salants de Guérande, de l’île de Noirmoutier ou les salines méditerranéennes de Camargue.
La saliculture nécessite 4 éléments concomitants : la mer, le vent, le soleil et un espace littoral plat et argileux.
Les marais salants présentent également un intérêt patrimonial et donc touristique : exemple de l’île de Noirmoutier avec l’installation de pistes cyclables et de chemins de promenade dans les marais ainsi que la Maison du sel.
a) Les difficultés rencontrées
- la cohabitation des usages (saliculture, tourisme, chasse)
- le prix du foncier, notamment pour les salariés ayant du mal à se loger à proximité
- les contraintes de construction des bâtiments d’exploitation ou de stockage sur le littoral
- la concurrence française et internationale : certains marais salants privilégient la qualité avec de nombreuses labellisations (exemple du sel de Guérande, indication géographique protégée IGP)
b) 2 types de productions
- Côte Atlantique : saliculture artisanale, souvent labellisée et misant sur la qualité, regroupée en coopératives ou entreprises familiale.
- En Camargue : des firmes transnationales (cas des Salins du Midi), exploitation de manière industrielle, intensive et en grande quantité.
L’aquaculture marine
- La conchyliculture (coquillages, crevettes et crustacés): la principale zone d’activité se situe en Charente-Maritime (1/4 des entreprises, 1/3 des employés). Il s’agit du premier secteur d’aquaculture en France avec 91% de son chiffre d’affaires.
- La mytiliculture (culture des moules) : exemple de la moule de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel AOP.
- L’ostréiculture (huitres) : la production conchylicole est majoritairement orientée vers la production d’huitres. La France représente 95% de la production européenne. Les huitres sont élevées dans des parcs à huitre placés sur l’estran. 2 types : les huitres plates (baies de Bretagne et Méditerranée et huitres creuses (Oléron, bassin d’Arcachon)
- Les autres coquillages (coques, palourdes, coquille Saint-Jacques) sont produits dans des quantités très inférieures
La pisciculture marine
a) La France est un pays pionnier (techniques de reproduction et d’alimentation)
Exemples d’espèces : bar, daurade, maigre…
- L’algoculture : elle se développe notamment en Bretagne, mais production assez faible.
- Cas de l’aquaculture en Outre-mer : globalement peu développée à cause de la rareté des sites ou encore des contaminations des sols dans certains territoires (chlordécone en Guadeloupe).
- La crevetticulture : notamment en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française
- La perliculture : il s’agit de la deuxième ressource propre du territoire polynésien après le tourisme
b) Les difficultés de l’aquaculture
- La technique du captage de naissains dans le milieu naturel : variabilité des taux de fixation, mortalité élevée des naissains quand les températures sont plus élevées que la moyenne (jusqu’à 85% pour les huîtres).
- Contamination des eaux par des virus et bactéries issus de l’activité humaine : les coquillages fixent les bactéries, pesticides, résidus de médicaments, microplastiques etc…
Exemple des coquillages du bassin d’Arcachon : des interdictions temporaires de vente.
- Des conflits pour l’accès à l’espace avec les activités touristiques
- Rejets en mer de l’agriculture, des bateaux de plaisance, des industries et du tourisme
Exemple de conséquences : certains parcs à huitre se déplacent en eaux profondes comme à Quiberon.
Une agriculture littorale valorisée mais en recul
Les activités traditionnelles se concentrent sur l’agriculture et l’élevage extensif (chevaux de Normandie, taureaux en Camargue, moutons en baie du Mont-Saint-Michel…) ou intensif (porcs en Bretagne). Dans une moindre mesure les culture maraichères (Bretagne) et la viticulture.
Il s’agit majoritairement de structures de petites tailles avec une diversification des productions et un recours aux circuits courts pour la vente (vente directe, AMAP, marchés grâce à la présence de consommateurs notamment en période estivale).
L’agriculture est facteur d’artificialisation des sols, souvent dans le cadre d’une poldérisation.
Certaines productions, souvent labellisées, tirent parti des microclimats littoraux et des spécificités pédologiques. Exemple de l’oignon de Roscoff AOP.
Constats
- L’activité agricole dans les communes littorales décline, à travers la chute de la surface agricole utile (SAU). En 2019, l’agriculture n’occupe plus que 35% de surfaces des communes littorales.
- Le littoral perd peu à peu sa vocation agricole qui cède sa place aux usages balnéaires et résidentiels. La SAU diminue fortement sur le littoral du Nord-Pas-de-Calais, de Bretagne, des Pays de la Loire et de Poitou-Charentes, encore plus en PACA et Languedoc-Roussillon
Explications
- Le morcellement du foncier et les prix de la terre
- Construction de logements
- Les effets du changement climatique (submersion des polders agricoles, salinisation des terres agricoles littorales, baisse de la pluviosité…)
- Nuisances liées aux fortes densités humaines et à la fréquentation touristique : dégradations (incendies, décharge sauvage), conflits de voisinage, difficulté de déplacement des engins agricoles sur les routes etc…
- Concurrence à l’échelle française, européenne et mondiale : repli économique voire crise de certaines filières (cas de la pêche ou de la saliculture).
- Mauvaise image à cause des pollutions générées et les conséquences sur la biodiversité
Une place marginale des littoraux français dans la maritimisation de l’économie mondiale ?
Des ports français déclassés dans les rangs mondiaux et européens
Principaux ports :
- Marseille-Fos
- Le Havre
- Dunkerque
- Nantes-Saint-Nazaire
- Rouen
- La Rochelle
- Bordeaux
Ces 7 ports assurent 80% du trafic de marchandises
Dans les DROM : Guadeloupe port Caraïbe et Port-Réunion
Le Havre : 10e rang européen (trafic total et de conteneur). Le port maintient cette place grâce au regroupement en 2012 des ports du Havre, de Rouen et de Paris dans un complexe unique : HAROPA Port.
- Faiblesse des performances des infrastructures en termes de rapidité des temps de chargement
- Tendance à la stagnation voire la régression des trafics (crise de 2008-2009)
- Perte de compétitivité : 68e place mondiale pour le Havre en 2021 dans le trafic de conteneurs contre 41e en 2010.
Mais des réussites : cas de CMA-CGM, fleuron entrepreneurial maritime français implanté à Marseille. Présent dans 160 pays, 3e rang mondial du transport maritime de conteneurs.
Les facteurs de difficulté
- La gouvernance des ports menée davantage de manière administrative que commerciale (limite la compétitivité)
- La taille des ports : insuffisante en termes de tirant d’eau, de dessertes, de services, d’entreprises présentes pour attirer les grands armateurs mondiaux.
- La concurrence : Marseille est concurrencée par les ports de Gioia Tauro en Calabre et Algésiras.
- L’intermodalité : l’extension par à-coups des ports a entraîné une mauvaise liaison entre les différentes zones d’un même port
- La connexion avec les arrière-pays
- 30 trains partent du Havre par jour contre 100 à Hambourg.
- Un conteneur à destination de Lyon arrive plus vite de Rotterdam que du Havre.
- La moitié des porte-conteneurs à destination de la France ne transitent pas par un port français (la majorité passe par Anvers).
Des investissements lourds pour amarrer les ports à la mondialisation
Objectif de se moderniser pour s’adapter aux évolutions du transport maritime mondial (spécialisation, gigantisme des navires, offre logistique)
- Dans les années 1960 : politique volontariste pour transformer les ports en zones industrialo-portuaires, les ZIP, avec 3 objectifs :
- Politique : volonté de planification de l’aménagement du territoire par l’Etat
- Economique : fixer les unités sidérurgiques, métallurgiques et pétrochimiques liées aux matières premières importées
- Entrepreneurial : renforcer la solidité des grandes entreprises (Total, Usinor…)
4 ports sont choisis pour accueillir les ZIP : Dunkerque, Marseille, Le Havre, Nantes-Saint-Nazaire
- Les ZIP sont aujourd’hui des territoires stratégiques dans la production de richesse économique nationale : 70% de l’acier français, 2/3 de l’activité de raffinage. Elles fixent des entreprises industrielles comme Renault au Havre. Mais la désindustrialisation a également concerné les ports.
- Dunkerque et Marseille-Fos deviennent les 2 principaux pôles de la sidérurgie française (hauts-fourneaux)
- Raffinage : le Havre s’est ajusté à l’augmentation de la capacité des tankers avec le nouveau terminal pétrolier d’Antifer. 20% du pétrole brut importé en France passe par Antifer.
- Une conteneurisation récente et limitée : depuis les années 2000, les ports français se sont lancés dans le développement de terminaux à conteneurs mais avec 30 à 40 ans de retard sur les ports asiatiques et de la Northern Range. Seuls 2 ports sont réellement équipés :
- Marseille-Fos : deux terminaux à conteneurs de grande taille inaugurés en 2012
- Le Havre : le port le plus diversifié sur les trafics de conteneurs avec une politique ambitieuse d’investissement. Port 2000 est un terminal à conteneurs en eau profonde, accessible aux gros porte-conteneurs mondiaux.
- S’amarrer au foreland et équiper l’Hinterland : l’enjeu est de devenir des pôles logistiques de liaison avec les plus grands ports du monde et être choisis par les grandes compagnies de transport maritime (Maersk, MSC, CMA-CGM). Cela passe par une amélioration des connexions logistiques avec l’arrière-pays et la nécessité d’implanter des terminaux terrestres de stockage-réexpédition de marchandises (les ports secs) ainsi que des réseaux de transport terrestres.
- Mais le constat est la faiblesse du fret ferroviaire en France à la différence de la Northern Range.
Diversifier les activités portuaires et littorales
Nécessité d’élargir les activités face à la concurrence des autres ports européens et la désindustrialisation.
Les chantiers navals et la réparation navale
L’industrie navale reste compétitive notamment pour les paquebots et les navires de Défense et se concentre autour de deux leaders : Naval Group et Chantiers de l’Atlantique (90% du chiffre d’affaires).
Plusieurs grands chantiers ont fermé durant les années 1980 comme à Dunkerque ou Nantes, ce qui a induit un recentrage sur des activités de niche (paquebots, méthaniers…)
Exemple de Chantiers de l’Atlantique : spécialisés dans les navires de croisière et la construction de paquebots, notamment à Saint-Nazaire.
Exemple de Naval Group : leader majeur européen de la défense navale, construsant des bâtiments militaires de haute technologie et porté principalement sur l’exportation. 4 sites de construction : Lorient (bâtiments de surface), Cherbourg (sous-marins), Toulon (maintenance et modernisation des navires) et Brest (maintenance des sous-marins de la Marine nationale).
Il faut également ajouter les chantiers navals de taille intermédiaire qui produisent la majorité des navires de petite/moyenne taille présents en France.
Exemple : Océa aux Sables-d’Olonne (navires de pêche et catamarans, navires de recherche et de passagers).
Exemple : chantier Piriou à Concarneau spécialisé dans la production de navires de pêche
Ferry, croisière et plaisance
- 4 ports s’affirment dans le transport de passagers par ferries (60% du trafic) : Calais, Marseille, Bastia et Toulon. Calais est le premier port de passagers en Europe avec des liaisons quotidiennes avec Douvres au Royaume-Uni.
- Le secteur de la plaisance est une niche touristique lucrative : les ports ont développé des bassins réservés aux bateaux de plaisance. 1 million de navires de plaisance en France. Exemple du Port Camargue au Grau-du-Roi : premier port de plaisance en Europe, 2e au monde.
La plupart des grands ports de commerce ont ouvert des appontements réservés aux bateaux de plaisance.
Exemple de La Rochelle : a déménagé une partie de son port de commerce et réservé son vieux port à la logistique touristique tout en construisant un nouveau port dédié à la plaisance.
- Le secteur de la croisière
- 15 ports accueillent des navires de croisière, les plus importants étant Marseille et Cannes, ainsi que Fort-de-France dans les DROM.
- Exemple : Grand port industriel, Dunkerque s’est ouvert au tourisme avec un port dédié aux bateaux de croisière.
- Tout port voit l’évolution de ses trafics conditionnés par deux paramètres :
- Sa capacité de modernisation et d’ajustement aux évolutions du transport maritime
- Le dynamisme de l’arrière-pays, grand défaut des ports français
Les aménagements touristiques littoraux
a) Plusieurs générations de stations littorales (voir chapitre 1)
b) Une économie industrielle autour du tourisme et des loisirs de la mer :
Les communes littorales concentrent 60% de la fréquentation touristique estivale et 40% du total annuel. On note une concentration des équipements et des hébergements touristiques sur les littoraux (résidences de tourisme, camping, résidences secondaires…) avec des impacts économiques majeurs : les entreprises touristiques réalisent 44% de la valeur ajoutée de secteurs maritimes. Le tourisme génère des activités directes et indirectes : 56% du PIB et 50% des emplois des communes littorales sont liées au tourisme. La concentration du tourisme et des équipements est particulièrement marquée sur les littoraux méridionaux (héliotropisme) et d’outre-mer. La Région PACA est la région qui accueille le plus de touristes étrangers en France.
Exemple des îles métropolitaines : un engouement touristique majeur, présence de ports de plaisance et d’un tourisme de masse. La spéculation immobilière des résidences secondaires fait flamber les prix du foncier. Le tourisme a modifié les économiques traditionnelles devenus reliques ou folklore local mais qui sont parfois valorisées (labels, patrimonialisation).
Exemple de la « Surf Valley » : la côte aquitaine de Hossegor à Saint-Jean-de-Luz porté sur l’activité du surf. Cela a attiré des grandes marques étrangères comme Quicksilver ou Rip Curl qui y produisent des équipements sportifs mais implantent également des laboratoires et des activités de Recherche & Développement, avec des effets d’entrainement sur le tissu économique local (sous-traitants, services indirects…). La Surf Valley cumule 3 200 emplois et 400 entreprises.
c) L’économie résidentielle littorale en essor
Les activités de service l’emportent (3 emplois salariés sur 4). La Corse, la Charente-Maritime et la Normandie maintiennent néanmoins un important secteur primaire. Les littoraux du nord de la France sont plus marqués par la sphère productive, notamment industrielle, que ceux méditerranées où la sphère résidentielle est omniprésente.
On parle même « d’économies post-touristiques » : Exemples de Nice qui attire de nombreux congrès et salon ou Cannes et Deauville qui organisent des festivals de cinéma célèbres grâce à la « valeur ajoutée » littorale.
L’essor de la haute technologie littorale : des activités qui se concentrent sur des pôles ou axes régionaux (métropoles, vallées, littoraux) mais qui accentuent la marginalisation économique d’autres territoires, notamment l’intérieur des terres au profit des métropoles. Dans l’Ouest, ces activités concernent par exemple la chimie, la pharmacie et l’aéronautique (Pays de la Loire et Charente-Maritime), l’électronique et la téléphonie en Bretagne avec apparition de technopôles.
Exemple de Brest avec le technopôle de Brest-Iroise : technologies de la communication et recherche marine avec l’IFREMER.
Exemple de Sophia-Antipolis près de Nice : technopole avec des zones d’implantation d’entreprise, des zones d’habitat et des lieux de culture. 25 000 emplois directs et 1 300 entreprises.
Conclusion : notion de « France inverse » appliquée aux littoraux (René Uhrich)
- D’un espace agricole et rural aux structures archaïques à un espace de forte modernisation agro-industrielle avec l’essor de la haute technologie
- Un retournement démographique d’un espace à l’origine répulsif en un espace attractif
Chapitre 4 : les littoraux français, approche régionale
Des Flandres à la Normandie : des périphéries adjacentes au centre parisien
Dynamiques sociales et démographiques
La Normandie et les Hauts-de-France comptent parmi les variations annuelles de population les plus faibles. La Normandie est la seule région française littorale perdant des habitants, tout comme la plupart des intercommunalités littorales. La baisse est particulièrement importante en Seine-Maritime.
La proximité parisienne et les résidences secondaires ne sont donc pas un facteur unique de dynamiques démographiques ;
Caractéristiques économiques
- Des équipements portuaires qui structurent l’économie locale voire régionale : Le Havre, Rouen, ZIP de Dunkerque, Calais et Dieppe pour le trafic de passagers
- La pêche : Boulogne-sur-Mer premier port français en volume pêché
- L’énergie : équipements normands de la Hague et Flamanville, centrales thermiques de Dunkerque (gaz) et du Havre (charbon)
- Les activités militaires : Cherbourg avec son arsenal et sa rade
- La dimension mémorielle avec les plages du Débarquement et le Mémorial de Caen
Le tourisme : un littoral ponctué de stations anciennes. Exemple de Deauville avec sa promenade des Planches, le casino, les hippodromes, le port de plaisance. - L’économie résidentielle : présence notables de populations retraitées avec 54% de plus de 60 ans à Deauville.
- L’agriculture : élevage bovin à finalité laitière en Normandie, cultures céréalières ou légumières autour de Caen, culture de lin sur le littoral de Seine-Maritime
Les faiblesses de cet ensemble économique sont dues à la proximité parisienne qui modère son autonomie, le manque de fonctions de commandement ou encore l’engorgement des réseaux routiers dû à la priorité donnée au transport de passagers pour la voie ferrée aux dépens des marchandises. Mais ces faiblesses ne sont pas seulement spécifiques aux littoraux de ces régions.
Les villes littorales
- Des agglomérations en perte démographique : le Havre, Dunkerque, Cherbourg, Caen
- Le nombre d’entreprises au siège social reste modeste. Exemple néanmoins d’Helvetia France (assurances) au Havre
- Des dynamiques territoriales marquées par des projets d’envergure. Exemple du projet Neptune lancé en 1989 pour Dunkerque visant maintenir une activité industrielle importante mais en sortant du système productif monofonctionnel portuaire. Les fonctions du territoire sont diversifiées : lieux culturels (musée d’art contemporains), organisation repensée autour d’un centre urbain pivot entre le ville et le port (quartier de la Citadelle, implantation de l’université)
- Des projets similaires concernent d’autres villes littorales comme Cherbourg, Calais ou Boulogne-sur-Mer.
Centres et périphéries à l’échelle régionale - L’estuaire de la Seine agit comme un centre régional. Il comprend les pôles de Rouen et du Havre et concentre de nombreuses activités, notamment industrielles. Le système productif du Havre est lié à son port, à la raffinerie de Normandie et à une vaste usine pétrochimique. A noter l’association des ports de Rouen, Le Havre et Paris en un établissement public, HAROPA PORT et la présence d’un PNR ou encore d’une réserve naturelle de l’estuaire de la Seine.
- Des littoraux en situation de périphérie régional : les larges territoires ruraux situés entre les agglomérations. Exemple de la Flandre maritime caractérisée par des champs fermés pour l’élevage et des champs ouverts pour les cultures légumières ou céréalières.
De la Bretagne au Pays Basque : les littoraux supports d’un large dynamisme régional
Les dynamiques démographiques
Seules les intercommunalités du nord-ouest de la Bretagne, au sud de Brest et à proximité de La Rochelle présentent une baisse de leur population. La croissance de la population en Bretagne est portée par son littoral (surtout méridional) et la métropole rennaise.
Nantes et Bordeaux dominent leur région avec une attractivité liée au cadre de vie et paysager ainsi qu’un bassin d’emploi qu’elles représentent.
Les villes littorales en recomposition
Elles sont marquées par des recompositions dans l’organisation et le fonctionnement de leurs tissus urbains, sous l’impulsion d’acteurs territoriaux.
Exemple de La Rochelle : création de nouveaux lieux de fonctions récréatives (aquarium, musée du Nouveau Monde…) ; agrandissement du port de plaisance Des minimes pour en faire l’un des plus grands d’Europe ; un quartier nouveau entre le centre originel et le port de plaisance associant lieux d’enseignement supérieur, bâtiments résidentiels et résidences universitaires
Caractéristiques économiques
- Les littoraux profitent des systèmes productifs associés aux grandes agglomérations urbaines
- Les systèmes productifs industriels sont diversifiés avec une sensibilité à la mer et la maritimité : nautisme, construction navale, sports maritimes (Surf Valley), pôles de compétitivité comme le Pôle Mer Bretagne Atlantique autour de Brest.
- La valorisation de la mer avec une importante économie de la pêche (7 des 10 premiers ports français), l’aquaculture, les marais salants et des infrastructures portuaires, commerciales et militaires (chantiers navals de Saint-Nazaire, rade militaire de Brest). Mais le trafic de passagers reste modeste (traversées vers le Royaume-Uni à Roscoff).
- Le tourisme est une orientation dominante ou complémentaire en fonction des territoires. Exemple des « Côtes touristiques » : Côte d’Argent incluant Arcachon, Côte de granit rose en Bretagne etc…
- L’agriculture : des terres poldérisées avec des productions maraîchères (légumes) ou de l’élevage (prés-salés), les vignobles bordelais en position littorale qui valorisent les conditions pédologiques plus qu’un cadre maritime. En Bretagne : élevage de ports, cultures de maïs etc…
- Egalement des systèmes industriels sans lien avec la mer : cas des industries agroalimentaires bretonnes.
Les centres régionaux
- Des grandes agglomérations qui portent souvent le dynamisme régional avec un phénomène de métropolisation. Nantes et Bordeaux s’affranchissent de l’orientation maritime dans de nombreuses activités.
- L’estuaire de la Loire : Territoire dominé par Nantes avec des activités industrielles (chimie, engrais), de raffinage, des stations touristiques et des interstices environnementaux (PNR de Brière).
- L’estuaire de la Gironde : des équipements portuaires modestes (port du Verdon), des rives dominées par les vignobles bordelais. Les polders sont orientés vers des cultures ou de l’élevage. Un étalement croissant de l’agglomération bordelaise.
Périphéries et marges
a) Les territoires bretons
- Une orientation touristique affirmée : exemple du Golfe du Morbihan profitant d’un climat d’abri avec un tourisme tourné vers la plaisance ou encore les écoles de voile.
- Le Nord-est de la Bretagne est une périphérie intégrée autour de Saint-Brieuc sous l’influence de Rennes
- Des territoires concernés par les atteintes environnementales : cas des marées vertes sur les plages dues aux engrais agricoles. Mais on note également des initiatives en faveur des écosystèmes : des PNR come celui du golfe du Morbihan, le parc naturel marin d’Iroise, des réserves littorales comme la baie de Saint-Brieuc.
- Les îles bretonnes sont des territoires à part : elles développent des formes d’éco-tourisme et de limitation des entrées touristiques (île de Bréhat). Elles sont très attractives en termes d’implantations de résidences et sur le plan touristique.
b) Les littoraux vendéens et charentais
- Ils conservent pour l’essentiel des traits ruraux, à l’interstice entre territoires urbanisés, avec des stations touristiques qui constituent des pôle tertiaires et peu diversifiés.
- La poldérisation est majeure : exemple du Marais breton (pas en Bretagne !) dévolu à l’élevage bovin et d’intérêt environnemental avec un classement en zone Natura 2000. Mais d’autres polders sont des digues parfois fragilisés (tempête Xynthia)
- Une aquaculture pratiquée en mer et sur terre (exemple de la conchyliculture)
c) Le Littoral de la Côte d’Argent
Organisé autour de stations touristiques séparées par de vastes territoires dunaires et boisés (cas des Landes). Exemples de stations touristiques : Mimizan Plage, Biscarosse etc…
d) La côte basque
- Des villes littorales à l’économie touristique complétée d’activités héritées du passé (pêche à Saint-Jean-de-Luz) et une spécialisation liée à la mer et les sports de glisse ou nautique
- Un manque de structures de commandement qui confère à ce territoire un statut de périphérie, malgré tout attractive et intégrée.
Les littoraux méditerranéens : paysages contrastés aux dynamiques convergentes ?
Une croissance démographique forte
Toutes les intercommunalités littorales du Midi méditerranéen continental voient leur population augmenter. 60% des implantations nouvelles dans les communes littorales françaises depuis 1960 l’ont été autour de la Méditerranée.
Les facteurs d’attractivité
Notamment le fait de populations retraitées qui nourrissent une économie résidentielle voire une silver économie à la présence sélective.
Mais l’attractivité concerne également les populations actives du fait des potentialités d’emploi.
Un facteur culturel méditerranée et un cosmopolitisme reposant sur le mélange de culture associé aux vagues migratoires successives.
Les conditions bioclimatiques : hivers doux, ensoleillement élevé, mais également des contraintes comme les vents froids depuis l’intérieur des terres (tramontane, mistral), la sécheresse estivale provoquant des incendies.
Caractéristiques économiques
- La dimension paysagère maritime : est recherchée pour les activités récréatives, lesquelles ont un effet d’entrainement sur d’autres secteurs productifs, notamment tertiaires (exemple de Sophia-Antipolis). « Le ludique est toujours près du productif » (R. Brunet)
- Certaines industries portent une part maritime comme le raffinage et la pétrochimie qui s’appuient sur les produits importés par la mer.
- Des équipements portuaires au cœur de l’économie régionale : Marseille-Fos-sur-Mer pour les conteneurs, Sète pour le trafic de bétail vivant, Marseille et Nice pour les croisières, Toulon port militaire.
- Des infrastructures majeures souvent littorales : exemple de l’aéroport international de Nice.
- L’agriculture : des cultures maraîchères et des vignobles, donc certains bénéficient de traits pédologiques littoraux (exemple des vins de sables de Camargue)e
- La pêche est peu marquée en Méditerranée par rapport aux autres régions littorales (3 des 34 criées du pays) du fait de l’absence de tradition de pêche hauturière.
Les recompositions territoriales
Des projets territoriaux recomposent certains territoires. Exemple du projet Euroméditerranée à Marseille :
- Créer un rapport renouvelé à la mer.
- Les anciens dock sont réhabilités en immeubles de bureaux ou en lieux de culturels
- Création d’un vaste centre commercial : les Terrasses du Port
- Réaffirmer les liens avec le bassin méditerranéen par l’ouverture du Mucem (musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée).
- Marseille est capitale européenne de la culture en 2013.
- Piétonisation du Vieux-Port
Mais des revers sont à noter :
Des inégalités sociales marquées : certains quartiers péricentraux des grandes agglomérations sont défavorisés. A Perpignan, 1/3 des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Les territoires méditerranéens sont davantage concernés par les inégalités et la pauvreté avec des taux régionaux supérieurs à la moyenne nationale.
Dans les Alpes-Maritimes, la pauvreté est concentrées au sein de quartiers niçois et dans l’arrière-pays, alors que le reste du littoral est marquée par une richesse dominante.
Mais ces constats ne sont pas le seul fait des littoraux.
Les questions environnementales liées aux fortes densités humaines et des formes de bétonisation/artificialisation du littoral.
Centres et périphéries
a) Le Languedoc et le Roussillon
Un littoral peu maritime sauf par les progrès récents de l’aquaculture. Les structures de commandement se situent dans l’arrière-pays, tout comme les activités industrielles et terrienne (vignes). La mise en tourisme est tardive avec des stations intégrées qui participent à la bétonisation des côtes méditerranéennes.
b) La Provence
Les centres sont littoraux. Le tourisme est davantage élitiste. La rareté des littoraux non bâtis témoigne de la saturation du littoral
c) Les littoraux de Corse
- L’agriculture se concentre sur les terres plates de la partie orientale (cas de la clémentine corse ou de la vigne).
- Le tourisme privilégie des villages de vacances au modèle des stations.
- 10% du territoire est classé avec des réserves naturelles
- Absence d’activités industrielles majeures.
- La littoralisation est très marquée, ce qui marginalise l’intérieur des terres.
Les littoraux ultramarins : unité ou diversité ?
Des particularités environnementales
Nombre de ces territoires sont marqués par un climat tropical humide et une opposition entre côte au vent et côte sous le vent (protégée des vents). Le vent est une menace avec les cyclones mais peut devenir une ressource en énergie. Exemple des éoliennes en Guadeloupe produisant 7% de l’électricité de l’île.
La Végétation est souvent marquée par la mangrove dans les sites abrités. Exemple : à Mayotte, le lagon assure la protection nécessaire pour le développement des palétuviers qui constituent un espace refuge pour les espèces halieutiques. Leur traversée difficile a conduit à l’origine à leur destruction partielle avant d’être protégés aujourd’hui.
On note une diversité interne aux îles en termes de végétation.
Exemple : à la Réunion, le littoral oriental est beaucoup plus sujet aux précipitations que le littoral occidental.
L’organisation territoriale
- Les lieux de commandement et l’essentiel des populations sont concentrées sur les littoraux. Les capitales politiques sont pour la plupart situées sur la côte protégée des vents dominants (comme Basse-Terre en Guadeloupe ou Nouméa).
- Des héritages du passé : centres-villes hérités de la période coloniale à partir d’un port originel devenu obsolète pour les navires commerciaux, plantations agricoles présentes sur les littoraux (mais un changement de cultures pratiquées), un héritage mémorial lié à l’esclavage (cas des Antilles).
- Une pauvreté qui reste importante : 1/8 des habitants vivent dans un quartier sensible dans les anciens DOM et l’habitat précaire peut être présenté comme un trait ultra-marin, notamment à Mayotte (bidonvilles associés aux migrations depuis les Comores).
- Une fragmentation urbaine : exemple des quartiers d’habitat aisés à l’est de Fort-de-France.
- Une métropolisation à l’œuvre dans les grandes villes littorales, par le biais de fonctions de commandement économique et scientifique : universités, quartiers d’affaires (Fort-de-France) mais qui restent modestes, des lieux culturels comme le Mémorial ACTe à Pointe-à-Pitre consacré à l’esclavage.
- Des formes de macrocéphalie : exemple du Grand Nouméa (4 communes) qui regroupe plus de 65% de la population de Nouvelle-Calédonie.
Les systèmes productifs
- Les échanges et flux avec la métropole l’emportent sur les relations avec les territoires proches
- Des territoires qui bénéficient d’aides et transferts financiers depuis la métropole
- Des littoraux marqués par l’agriculture : alcools (rhum martiniquais), l’ananas à La Réunion etc…
- Le tourisme : avant tout lié à la venue de populations métropolitaines.
- Activités aérospatiales à Kourou en Guyane générant des zones industrielles pour la sous-traitance.
Les questions environnementales
80% de la biodiversité nationale est due à l’Outre-mer. Exemple du lagon de Nouvelle-Calédonie, le plus grand au monde, inscrit au Patrimoine mondial de l’Humanité.
Exemple du PN de la Guadeloupe qui couvre une bonne part des littoraux.
La Guadeloupe et la Martinique sont classées en réserve mondiale de biosphère par l’UNESCO.
Mais ce riche patrimoine pose des défis environnementaux :
Nouvelles formes de pollution comme les sargasses présentes sur les places antillaises et guyanaises.
Des scandales sanitaires comme sur les littoraux antillais avec l’usage du chlordécone dans les plantations de bananes, lequel pollue les nappes phréatiques et les espaces marins et provoque des formes cancérigènes.
Distinctions entre territoires ultramarins
- Les DROM : forte intégration à la métropole et une gestion des littoraux identique par rapport à la métropole. Exemple de Fort-de-France qui bénéficie également de programmes d’aides comme « Action cœur de ville » (rénovation de bâtiments)
- La Guyane : des littoraux au statu de marge
- Les terres du Pacifique sont marquées par une autonomie croissante (Wallis-et-Futuna, Nouvelle-Calédonie, Polynésie Française). Exemple de la Nouvelle-Calédonie avec des mouvements indépendantistes marqués.
- L’archipel polynésien est marqué par une dispersion constituant un frein à son développement (accessibilité réduite). Les littoraux supportent l’essentiel des activités comme la perliculture ou l’administration publique.
- Wallis-et-Futuna se caractérise essentiellement par des productions agricoles et artisanales. 70% des emplois sont le fait du secteur public.
Grâce notamment aux autres territoires ultramarins (Saint-Pierre-et-Miquelon, Terres australes et antarctiques françaises, Clipperton…), la France possède la deuxième Zone économique exclusive (ZEE) du monde.