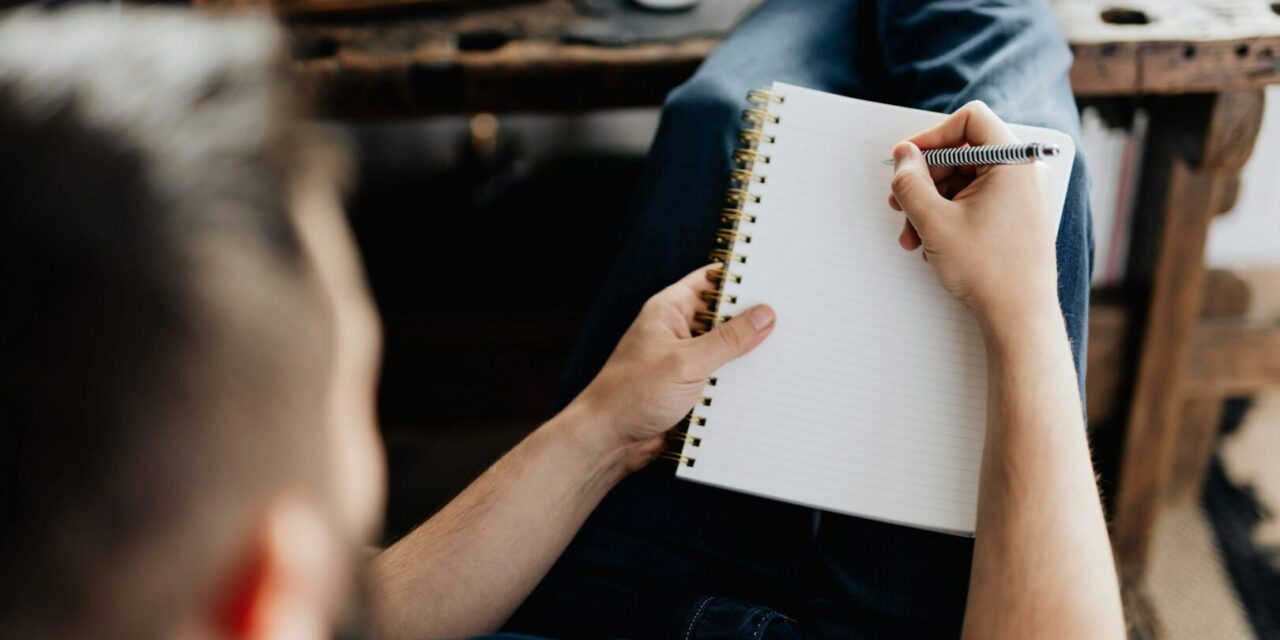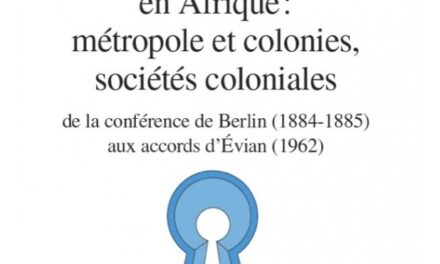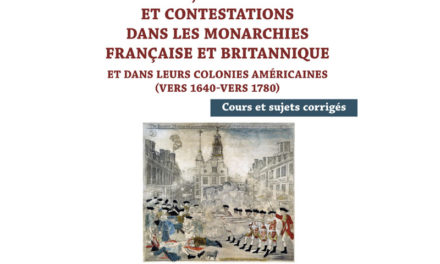Cette fiche pose clairement au propre les exigences de rigueur pour la méthode de la dissertation d’histoire à l’agrégation.
Sources :
- Rapports de jury de l’agrégation interne, http://eduscol.education.fr
- David Colon, Passer l’agrégation d’histoire, Presses de Sciences Po, Paris, 2007
- Thomas Merle (dir), Réussir le CAPES et/ou l’agrégation d’histoire-géographie, Atlande, Paris, 2016
I. La nature et les attendus de l’épreuve
Une dissertation est avant tout une démarche intellectuelle, une démonstration logique. Un sujet précis est imposé : il s’agit de le problématiser (=montrer qu’il comporte un problème) et de développer à l’écrit un raisonnement argumenté et structuré qui va traiter de ce problème (et pas d’un autre : sinon, on fait un hors-sujet). La problématique qui a été mise en lumière détermine toute l’argumentation et tout le plan de rédaction. Il ne s’agit donc pas de réciter des connaissances, mais d’organiser un raisonnement dynamique et organisé (comprenant une introduction, un développement, une conclusion, accompagnés de productions graphiques) autour des causes, des conditions, des facteurs, des évolutions, des mutations, des conséquences. La problématisation du sujet est centrale : c’est elle qui permet la rédaction qui va répondre à la problématique.
La règle essentielle est de toujours raisonner en historien, c’est-à-dire ne jamais perdre de vue 1) l’explication des événements connus par le biais de leurs sources subjectives et 2) leurs conséquences sur des individus ou des groupes sociaux.
L’histoire est une science humaine : si les faits passés et clos ont une importance première, et s’il faut les raconter, il faut aussi expliquer comment les événements ont participé à la structuration des sociétés en tenant compte des différentes tendances historiographiques (histoire politique, nouvelle histoire économique, histoire des relations internationales, histoire des représentations, histoire des genres, histoire de l’environnement, enjeux de mémoires…).
II. L’introduction
L’introduction doit partir d’une accroche pertinente pour aller vers une définition précise et claire du sujet débouchant sur une problématique puis l’annonce du plan.
L’accroche consiste à introduire le sujet. Elle peut prendre des formes variables : les faits d’actualité, une anecdote, ou encore une référence scientifique ou culturelle liée évidemment au sujet. Eviter les généralités comme « Paris et le désert français » de Jean-François Gravier….
La définition des termes du sujet ne doit laisser aucun élément dans l’ombre. La première chose à faire est de bien lire (relire, et même réécrire) le sujet. Aucun des termes n’a été choisi au hasard. Ils ont tous un sens et une utilité précise. Il faut donc commencer par y réfléchir.
Tout dans le sujet est important : le choix des mots-clés et des concepts ; l’ordre dans lequel ils sont présentés ; l’emploi du singulier ou du pluriel ; le ou les mots de liaison.
Il faut d’abord s’intéresser aux mots-clés qui doivent être compris et définis précisément à l’aide de connaissances solides. L’ordre dans lequel ils sont présentés a aussi son importance : on insistera généralement davantage sur le premier que sur le second (exemple : La mer en Asie du Sud-Est, La géopolitique de l’Europe depuis 1945, Faire la guerre au XVIIe siècle…).
Il faut aussi faire très attention aux singuliers et aux pluriels, comme dans Le roi absolu et les religions en France au XVIIe siècle ou Les formes du terrorisme depuis 1991. Le pluriel invite souvent à multiplier les différences, alors que le singulier insiste sur un modèle unique, un idéaltype.
Il faut enfin prendre garde à la ponctuation et aux mots de liaison : « et », « ou », « dans » ne signifient pas la même chose. La forme affirmative ou interrogative doit également être prise en compte, de même que la présence de guillemets qui suppose qu’une expression particulière est utilisée.
|
Exemple pour le sujet « Seigneurs et paysans, XIe-XIIIe siècles » Ici, le sujet suppose de faire une comparaison dynamique des seigneurs (au pluriel, donc de différents types, différents niveaux, différentes hiérarchies) et des paysans (au pluriel également, donc de différentes valeurs, différentes représentations, différentes activités) sur une durée de 3 siècles. Il y a donc à la fois des choses qui évolueront, et d’autres qui ne changeront pas, et il faudra parler des deux. De plus, il faut traiter des deux figures en relation l’une avec l’autre (c’est le sens du « et »). L’un n’existe pas sans l’autre. Les risques seraient donc de voir d’abord les seigneurs, puis les paysans, et de penser que rien ne change pendant 3 siècles. Le sujet n’aurait donc pas été compris. |
Il est ensuite nécessaire de procéder à une analyse rigoureuse de ce sujet, en citant si possible des auteurs. Les concepts (« Etat », « Nation », « Représenter »…) relèvent d’une historiographie à connaître et certains doivent être définis dès l’introduction.
|
Exemple pour le sujet « Défendre la République, 1815-1914 » Ici, le sujet invite à étudier une contradiction : étudier une minorité politique qui défend un modèle civique dans une France qui a une forme tout à fait différente, puis une majorité qui doit résister à de puissants courants contraires. Il s’agit de montrer les pensées et les actions souterraines ou secrètes des républicains pour renforcer et solidifier le régime du « Progrès » alors qu’en 1815 et 1914, la France est dirigée par des rois, des empereurs ou des présidents réactionnaires qui rejettent évidemment la forme républicaine. Il faut s’interroger sur la capacité des républicains à diffuser leurs idées, à mobiliser les foules, à organiser des révolutions, à dresser un bilan de leurs réussites ou de leurs échecs, et de traiter également de leur surveillance et de leur répression. |
Il est nécessaire de vérifier qu’on a bien délimité le sujet à la fois chronologiquement et géographiquement. Si le sujet donne des bornes chronologiques, il faut les expliquer (1815 et 1848) ; si le sujet n’indique pas de bornes chronologiques, il faut en donner et les justifier. L’espace couvert par le sujet doit aussi être précisé (le premier exemple ne donne pas de précision, il peut être nécessaire de dire qu’on se limite à la France dans ses frontières du XIe-XIIIe siècles).
Quand l’énoncé du sujet a été compris dans sa forme, un premier questionnement, c’est-à-dire une première idée de problématique, commence à apparaître. Le sujet est compris, à la fois dans son évolution et ses ruptures ; les mots-clés ont été définis ; la direction (évolution, comparaison, opposition…) a été comprise à partir des mots clés ; les principaux thèmes sont identifiés. A partir de là, il faut réfléchir de manière pertinente à l’écriture d’une problématique.
L’analyse du sujet et de ses enjeux doit conduire à une problématique claire, et une seule, qui doit constituer le fil rouge de la réflexion.
La problématique est l’élément-clé de la dissertation. Elle est le fil directeur du raisonnement et de l’argumentation globale. Le sujet tel qu’il a été écrit comporte un problème caché. Ce problème a été saisi au moment de la réflexion autour des mots-clés. La problématique doit donc mettre en évidence ce problème. Elle ne se contente pas de reformuler le sujet, mais elle découle de la compréhension intelligente du problème qui est lié au sujet. Elle fait immédiatement deviner si le sujet a été compris ou non, si le développement sera hors-sujet ou non. La qualité de la problématique est le meilleur indice de la réussite ou non du travail réalisé.
La qualité de cette problématique dépend de la qualité des connaissances personnelles. Un candidat sans connaissances cherchera à étirer la problématique vers le peu qu’il connaît, quitte à être hors-sujet ; un candidat qui sait beaucoup de choses pourra à l’inverse écrire une problématique trop large pour pourvoir dire un maximum de connaissances, mais il oubliera le sujet d’origine ; le bon candidat sélectionnera ses connaissances en fonction du sujet qu’il doit traiter. Il donnera une direction précise et cohérente pour poser une question précise, et apportera des raisonnements utiles à la construction de sa réponse.
Il ne cherchera pas à tout dire, il choisira au mieux parmi ses connaissances.
La problématique doit être écrite sous forme de question. Elle reprend les mots-clés du sujet et elle reflète les différents enjeux qui ont été étudiés pour mettre en évidence toute l’étendue du problème. Il faut éviter l’enchaînement de deux ou trois problématiques ou le catalogue de questions.
Pour simplifier cette problématique unique, il peut être utile d’écrire juste avant une ou deux phrases qui vont donner de la profondeur au problème principal.
|
Exemple pour le sujet : « Représenter et contester le pouvoir de l’Etat » « C’est en dépassant ses contestations que l’Etat peut se moderniser. En somme, l’affirmation de l’Etat absolu et sa dénonciation sont deux phénomènes conjugués qui ne peuvent se passer l’un de l’autre. Il nous faut donc comprendre les liens entre la représentation et la contestation du pouvoir de l’Etat à partir des transformations absolutistes dans l’Angleterre de Charles Ier critiqué dès la réunion du Long Parliament (novembre 1640) et dans la France à la mort de Richelieu (décembre 1642), jusqu’aux difficultés des deux royaumes qui subissent la violence des non-représentés dans les colonies et dans les cours souveraines, tout au long des années 1770. |
Le sujet lui-même ne peut pas tenir lieu de problématique, même lorsqu’il se présente à la forme interrogative. Il faut présenter une lecture historique du sujet, défendue et justifiée.
|
Exemple pour le sujet « Représenter la Nation en France (1789-1914) » Le cœur du sujet porte ici sur l’incarnation concrète et théorique de la Nation, définie par Jean-François Caron comme un peuple organisé politiquement (contrairement au « peuple », qui désigne simplement une catégorie ethnographique rassemblant sur un même territoire une population unie autour d’une origine commune, d’une langue ou d’une religion). La « Nation » s’incarne dans un chef et une assemblée à qui le peuple a confié sa souveraineté pour qu’il l’exerce en son nom. |
L’annonce du plan est entièrement rédigée sous formes de phrases qui s’enchaînent logiquement. Elle consiste à proposer deux ou trois parties qui constituent l’armature du développement.
III. Le développement
La dissertation d’histoire n’est pas une simple énumération de données factuelles : c’est une démonstration articulée autour de 2 ou 3 parties, composées elles-mêmes de sous parties qui s’enchaînent de façon logique et cohérente.
Il vaut mieux traiter les sujets en 3 parties plutôt qu’en 2. Un plan en 2 parties manque généralement de nuances : il oppose trop simplement deux points de vue et ne témoigne pas d’une grande recherche. Un plan en 3 parties est en revanche plus construit, plus subtil, plus approfondi. Il permet plus habilement de croiser des informations qui se complètent sans se contredire.
Cette démonstration est basée sur un plan solide et cohérent répondant de manière argumentée à la problématique. Il ne doit pas dissocier les termes du sujet (ex pour un sujet sur « Seigneurs et paysans » : I/ Seigneurs II/ Paysans).
Le plan
Le plan est construit à partir de la problématique, il en constitue une réponse. Les titres de chaque partie doivent donc permettre de répondre à la problématique.
Si une dissertation est une démonstration, cela signifie que chaque élément doit faire naître la suite. Ainsi, le sujet a fait naître un problème, puis une problématique. La problématique fait naître un plan. A partir de là, la logique doit organiser tout le raisonnement. Une 1ère partie va logiquement amener à une 2e partie, qui va amener logiquement à une 3e partie.
Quand les trois grandes parties sont choisies et organisées de manière logique, il faut bâtir le plan plus détaillé. Là encore, la 1ère sous-partie doit amener la 2e sous-partie, qui amène la 3e sous-partie. La 1ère idée de la sous-partie doit conduire à une 2e idée qui la complète ou la prolonge, puis à une 3e idée qui termine le raisonnement, avant de passer à la sous-partie suivante, et ainsi de suite. Toutes ces étapes se répètent et s’enchaînent pour former un véritable système.
|
Exemple pour le sujet : « La France à la fin de la Seconde Guerre Mondiale (1944-1946) » Le sujet appelle un plan analytique : un tableau de la situation de la France entre 1944 et 1947, période de fin de guerre (à partir de la Libération) et jusqu’à la reconstruction politique (Constitution de la IVe République). Trois thèmes sont proposés, qui s’enchaînent entre eux pour montrer un tableau du territoire, de la population, de l’économie, de l’organisation de l’Etat. A l’intérieur de chaque partie, on peut intégrer ensuite des sous-parties chronologiques (exemple dans la 1ère partie). I. La Libération du territoire et des populations occupées |
Quand les trois grandes parties sont choisies et organisées de manière logique, il faut bâtir le plan plus détaillé. Là encore, la 1ère sous-partie doit amener la 2e sous-partie, qui amène la 3e sous-partie. La 1ère idée de la sous-partie doit conduire à une 2e idée qui la complète ou la prolonge, puis à une 3e idée qui termine le raisonnement, avant de passer à la sous-partie suivante, et ainsi de suite. Toutes ces étapes se répètent et s’enchaînent pour former un véritable système.
|
Exemple pour le sujet : « Mer et mondialisation en Asie du Sud-Est » Dans quelle mesure la présence de la mer est-elle à la fois une opportunité et un défi pour les Etats d’Asie du Sud-Est, et pourquoi est-elle d’un intérêt de plus en plus essentiel pour les autres nations ? I. La mer a un intérêt vital : l’Asie du Sud-Est a forgé son unité et son développement à partir de la mer II. La mer relie et ouvre à la mondialisation III. Un espace menacé et à protéger |
Il ne suffit donc pas de disposer de connaissances, il faut aussi les organiser de manière logique. Cette logique, cette succession d’idées, d’arguments et d’exemples qui s’enchaînent, forment alors toute la trame de la dissertation. Ce plan au brouillon fait la différence entre un plan logique et plan à tiroirs, où on colle des thèmes qui se suivent sans entretenir aucun rapport entre eux. Si les thèmes n’ont aucun lien entre eux, la démonstration n’est pas bien bâtie. Elle ne répondra pas vraiment à la problématique.
L’objectif est donc de sélectionner les seules connaissances et informations utiles pour répondre à la problématique, par l’intermédiaire des thèmes des parties et des sous-parties.
Voici un tableau récapitulatif des types de sujets que l’on peut retrouver dans les rédactions d’histoire :
| Sujet | Type | Exemple |
| Causes/Conséquences | Thématique | Les causes et les conséquences économiques et sociales de lacolonisation grecque aux époques archaïque et classique |
| Tableau | Thématique | La France pendant l’entre-deux guerres |
| Bilan | Thématique | L’Allemagne à la fin de la Seconde Guerre Mondiale |
| Comparaison | Thématique | La Renaissance en Italie et la Renaissance en France |
| Événement | Évolutif | Le massacre de la Saint Barthélémy (1572) |
| Évolution | Évolutif | De l’apogée de l’Empire Romain à sa chute en 476 |
| Biographie | Évolutif | Vie et règne Louis XIV |
|
Les principaux types de plan en histoire Le plan chronologique suppose l’analyse d’une succession d’événements (continuités et ruptures), mais surtout des facteurs d’explication des évolutions et des changements. Quand il s’agit de traiter une longue période, un découpage, justifié par l’enchaînement logique de grandes phases homogènes, doit être mis en place. Il est utile de réfléchir en amont à ces découpages et à leurs justifications. |
|
Exemple : plan détaillé du sujet « S’opposer au pouvoir dans le monde romain » Pourquoi la diffusion de la domination romaine entre 70 avant J.C. et 73 après J.C. a-t-elle produit de nombreuses marques d’opposition, à Rome et dans les provinces, et ces oppositions ont-elles représenté de vrais dangers pour la stabilité du pouvoir romain ? I. Malgré la force du pouvoir romain, l’opposition est courante. Il y a un climat d’opposition et des opposants. Pas d’unanimitas A. Résistances provinciales aux conquêtes
B. Oppositions à Rome même
C. Les guerres civiles et leur effet dans tout l’empire
II. L’opposition en action
B. Le ralliement d’une partie des provinces
C. La violence politique vient de l’intérieur (spécifique à l’Empire)
III. Cela met-il en danger la stabilité de Rome ?
B. Les guerres civiles
C. L’année des quatre empereurs (69) : un cas particulièrement dangereux
|
Le contenu
Une bonne dissertation présente un équilibre entre une réflexion générale, l’évocation d’auteurs et d’exemples précis.
La réflexion générale s’appuie sur des concepts qu’il faut définir. Il existe en histoire des analyses qui font débat : ne pas hésiter à en rendre compte en les restituant fidèlement, sans négliger évidemment de citer l’auteur et sans déformer sa pensée.
Des livres ou des articles scientifiques peuvent/doivent être évoqués au fur et à mesure de la démonstration. Mentionner un nom d’auteur ne suffit pas, il faut aussi citer l’ouvrage ou l’article qu’il a publié (en respectant les règles bibliographiques), et être capable de le présenter en l’insérant dans un courant historiographique précis. Les citations (apprises par cœur avant l’épreuve) ne sont utiles que si elles servent réellement à la démonstration.
Une dissertation d’histoire ne peut se concevoir sans exemples. Un impératif : dans un raisonnement historique, l’événement ne peut se suffire à lui seul : il est le point de départ d’un raisonnement. Eviter de proposer une succession d’exemples trop nombreux, à la manière d’un catalogue, dont on ne tire finalement rien : mieux vaut quelques exemples bien choisis, bien maîtrisés, bien décris et bien analysés. Même si ce peut être un plus, il n’est pas nécessaire de chercher à tout prix à présenter un exemple original… au risque d’oublier parfois des exemples essentiels et très attendus, parce que connus de tous, mais présentant des enjeux importants et ayant suscité pour cela de nombreux travaux (exemple : la frontière États-Unis / Mexique pour un sujet sur les migrations).
La structure de l’argumentation doit être mise en valeur : phrases d’annonce des plans intermédiaires, résumés et transitions, connecteurs logiques, vocabulaire adapté.
Il faut enfin s’efforcer d’être scientifiquement précis : un événement doit être daté ; un exemple pris dans un ouvrage/article scientifique doit être référencé.
Chaque partie doit être équilibrée.
|
Exemple : deux sous-parties rédigées sur la désacralisation de Louis XVI au cours de la Révolution française Les premières années de la Révolution française illustrent une « désacralisation » du roi. Ce processus aurait commencé le 23 juin 1789, quand Louis XVI annonce la fermeture des Etats Généraux et que Bailly lui a répondu « Il me semble que la Nation assemblée n’a pas à recevoir d’ordres ». Elle se poursuit le 14 juillet quand la décision est prise par l’Assemblée nationale de détruire la prison, symbole du pouvoir absolu et arbitraire du roi. Le 17 juillet, Louis XVI doit participer à une cérémonie à Paris en portant sur son chapeau une cocarde tricolore (symbole de la Nation à Paris) au lieu de la cocarde blanche (royaliste). Le 8 octobre suivant, après la Marche des femmes à Versailles, le « roi de France » devient « roi des Français » par la loi. On comprend alors que le roi ait tenté de s’enfuir. Le roi et sa famille quittent les Tuileries à la tombée de la nuit le 20 juin 1791. Ils voyagent en direction de Metz. Ils sont déguisés en valet et en gouvernante : cette mascarade provoque à elle seule, selon Mona Ozouf, « la mort de la royauté » (2005) : la monarchie s’est avilie en se prêtant à cette mise en scène. Mais le roi est reconnu à Châlons-sur-Marne par le maître de poste, dénoncé à la garde nationale, et arrêté le 21 juin à Varennes. La famille est ramenée à Paris sous les sifflets et les crachats des foules populaires. Idée générale Argument Exemple appuyé sur des connaissances précises Vocabulaire/Concept |
La présentation et la forme du devoir
Il faut veiller à la lisibilité de la copie. Pour cela, le devoir doit être aéré. Une copie bien ordonnée et bien écrite est plus agréable à lire. L’ensemble du devoir doit être entièrement rédigé, les titres des parties et sous-partie ne doivent pas être apparents mais remplacés par des phrases d’annonce.
- quelques lignes séparent les 3 grandes articulations (introduction, développement, conclusion) ;
- le développement lui- même fait apparaître clairement 2 ou 3 parties par un saut de ligne conséquent ;
- chacune de ces parties comporte des paragraphes ou sous-parties marquées par l’utilisation d’un retrait ou alinéa ;
- présence de transitions ou de conclusions partielles entre les trois grandes parties : elles doivent servir à revenir au questionnement initial en articulant les arguments.
- Rappel : la typographie des titres des ouvrages suit une norme : si la dissertation est manuscrite, les titres sont soulignés ; si la dissertation est tapée à l’ordinateur, les titres sont en italique. Les pages peuvent être numérotées pour indiquer au correcteur qu’il ne faut rien oublier, surtout si la conclusion a été écrite sur une feuille à part.
Le développement se rédige directement au propre
Le plan (plus ou moins détaillé) a été fait au brouillon : cela suffit. Il faut ensuite construire les phrases directement sur la copie. On peut alors s’autoriser quelques erreurs d’expression qui sont moins graves ici que dans l’introduction ou la conclusion. Il faut simplement veiller à avoir une écriture lisible et suffisamment soignée (malgré les ratures et les traces de blanc).
La rédaction est toutefois importante. Les phrases doivent être courtes, écrites dans un français correct, au présent (ou au passé, à condition de bien maîtriser les conjugaisons). Les connecteurs logiques peuvent s’avérer très utiles, à condition de bien les utiliser et de ne pas en abuser ou les répéter (« tout d’abord, nous verrons dans un premier temps… » est une expression maladroite). Attention également aux fautes d’attention : les fautes d’orthographe, les majuscules aux noms propres, les fautes d’accord singulier/pluriel, masculin/féminin, les accords de COD, la concordance des temps… Il faut évidemment se relire plusieurs fois avant de rendre le devoir.
Il faut parvenir à guider le correcteur dans sa lecture et lui indiquer à des endroits-clés à quel moment de la démonstration il se trouve. Chaque partie peut ainsi commencer par un court paragraphe qui 1) rappelle le plan annoncé dans l’introduction ; 2) annonce les sous-parties. A la fin de chaque partie, il est possible de rédiger une transition de quelques lignes (1 à 2 phrases) qui résume ce qui vient d’être dit et qui enchaîne sur la suite. Ce sont des manières subtiles de maintenir l’attention du correcteur en lui résumant sa pensée avant de commencer une nouvelle étape du raisonnement.
IV. La conclusion
Elle ne consiste pas à reprendre les conclusions des grandes parties, mais à revenir sur la problématique en y répondant de manière adéquate. La conclusion est donc inévitablement liée à l’introduction. Les deux paragraphes fonctionnent en duo. Ils forment l’unité du devoir, son début et sa fin. Elle débouche sur une ouverture qui élargit le sujet de façon pertinente.
La conclusion est un texte plus rapide que l’introduction. Elle fait le bilan de la démonstration. Elle répond à la problématique et rappelle les arguments principaux de chaque partie du plan. Elle se termine par une ouverture.
Il est souvent conseillé d’écrire la conclusion immédiatement après avoir écrit l’introduction, au moins au brouillon, ou au mieux sur le début d’une nouvelle feuille, qu’il suffira d’ajouter au devoir à la fin. De cette manière, on s’assure que le texte final réponde vraiment à la question qui a été posée au début. On est également certain que le travail aura bien un début et une fin. En cas de mauvaise gestion du temps, il vaut mieux avoir une dernière partie plus courte que ne pas avoir de conclusion.