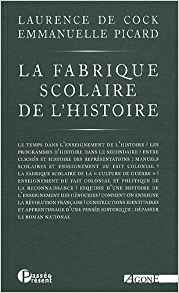La fabrique scolaire de l’Histoire
Laurence De Cock – Emmanuelle Picard
Avant propos
L’école est le premier lieu d’usage public de l’histoire, avec 3 finalités : morale, civique et intellectuelle. Ce n’est pas une transposition de la recherche, c’est une fabrique de sens, une forme d’écriture mémorielle.
L’histoire scolaire n’a jamais cherché à être exhaustive. Et il ne faut pas la juger à l’aune des manuels scolaires : un manuel n’est qu’un maillon de la fabrique scolaire de l’histoire.
Les français attribuent à l’histoire des finalités et des vertus qui sont en fait des projections sur l’école.
« Roman national » : une expression qui renaît dans les années 90, quand il y a eu un nouveau rapport au passé. C’était « le présentisme » selon Hartog : patrimonalisation, commémorialisation, doutes sur l’avenir, valorisation de l’éphèmére…
L’enseignement de l’histoire a de nombreuses finalités : d’après les programmes, il doit « construire une culture commune et un patrimoine », mais il peut aussi reconnaître les oubliés, guérir les blessures du passé, pacifier les élèves… Elle doit raffirmer un socle commun ou légitimer les particularismes, en fait ?
La France est l’un des seuls pays où l’histoire s’enseigne du primaire au lycée, sans discontinuer.
Il y a des manuels d’histoire européens ou bi-nationaux (Israelo-palestiniens, germano-polonais, franco-allemand…)
I) Programmes et prescriptions : le cadre réglementaire de la fabrique scolaire de l’histoire
Des programmes nationaux pour l’histoire existent depuis deux siècles, en France. Dès 1802, l’histoire a eu une fonction politique centrale : former les futures élites, les futurs électeurs, les futurs citoyens.
L’histoire permet aussi, pour la monarchie de Juillet, de réaliser la syntèse de l’Ancien Régime et de la Révolution, pour réconcilier les mémoires.
Les programmes scolaires d’histoire dans l’enseignement secondaire
Lucien Febvre (école des Annales) souhaite introduire dans les programmes l’histoire des civilisations. Cela est finalisé en 1957, avec le « programme Braudel », mais le retour en arrière est rapide.
Georges Pompidou, de 1962 à 1968, s’implique dans les programmes scolaires, qu’il voit comme son « domaine réservé ». Il veut une histoire chronologique, centrée sur les grands hommes. Il s’oppose à l’Ecole des Annales.
Loi Haby du 11 juillet 1975 : mise en place du collège unique, et d’un nouveau programme, où la chronologie est moins présente, mais cela suscite des réactions fortes (ex : Alain Decaux, avec sa tribune du Figaro « on n’apprend plus l’histoire à nos enfants », ou Braudel).
Mitterrand, lors de son premier septennat, dénonce les carences de l’enseignement de l’histoire.
En 2006, ce sont les « programmes Wirth », où les enjeux mémoriels et les débats de société ont toute leur place (esclavage, guerre d’Algérie, immigration…). L’identité nationale devient plurielle. Les programmes sont subordonnés aux attentes sociales du politique.
Le temps dans l’enseignement de l’histoire
L’histoire scolaire est percue comme « la discipline du temps ». En fait, elle forge la conscience du temps à travers les objets d’étude. Le temps historique (à l’école comme en recherche) est un temps reconstruit, pensé, mis à distance.
C’est en 1963 que l’enseignement secondaire a définitivement été découplé en deux cycles de scolarité (collège et lycée).
Les programmes apprennent à périodiser (« périodiser, c’est déjà interpréter) mais n’apprennent pas à penser la durée et l’enchevêtrement des temps. Mais il ne faut pas pour autant remplacer le temps court par la longue durée, qui gommerait l’évènement. Ex : noyer la crise de 1929 dans le temps long de l’âge industriel.
L’évènement, par contre, peut dévoiler les structures. Ex : Georges Duby, avec « Le dimanche de Bouvines ».
Penser historiquement, c’est construire des modes de raisonnement où le temps est à la fois trame et acteur de l’histoire.
L’histoire n’a pas pour fonction de transmettre juste ce qui, dans le passé, explique le présent : la « tyrannie du présent sur le passé » empêche de penser le futur. Mais, en situation scolaire, il est inévitable d’instrumentaliser (un peu) le passé.
II) Quelle place pour les acteurs historiques dans l’histoire scolaire ?
Les manuels scolaires : 20 ans d’expérimentations, puis, dans les années 90, retour à des manuels plus lisses, plus standardisés, sans débat historiographique et sans aspects critiques, mais avec plus de documents iconographiques. Pauvreté du contenu, mais jolis, esthétiquement parlant.
En fait, si les représentations ont plus de poids, c’est parce que l’histoire culturelle apparaît.
Par contre, les groupes sociaux, culturels ou en terme de genre, restent absents.
Il y a beaucoup d’affiches de propagande dans les manuels : cela ne restitue pas la complexité du réel, ni les conditions de réceptions de ces messages. Le « message » est le seul biais utilisé pour analyser un régime, une idéologie, une politique. On ne parle plus, par exemple, des conditions socio-économiques du totalitarisme, mais on se focalise sur une lecture culturaliste et simplificatrice.
Les programmes sont aussi chargés d’ « inflexions patrimoniales » : le devoir de mémoire. On passe dans l’émotionnel, l’affectif, l’empathie.
Manuels scolaires et enseignement du fait colonial
L’école participe à la perpétuation de clichés coloniaux. En fait, le traitement scolaire de l’histoire coloniale a vraiment été sérieusement abordé par les manuels dès les années 90. Le fait colonial en métropole est extrêmement présent dans les manuels, mais à travers des images de propagande (qu’il faut analyser avec recul et recontextualisation). La dimension culturelle du fait colonial est quand même très présente.
Il faut aussi sortir d’une indignation qui serait juste d’ordre moral et étayer cette indignation par des faits.
S’intéresser aux représentations, ce n’est pas forcément proposer une histoire coloniale du fait colonial. Si on se focalise sur les représentations de cette époque, sans les historiciser, on risque de perpétuer les stéréotypes et de rester sur la logique du « bilan ».
La fabrique scolaire de la culture de guerre
En France, une historiographie domine l’histoire de la Grande Guerre : l’histoire culturelle (celle de l’historial de Péronne). L’histoire « pacifiste » de la guerre, qui met l’accent sur la souffrance des soldats victimes, est reléguée au second plan. On lui préfère les notions de « brutalisation », de « consentement », de « culture de guerre », voire « d’entreprise de démolition », avec la participation volontaire des européens. La notion de « brutalisation », même si elle est invalidée sur le plan scientifique, est enseignée aux lycéens. C’est même l’axe majeur de ces programmes.
Pour cette guerre, les manuels se focalisent trop sur des affiches de propagande et ne traitent pas (ou trop peu) les pratiques et les conditions de vie.
III) Entre devoir de mémoire et politique de la reconnaissance : le problème des questions sensibles dans l’école républicaine
En 1985, Jacques Bercque a proposé de faire 3 heures/mois sur « les langues et cultures d’immigration », dans l’école élémentaire, et de ne plus parler de « culture d’origine » mais de « culture d’apport ».
De même, il faudrait préférer « devoir d’histoire » ou « devoir d’intelligence » à « devoir de mémoire ».
Le but de l’enseignement de l’histoire en France, depuis le XIXeme : rendre les élèves membres de la communauté nationale, par le partage de valeurs, d’une culture et d’une mémoire historique commune. L’école était donc à la fois le socle et le fruit de l’État-nation.
A partir de la décolonisation, l’enseignement de l’histoire a pris ses distances avec le « roman national ».
Pour aborder les sujets plus conflictuels, l’école, dès les années 80, a changé de grille de lecture, et est passée de l’État-nation au droits de l’homme, plus universalisants. Cela a aussi développé une certaine symétrie entre colonisés et colonisateurs.
Depuis la Seconde Guerre Mondiale, l’histoire a deux orientations :
- développer le sens critique des élèves
- transmission patrimoniale
Le problème, c’est que la morale, l’affect et la problématique mémorielle gagnent, par exemple, l’enseignement de la guerre d’Algérie.
Dans la réalité, en classe, le récit historique n’ est pas morcelé entre plein de communautés qui aspirent à leur reconnaissance. Par contre, la pluralité des mémoires est prise en compte.
Le risque, en revanche, c’est que l’histoire devienne leçon de morale, que l’iconographie remplace l’analyse historique. Le « roman national » n’est pas complètement mort, mais le lien entre identité nationale et enseignement est reconfiguré. En fait, c’est toute la conception de l’État républicain qui est ainsi modifiée : à la fois un principe d’égalité entre citoyens et une reconnaissance d’appartenances communautaires sur fond victimaire. Pour cela, il faut bien prendre garde à distinguer « communauté mémorielle » et « communauté culturelle ».
Les enseignants d’histoire doivent arbitrer entre ces deux logiques.
Esquisse d’une histoire de l’enseignement des génocides à l’école
La Seconde Guerre Mondiale n’apparaît dans les programmes scolaires qu’à partir de 1962 : penser Vichy et la collaboration pouvait nuire à la réconciliation nationale, à l’unanimisme de la Résistance. Et il y avait la Guerre Froide.
L’extermination des juifs et l’antisémitisme ne sont que peu évoqués au départ. Nuit et Brouillard et Le Chagrin et la Pitié sont censurés, Paul Touvier est gracié en 1971. L’histoire académique et la recherche sont aussi en retard sur ces sujets. Il y a aussi une volonté de ne pas mettre en concurrence les victimes.
Le livre de Paxton, dans les années 70, contribue à changer la donne. Mais Hilberg a été plus important.
Le « droit à l’oubli » de Sophie Ernst est opposé au « devoir de mémoire », à propos de ce génocide. En fait, les enjeux mémoriels et la morale, pour ce cours, submergent tout et submergent l’histoire: ce cours n’est pas traité « comme les autres ».
Il faut garder en tête que, d’une génération à l’autre, les enjeux de la mémoire ne sont pas identiques.
L’enseignement de la Shoah, en minant ce qui semblait être des certitudes, remet en cause le roman national.
IV) Pour dépasser le roman national
Dans l’enseignement de l’histoire, il faut trouver un équilibre :
- si on fait trop de récit, trop d’évènementiel, on peine à distinguer légendes et réalité (ex : histoire des religions).
- si, au contraire, on fait trop de décomposition et d’analyse de l’histoire et des moments historiques, ça sera trop austère.
L’histoire : une réponse à des conflits sur la longue durée ? Exemple des tentatives de manuels franco-allemands. En fait, cette volonté d’utiliser l’histoire pour la réconciliation est plus un rêve qu’une réalité.
Comment on enseigne la révolution française – quelques questions à l’écriture scolaire de l’histoire
L’enseignement de la Révolution Française est à la fois fondé sur un récit et vu comme une éducation civique. C’est vraiment la « fabrique scolaire de l’histoire » à l’oeuvre : l’école produit des formes de savoir historique qui lui sont propres.
Le récit scolaire de la Révolution Française est à la fois complexe et contradictoire.
- Complexe : on doit concilier des impératifs de nature différente (différentes historiographies, différentes écritures de l’histoire…)
- contradictoire : il y a une commande institutionnelle pour les manuels scolaires, une commande idéologique, mais ce sont des éditeurs privés qui doivent dégager de la rentabilité.
Constructions identitaires et apprentissage d’une pensée historique : l’histoire scolaire en suisse romande et ailleurs
L’histoire, science humaine des temporalités, a pu se pratiquer de manières opposées et diverses :
- centrée sur la Nation et universaliste.
- ouverte sur le monde, à plusieurs entrées.
- nourrir des traditions inventées, pour aider à l’affirmation identitaire.
L’histoire suisse, tentée par le roman national et les mythes identitaires, veut oublier l’histoire critique , qui pourrait « déranger sa bonne conscience ».
L’histoire ne doit pas juste se satisfaire de la vraisemblance, mais être en quête de la vérité.
Quand l’enseignement de l’histoire met l’accent sur la dimension critique, le monde est rendu plus intelligible aux élèves et leur exercice de leur citoyenneté est et sera plus lucide.
L’histoire enseignée n’est pas l’histoire des chercheurs : elle est une reconstruction, modelée par des finalités, des injonctions. Elle donne naissance à une élevation des savoirs (et non à leur simplification, ou à leur abréviation). Il faut problématiser l’histoire.