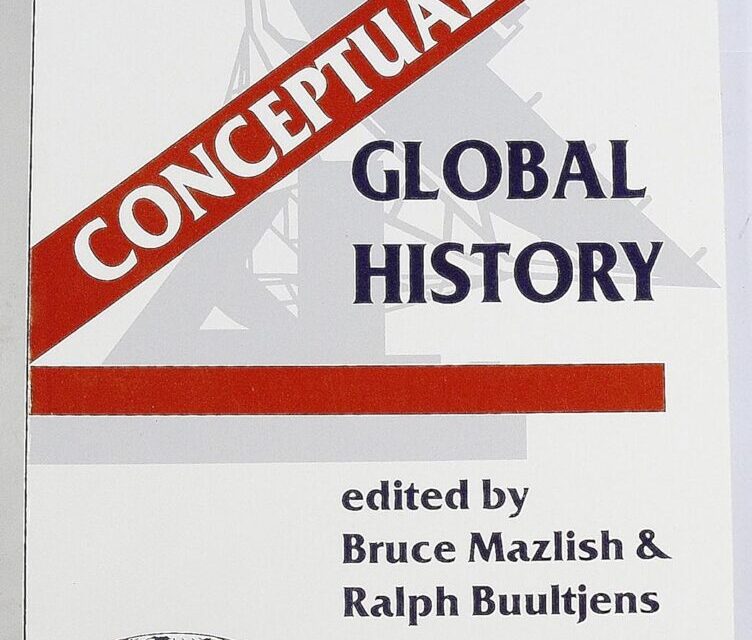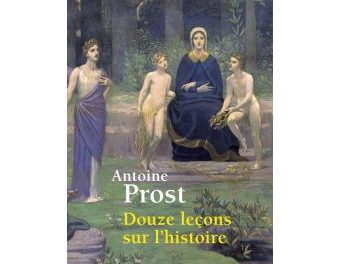La langue anglaise n’a qu’un mot pour désigner la « mondialisation » : Globalization. Pourtant, cette unité sémantique n’est pas sans nuances dans l’approche de l’histoire du monde : World History et Global History désignent deux méthodologies totalement différentes. Bruce Mazlish est l’un des historiens qui a le plus défendu la Global History plutôt que la World History, dans le cadre de la New Global History Initiative.
Plan de la fiche
I. Des premières réflexions à l’abandon des échelles
II. La globalisation définie comme une nouvelle période de l’histoire contemporaine et le global historian comme un nouveau type de chercheur interdisciplinaire
III. Les orientations possibles de la mondialisation à venir
IV. Bruce Mazlish et les critiques d’une conception protectionniste ou occidentaliste (et américaine) de la globalisation
I. Des premières réflexions à l’abandon des échelles
Dans les années 1970, les chocs pétroliers, les difficultés monétaires, les prophéties des écologistes et des militants anti-nucléaires, avaient provoqué un premier « choc du global » 1. Les interrogations sur le développement l’économie de marché et l’américanisation du monde ont accéléré la naissance de la Global History dans les universités californiennes et hawaïennes, puis dans l’ensemble des Etats-Unis et du monde anglo-saxon dans les années 1980. Mais c’est surtout la décennie 1990 qui a vu se développer la « nouvelle histoire globale » à Boston, grâce à l’investissement intellectuel de Bruce Mazlish.
Bruce Mazlish a fait carrière au Michigan Institute of Technology. A la fin des années 1980, les intellectuels américains entrevoient déjà la fin de la guerre froide et certains éprouvent le sentiment que les relations internationales sont en plein renouvellement. Alors que s’engagent les premières réflexions sur la globalisation et sur l’ère de l’Anthropocène, Bruce Mazlish démontre que la globalisation contemporaine représente une « transformation » (plutôt qu’une « révolution »), à la fois une véritable rupture et un Progrès, une nouvelle étape vers la modernité dont les hommes politiques n’ont pas encore pris conscience 2.
Dès 1989, Bruce Mazlish a réuni un petit groupe d’universitaires autour d’un projet de grande ampleur : la New Global History Initiative. Le groupe publie un ouvrage collectif : Conceptualizing Global History (Westview Press, 1993). Pour Bruce Mazlish qui rédige l’introduction de l’ouvrage, il est urgent d’abandonner les points de vue nationaux, régionaux ou locaux. Les historiens ont déjà perçu les traces d’un mouvement qui dépasse les frontières du Vieux Continent au XVe siècle, au XVIe siècle et au XIXe siècle. A la fin du XXe siècle, le même mouvement s’accélère. La mondialisation, puisque c’est de cela dont il s’agit, n’est donc pas un phénomène nouveau ; elle possède au contraire des traces dans le passé que le rôle des historiens est de mettre en évidence. Mais la mondialisation contemporaine s’accompagne d’un phénomène qui était inconnu des époques précédentes et qui doit donc engager une nouvelle réflexion sur le monde. La course à l’espace, l’envoi de satellites en orbite autour de la Terre, la « Destruction Mutuelle Assurée » par le risque nucléaire au cours de la guerre froide, les problèmes environnementaux, sont les signes d’une véritable représentation de la Terre comme d’un Monde partagé. Il faut favoriser une nouvelle perspective scientifique, une nouvelle conscience historique et un nouveau sous-domaine de l’histoire. La New Global History Initiative s’attache donc à mettre en évidence cette représentation présente de la « communauté globale » 3. Elle n’est donc ni eurocentrée, ni concentrée sur les frontières des Etats-nations, ni téléologique. En revanche, elle est positivement à la fois narrative et analytique, et doit, pour être efficace, être une science qui associe plusieurs disciplines entre elles.
« An Introduction to Global History » est un manifeste en faveur de la Global History, par opposition à la World History. Bruce Mazlish propose donc de passer de la World History à la Global History et définit l’objet de la Global History comme l’analyse de la naissance et de l’évolution de la « globalisation » plutôt que de la « mondialisation ». depuis les années 1970 ; avant cela, il n’y a qu’une « mondialisation ». Ce qui est dès lors intéressant, ce n’est pas la narration d’une histoire commune, partagée, synthétique et peu crédible de l’Humanité dans son ensemble : c’est le réseau de connexions qui relie un événement à des conséquences extérieures.
Dans The New Global History (Routledge, 2006) et Globalization and Transformation (Routledge, 2015), Bruce Mazlish fait le point sur l’évolution du monde depuis l’écriture du manifeste de la New Global History Initiative. Il s’appuie sur les réflexions d’Anthony Gerald Hopkins au début du siècle (Globalization in World History, Norton, 2002) et sur la définition que le grand historien britannique donne de la « globalisation » dans Global History : Interactions Between the Universal and the Local (MacMillan, 2006) : « globalization involves the extension, intensification and quickening velocity of flows of people, products and ideas that shape the world. It integrates regionds and continents ; it compresses time and space ; it prompts imitation and resistance. The result alter and may even transform relationships within and among states and societies across the globe ». Il s’appuie également sur les propositions de Peter Stearns dans Globalization in World History (Routledge, 2009) qui définit la globalisation comme « the process of transformation of local phenomena into global ones … a process by which the people of the world are unified into a single society and function together. This process is a combination of economic, technological, sociocultural and political forces, though globalization terminology is often used to focus primarily on economics – the integration of national economies into an international economy through trade, foreign direct investment, capital flows, migration, and the spread of technology ».
A la suite d’Anthony Gerald Hopkins et de Peter Stearns, Bruce Mazlish promeut donc une Nouvelle Histoire Globale. Il écrit que « in its simplest form, it is a theory about social relations, emphasizing that those relations, whatever their specific form, are becoming more widespread, with the parties to them more and more interconnected and interdependent in various ways. There is always a geographical dimension to this development as greater expansion into the world takes place ». L’évolution de l’Histoire au tournant des XXe et XXIe siècles démontre que le monde (d’abord bipolaire, puis unipolaire et à présent multipolaire), les civilisations et les structures ne fournissent plus une échelle d’analyse valide ; ce qui compte désormais, ce sont les connexions globales. Pour Bruce Mazlish, la Global History serait la meilleure manière d’étudier le monde de plus en plus interdépendant et interconnecté, et d’analyser la société forcément globalisée qui en est née.
Cependant, contrairement à d’autres historiens, Bruce Mazlish ne limite ni la modernisation ni la globalisation aux développements du capitalisme et des échanges économiques. Il énumère plusieurs « facteurs de globalisation » qui illustrent aussi bien les causes que les effets de l’interdépendance et de l’interconnectivité entre les sociétés. Selon lui, la décolonisation a engendré un éclatement spatial des centres de la planète, alors que la mondialisation économique a produit des possibilités d’influence élargie des firmes transnationales et des organisations non-gouvernementales. Il ajoute à ces trois facteurs le développement des communications, la simplification des migrations, la diffusion des cultures et des religions par internet, les progrès technologiques ou encore le renforcement des phénomènes diasporiques, pour mettre en évidence la connectedness du monde global.
Vous souhaitez lire la suite ?
Actifs dans le débat public sur l'enseignement de nos disciplines et de nos pratiques pédagogiques, nous cherchons à proposer des services multiples, à commencer par une maintenance professionnelle de nos sites. Votre cotisation est là pour nous permettre de fonctionner et nous vous en remercions.