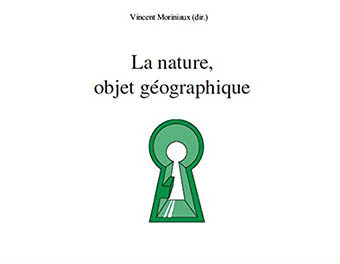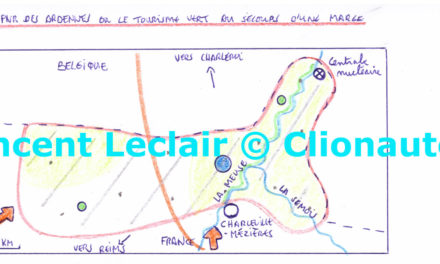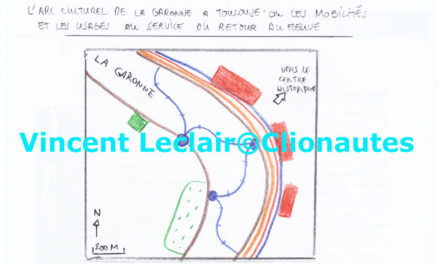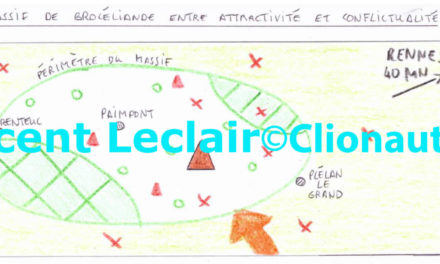Par Alexis Gavriloff, étudiant d’hypokhâgne AL au lycée Sainte-Marie de Neuilly
Après de longues années passées dans les ONG (Médecin sans frontières, Action contre la faim), Sylvie Brunel, géographe, économiste, écrivain, est professeur des universités en géographie à Paris IV- Sorbonne, où elle dirige un master consacré au développement durable.
Ses analyses des problèmes contemporains ont impulsé de nouvelles réflexions sur la faim (elle soutient que les ressources naturelles sont bien assez grandes pour l’humanité et que les famines sont liées à des échecs politiques) le développement durable (elle pense que l’homme n’est pas un parasite sur terre et que le développement durable est un paravent pour les pays du Nord, un prétexte pour justifier le protectionnisme et défendre leurs intérêts) et l’humanitaire (elle le quittera en dénonçant les dérives marchandes de certaines ONG).
Dans ce livre, Sylvie Brunel interroge le tourisme et ses effets sur les sociétés. La disneylandisation, c’est l’exotisation des mœurs, des coutumes et des vêtements locaux, pour en faire des digests aisément appropriables par l’industrie du tourisme. Elle est ambiguë parce qu’elle permet aussi à des cultures mourantes de retrouver une vitalité, une nouvelle identité et d’en rendre les possesseurs fiers, alors qu’ils n’avaient pas conscience de la valeur de ce qu’ils portaient.
Cette machine à niveler, qui incite les pays à se transformer en parcs d’attractions, est-elle souhaitable ou faut-il la rejeter catégoriquement ?
Pour répondre à cette question, l’auteur a réalisé un tour du monde avec sa famille afin de mener l’étude « sur le terrain » et de se confronter à la réalité du phénomène.
Le premier épisode de ce tour du monde a lieu en Nouvelle-Zélande, réputée pour sa nature imprévisible, sauvage, et dont la société, dit-on, a conservé le sens des coutumes et des traditions. En résumant ce voyage riche en surprises, nous verrons quelles idées en retire l’auteur.
La première excursion concerne la contemplation d’un geyser qui, « selon la brochure », jaillit tous les jours à 10h15. Le doute s’installe déjà : comment la nature peut-elle être d’une telle ponctualité ? Cette régularité intrigue. Et la légende de Rotorua, « l’île Fumante », capable de replonger ses visiteurs dans l’atmosphère des origines, est déjà remise en cause par ce geyser « particulièrement civilisé »… Appareil, programmateur : toutes les hypothèses sont faîtes, même si l’on a encore envie de croire au merveilleux. La perplexité des voyageurs révèle bien le phénomène de « mécanisation » de la culture, d’une main mise sur la nature et du contrôle plus ou moins réussi de ses activités. Les brochures et les agences de voyages sont les signes prémonitoires de cette disneylandisation : tout devient attraction.
La famille rejoint un « parc volcanique avec boutiques de souvenirs, cartes postales et cafés chauds ». La civilisation touristique déploie ses charmes tentateurs. Nous sommes loin d’un spectacle naturel en réalité : c’est une vraie mise en scène à laquelle on assiste. Des check points, des camionnettes et un homme en uniforme attestent bien que ce phénomène extraordinaire du geyser ne peut être admiré gratuitement. Les immenses parkings où se rangent les voitures et les campings montrent que le gouvernement a aménagé son territoire afin d’en rentabiliser un maximum le patrimoine : richesses de la nature sont susceptibles de devenir richesses économiques. Un amphithéâtre est déployé, les gens sortent leurs appareils photo et un présentateur clownesque « fait le show » : « Welcome to meet Lady Knox ! ». Ici on fait exploser les volcans sur commande. Un peu de sulfure et le tour est joué.
L’auteur remarque aussi avec justesse à quel point les touristes sont plus consommateurs que contemplateurs. « Trop de merveilleux à jet continu finit par lasser ». La consommation semble être pour eux le seul mode de tourisme et au bout de dix minutes ils ont tous levé le camp.
Atout touristique majeur, l’activité thermale est sujet à une réglementation légère de la part des autorités. L’esprit d’attractivité détruit les formes naturelles d’expression de la culture locale : on feint l’authenticité des villages maoris (reconstitué), des bijoux (fabriqués par de faux artisans), toutes les traditions sont revisitées par les compagnies d’accueil, la société du spectacle. On rivalise d’imagination pour attirer les visiteurs.
Tout en racontant ces péripéties révélatrices, Sylvie Brunel en profite pour rappeler le contexte de mondialisation économique qui implique nécessairement, semble-t-il, la recherche de sources économiques potentielles : « les vaches pourraient être sacrées, elles fournissent l’essentiel du PIB ». Par ailleurs, la visite du mont Eden témoigne de ce phénomène puissant : sanctuaire, terre sacrée, son sol est saccagé par les canettes et autres détritus… La mondialisation décharge ici ce qui l’encombre !
Ultime étape de ce voyage, la station de ski Whakapapa. La première impression (« les autocars ronflants empuantissent l’atmosphère de vapeurs de gas-oil ») révèle à quel point l’aménagement touristique empêche véritablement tout dépaysement ou découverte, l’auteur se croyant « à La Plagne ou à Chamonix ». Tout est standardisé selon des canons très occidentaux (l’hôtel notamment, qui n’a rien de typique), malgré une particularité : la station est bâtie sur un volcan ! L’auteur ironise sur le plan de sécurité peu rassurant : l’alerte d’une éruption se déclenche « plus d’une minute » avant l’apocalypse.
Ce premier chapitre est intéressant par plusieurs aspects. D’une part il fait le récit d’une vraie exploration géographique : à travers de nombreuses visites, Sylvie Brunel construit une analyse complète sur la réalité actuelle du pays.
D’autre part, cette analyse n’est pas catégorique et bien-pensante : l’auteur cherche avant tout à nous faire sentir la complexité de cette disneylandisation. L’identité maorie a beau être « feinte » ou « jouée », elle n’en ressort pas moins fortifiée, et la nature, bien que maltraitée à bien des égards, conserve ses droits et peut à tout instant enlever le vernis chatoyant que les hommes ont posé à la surface de ses activités féroces. Malgré les précautions prises, l’aménagement peut-être maladroit. L’encadrement touristique trop contraignant pourrait dès lors être, si on le désire, contourné. Il ne s’agit certes pas de faire la même expérience qu’Artaud avec les Tarahumaras, mais plus simplement de pouvoir admirer des paysages encore vierges (comme cette zone de marais fumants, par exemple, les forêts ou autres végétations inoccupées), et de profiter de certains recoins moins touchés par le tourbillon mondialisant. La décision nous appartient.
Alexis Gavriloff © Les Clionautes