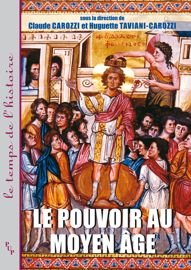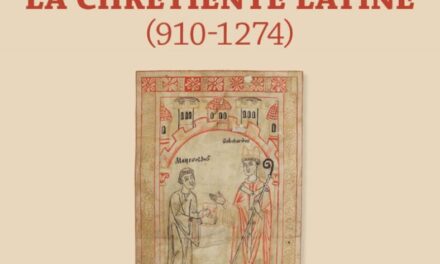Byzance évoque, au premier abord, une richesse éblouissante et un ordre hiérarchique stable, soumis à un empereur autocrate trônant au milieu de sa cour.C’est bien l’image que la propagande politique byzantine voulait diffuser aussi bien auprès des sujets de l’empereur qu’à l’extérieur de l’Empire. Aucun byzantiniste ne souscrirait à ce tableau idéalisé, même aux époques de grande prospérité économique et d’apogée territorial. En réalité, les pouvoirs du souverain étaient théoriquement limités par le respect des commandements divins, interdisant de sa part l’arbitraire et l’injustice. Plus prosaïquement, le système des communications restait rudimentaireet l’empereur n’était pas informé, avant un certain laps de temps, de la situation de provinces les plus éloignées de la capitale.
Vous souhaitez lire la suite ?
Actifs dans le débat public sur l'enseignement de nos disciplines et de nos pratiques pédagogiques, nous cherchons à proposer des services multiples, à commencer par une maintenance professionnelle de nos sites. Votre cotisation est là pour nous permettre de fonctionner et nous vous en remercions.
Les empereurs romains s’étaient appuyés sur le réseau des cités dont ils avaient hérité lors de la conquête et les corps municipaux servaient de relais entre l’autorité centrale et les populations locales. Les invasions slaves, avares, perses puis arabes au cours du VIIe siècle balayèrent ce réseau.Les souverains recherchèrent alors le soutien des aristocraties qui résidaient toujours dans les agglomérations fortifiées ou kastra, mieux protégées que le plat pays, et dominaient aussi le monde rural qui fournissait le gros des armées jusqu’au Xe siècle et qu’elles encadraient comme officiers.Ces principes valaient pour toutes les provinces de l’Empire, mais plus particulièrement pour les marges situées à la frontière dont les élites devaient être particulièrement choyées.
Pour étudier les méthodes dont usaient les autorités de Constantinople soucieuses de sauvegarder leurs territoires frontaliers, voire d’attirer les princes immédiatement voisins de leur Empire, nous disposons de sources diverses, à commencer par les récits des historiens, mais aussi d’une documentation spécifique : sceaux de plomb permettant de connaître les titres et les fonctions octroyés aux étrangers au service de Byzance ; textes plus techniques comme le De administrando imperio (ou DAI), manuel de politique étrangère à diffusion restreinte, puisque dédié, pour son instruction, à Romain II, le fils et héritier du basileus.
Les frontières de l’Empire
À l’époque protobyzantine, le limeshérité de la tradition romaine tardive constituait une vraie ligne de défense, même s’il formait en bien peu d’endroits une ligne continue, appuyée le plus souvent sur un obstacle naturel, tel le Danube dans les Balkans. La crise du VIIe siècle a bouleversé l’équilibre ancien, notamment en Orient, oùl’on assiste à la formation progressive d’un nouveau mode de vie frontalier. Les Arabes transformèrent un temps toute l’Asie Mineure en zone frontière, en ce sens qu’aucun des thèmes nouvellement formés n’était à l’abri d’un raid ennemi.
Après avoir failli, à deux reprises, emporter Constantinople, les Arabes furent finalement contenus pendant plus de deux siècles sur la barrière du Taurus. De part et d’autre de ce puissant massif,laissant un no man’s land entre les deux territoires, s’organise une société militaire qui élabore ses propres codes de valeur, son mode de vie spécifique, ses élites militaires.
Dans la seconde moitié du Xe siècle, le redressement byzantin et l’affaiblissement des émirats musulmans de la frontière– en premier lieu celui d’Alep, qui avait auparavant organisé la résistance aux Byzantins – conduisirent à une avance des Byzantins, qui repoussèrent la frontière orientale et lui redonnèrent une certaine continuité, car des troupes d’élite y furent stationnées en garnison.
On pourrait noter sur d’autres fronts les mêmes variations.Ainsi en Italie, quel contraste entre le milieu du IXe siècle, où Byzance s’accroche désespérément à quelques points d’appui menacés par les musulmans, et le début du XIe siècle, quand Boïôannès, le catépan envoyé par Basile II, réussit à étendre et unifier le territoire byzantin, faisant de l’Empire une puissance italienne.
Plus encore qu’une emprise territoriale, c’est le contrôle des hommes qui préoccupe les souverains, car l’Empire, à l’époque médiévale, s’est trouvé de ce point de vue en situation permanente d’infériorité face à ses adversaires musulmans. Or, du nombre des hommes dépendait presque mécaniquement la richesse de l’État et la force de ses armées. On ne peut, à Byzance, opposer de façon simpliste, les fidèles sujets du basileus aux étrangers qui échapperaient à toute influence du souverain.En effet, à l’intérieur même des provinces impériales, les minorités, ethniques et religieuses, peuvent constituer un facteur de contestation et d’affaiblissement du lien avec Constantinople. Il faut aussi prendre en compte la population flottante, mal intégrée aux réseaux sociaux.
La notion d’Empire transcende celle de peuple ou ethnos pour les Byzantins, qui qualifient d’ethnikos quiconque ne parle pas grec, sans concevoir vraiment une connotation péjorative.De fait, l’État byzantin a presque toujours rassemblé des populations non hellénophones, Slaves, Lombards, Arméniens… Pour qui voulait faire une carrière à Constantinople, ville cosmopolite par excellence, au sein des élites impériales, mieux valait s’helléniser, mais il est clair qu’un certain nombre de généraux d’origine étrangère ne sont jamais parvenus à manier correctement la langue grecque.
Fait de plus grande conséquence, le gouvernement impérial a reconnu que, dans certaines provinces de l’Empire, l’installation massive de populations étrangères avait changé la nature du lien qui unissait la province et la capitale. Il s’agit des Slaves qui, au cours des VIe-VIIe siècles, ont pénétré en masse à l’intérieur de la péninsule balkanique. Dans un premier temps, ils firent disparaître toute trace de la présence byzantine, dépeuplant ou détruisant les villes, faisant fuir les représentants de l’État et de l’Église.
Lors de la reprise en main des Balkans, Byzance a durablement laissé subsister ce qu’on appelait des sklavinies, c’est-à-dire un territoire peuplé de Slaves à l’intérieur d’une province byzantine, comme le Péloponnèse par exemple. Ces derniers conservaient leur autonomieet leur dépendance à l’égard de l’Empire se marquait par l’acceptation d’un gouverneur choisi par l’autorité centrale, le paiement d’une somme forfaitaire à titre d’impôt et la fourniture d’un contingent militaire en cas de réquisition. On pourra dès lors se demander ce qui distinguait une sklavinie, gouvernée par un archonte slave, d’une principauté située hors du territoire byzantin, dont le maître était classé au nombre des « amis » de l’empereur qui lui octroyait titres et argent.
Depuis que Théodose le Grand (379-395), rompant avec la tradition romaine d’acceptation des cultes les plus divers pourvu qu’ils ne s’attaquent pas à la personne de l’empereur, avait décidé que le christianisme serait la seule religion licite, les païens et les juifs avaient été rejetés dans une citoyenneté de seconde zone.Les juifs conservaient malgré tout leur liberté de culte sous condition de ne pas faire de prosélytisme.Lors de la formation de la doctrine orthodoxe et du déroulement des premiers conciles, à commencer par celui de Chalcédoine, une partie des chrétiens avaient été exclus de l’Église officielle, nestoriens et monophysites.Les premiers ne résidaient guère en terre d’Empire, mais les seconds étaient nombreux dans les provinces d’Orient. Plus grave pour l’avenir, l’Église arménienne, qui n’était pas présente à Chalcédoine, s’était séparée de Constantinople en se rangeant de fait dans le camp des monophysites, alors que les Géorgiens restèrent fidèles au patriarcat de Constantinople. Ainsi donc presque tous ces « hérétiques » habitaient aux frontières de l’Empire.
À côté de l’ethnikos, des textes byzantins mettent en scène – assez rarement – le xénos, mot que les dictionnaires invitent à traduire par étranger, interprétation acceptable si l’on prend garde de le distinguer de notre concept moderne. L’étranger se définit par son absence d’attache à un groupe – généralement une famille au sens large – même s’il est de même race ou de même foi.Les fondements d’une « famille », ce sont en effet les liens de solidarité censés unir ses différents membres, symbolisés par la vie en commun dans le palais du chef reconnu de ladite famille. Il faut retenir que l’isolement social fait l’étranger, car la société byzantine repose sur des réseaux de dépendance hiérarchisés, dont nul ne peut se permettre d’être exclu, ce qui justifie les efforts des nouveaux venus au sein des élites pour s’intégrer dans de tels cercles et offre aux empereurs un levier pour se les attacher.
Les marges de l’Empire ne se situent pas seulement à sa frontière physique, mais, dans une certaine mesure, passent par les hommes eux-mêmes, dont certains vivent à l’intérieur du territoire contrôlé par l’armée et le fisc impériaux, sans être de vrais sujets de l’empereur. En somme, l’opposition « intérieur/extérieur de l’Empire » ne suffit pas véritablement à définir l’attitude des populations à l’égard du souverain.L’influence du centre est différemment ressentie dans un espace qu’on peut répartir en cercles concentriques: Constantinople, dont les murailles forment une vraie frontière psychologique et sociologique, les provinces soumises à l’autorité impériale directe, les pays étrangers enfin.
Les Byzantins des Xe et XIe siècles distinguaient, parmi les provinces byzantines d’Asie Mineure, les vieux thèmes romains, c’est- à-dire ceux qui n’avaient cessé d’appartenir à l’Empire depuis l’époque romaine, desarménika thémata, c’est-à- dire les thèmes récemment reconquis sur les émirats arabes, largement peuplés d’Arméniens, ce qui justifie leur nom. Quant aux pays étrangers, une distribution analogue s’opérait entre les pays totalement indépendants de l’Empire et ceux dont les souverains étaient liés de quelque façon avec l’empereur de Constantinople.
Les rapports entre Constantinople, les arménika thémata et les princes liés à Byzance sont les plus intéressants de ce point de vue car ils étaient ambivalents. En effet, lors des deux grandes crises que connut l’Empire, celle du VIIe et celle du XIe siècle, les contemporains accusèrent les habitants des régions frontières, dont bon nombre étaient hétérodoxes, d’avoir trahi en facilitant la progression des ennemis, respectivement les Arabes puis les Turcs. Ces accusations ont été largement acceptées par les spécialistes contemporains, à tort, me semble-t-il, car il faut se garder de juger les événements en fonction de notre conception trop moderne de trahison par rapport à un État, alors qu’il s’agissait là, avant tout, d’une rupture des équilibres antérieurs entre ces populations et leurs attentes vis-à-vis du pouvoir central.
Les atouts de l’empereur : la force publique et le prestige des titres
L’armée et son rôle intégrateur
L’armée byzantine fut le principal instrument de domination étatique, fait qui n’a rien d’original.Durant les siècles de danger imminent (VIIe-Xe siècle) l’armée était dispersée sur tout le territoire et présente, y compris à Constantinople. Ensuite, dans la seconde moitié du Xe siècle, elle fut de plus en plus cantonnée aux frontières, selon une nouvelle stratégie d’ensemble, plus offensive dans un premier temps, avant une stabilisation sur des lignes jugées satisfaisantes par Constantinople au milieu du XIe siècle.
En réalité, des indices montrent qu’au XIe siècle les places fortes frontalières étaient rarement pourvues de garnisonspermanentes et on soupçonne que nombre d’entre elles n’étaient même pas entretenues. Ainsi le texte d’un traité concernant les forteresses établies à la frontière entre Byzance et l’émirat d’Alep contient des clauses sur les réparations à effectuer pour les maintenir en état. Les conditions locales, rappelons-le, notamment les tremblements de terre, exigent des réfections régulières.
Les empereurs ne doivent pas être accusés de négligence, mais l’option de l’emploi généralisé de la contrainte armée était tout simplement trop coûteuse, même à l’apogée de l’Empire, sous le règne des empereurs militaires. En clair, l’armée sert à repousser une attaque ennemie, à conquérir des territoires, mais pas à les tenir durablement.Quatre régions frontières, jugées sensibles, furent l’objet d’une attention particulière des empereurs aux Xe et XIe siècles : la Syrie du Nord, la frontière face aux émirs de Mésopotamie et aux archontes du Caucase, les Balkans du Nord-Ouest et enfin l’Italie.
Pour comprendre la façon dont ces différents facteurs ont été pris en compte, il suffit d’observer comment fut organisé le duché d’Antiocheaprès sa conquête par Nicéphore II Phocas (963-69). Une partie de l’armée byzantine, dont des unités d’élite, furent établies en garnison et servirent à défendre la province de Syrie contre les attaques des Fatimides d’Égypte, seule puissance musulmane alors capable de rivaliser avec l’Empire.
À deux reprises, en 995 et 999, les forces d’Antioche révélèrent leur insuffisance, et l’empereur Basile II vint en personne rétablir la situation. En l’absence de conflit majeur, le duc d’Antioche n’avait d’autre charge que de contrôler les pillages des tribus bédouines et de surveiller les émirs d’Alep, qui ne constituaient plus une menace militaire sérieuse. Pour le reste, il fallait gouverner une province riche, peuplée en majorité d’habitants qui n’étaient pas grecsmême si à Antioche, vraisemblablement, la proportion de Grecs augmenta au cours du siècle de présence byzantine. Les chalcédoniens ou melkites n’étaient sans doute pas majoritaires, quoiqu’une telle affirmation paraisse toujours imprudente, faute de textes précis sur ce point. Il semble toutefois qu’au temps de la domination musulmane, l’Église jacobite avait été la principale bénéficiaire de la dhimma. De plus, après la reconquête, une partie des troupes établies en garnison était constituée d’infanterie arménienne, au point que de nouveaux évêchés avaient été créés pour eux.
Cependant il restait une église melkite disposant d’un dense réseau d’évêchés sous l’autorité du patriarche chalcédonien d’Antioche. Le patriarcat melkite fut également placé sous le contrôle strict de l’empereur et de l’Église de Constantinople. Sans doute, lors d’une grave rébellion en Anatolie, Basile II (976-1025) avait accepté la nomination d’un évêque syrien, Agapios. Ensuite Constantinople verrouilla les nominations.Certes, Pierre III était syrien, mais avant s’être promu patriarche en 1052, il occupait la charge de chartophylax de Sainte-Sophie.
En revanche, l’empereur confiait plus facilement à des locaux certains postes civils, du moins pendant les premières décennies de la souveraineté byzantine. Ainsi les noms de Kouleib et d’Ubaid allah sont à relever parmi les gestionnaires des finances publiques. Il arrivait que le duc ou catépan fût prêt à céder une forteresse à un chef local pour défendre la frontière.
L’exemple le plus connu, parce qu’il fut un échec pour le catépan, est celui d’ibn Mousaraf. Ce dernier avait demandé le droit d’élever une forteresse dans le djébel, au sud du duché et il avait reçu un document officiel lui donnant l’autorisation attendue, car il avait avancé pour prétexte que cette place défendrait le territoire du duché contre l’émir de Tripoli. Fait remarquable, l’administration veillait à ce que des ouvrages fortifiés ne fussent pas élevés sans son autorisation. À Mousaraf avait été octroyée, comme en témoigne son sceau qu’on a conservé, la haute dignité de patrice et ajoutons que, même s’il place son sceau sous la protection de saint Georges, il ne s’était sûrement pas converti au christianisme.
Si l’on prend en compte le personnel subalterne en poste dans tous ces thèmes, on note que les autochtones en fournissent une grande part. Aussi bien des inscriptions provenant d’Ani, l’ancienne capitale des rois bagratides d’Arménie, que les documents d’archives d’Italie montrent que les subordonnés du catépan ou duc étaient issus de la population locale. Byzance cherche manifestement à associer les élites locales à l’administration des provinces frontières.
En cas de crise grave, lorsque l’Empire se trouvait menacé sur ses marges, sans avoir les moyens d’envoyer des secours militaires suffisants, le gouvernement impérial choisissait de s’appuyer sur un membre de l’élite locale auquel il déléguait son pouvoir et qu’il liait fortement à l’Empire par l’octroi de titres auliques, non sans s’assurer aussi de sa famille dont les membres étaient envoyés dans la capitale où ils recevaient des honneurs, mais pouvaient aussi être considérés comme des otages.
Même après leur expulsion par les Normands, les Byzantins voulurent récupérer leur base italienne en tentant d’intégrer Robert Guiscard dans le système administratif byzantin.Les autorités byzantines agirent de même en Syrie où, à Antioche et en Cilicie et plus généralement le long de la frontière orientale, elles nommèrent des Géorgiens ou des Arméniens chalcédoniens aussi bien que monophysites : Grégoire Pakourianos, Philarète Brachamios, Grégoire Magistros, Apelgharib de Tarse, Kakikios, l’ancien roi d’Ani. L’Empire attend en effet de ces notables qu’ils mettent à son service leurs réseaux de parents, de serviteurs et de dépendants.Le plus souvent, ce calcul fut couronné de succès, à l’exception notable du normand Robert Guiscard.
L’octroi des titres
Michel Psellos, fin connaisseur de la cour et du jeu diplomatique, affirmait que la force de Byzance tenait à sa richesse et au prestige de ses titres.Les titres, rappelons- le, donnaient droit en principe au versement d’une rogaannuelle, qui constituait un revenu appréciable pour les bénéficiaires. Les Byzantins ont constamment utilisé la distribution de titres comme instrument de leur politique étrangère.
Parmi les régions de l’Empire proches des frontières, la plus riche en informations est incontestablement l’Italie byzantine. À lire les documents d’archives, nombreux étaient ceux qui jouissaient de dignités d’un niveau élevé à cette époque : bien des fonctionnaires modestes étaient honorés, dans la première moitié du XIe siècle, de la dignité de protospathaire, titre qui donnait en principe accès au Sénat et qui, ailleurs dans l’Empire, en particulier à Constantinople, était conféré à des fonctionnaires exerçant de hautes responsabilités, même si la dignité commençait déjà à se dévaluer. Les autorités visaient ainsi à se constituer une clientèle de fidèles pour tenir le reste du peuple.
Si l’on franchit la frontière, le niveau des honneurs offerts aux étrangers que les empereurs voulaient séduire et intégrer à plus ou moins court terme au système byzantin, montre qu’ils bénéficiaient d’une sorte de prime, en recevant des dignités– assorties sans doute des rogai très élevées qui les accompagnaient, supérieures aux titres que des Byzantins de niveau social équivalent auraient obtenus. C’est une vieille tradition, qui se vérifie à l’égard des princes du Caucase.Cette région a été disputée par les Byzantins aux Perses, puis aux Arabes, car la puissance qui la détenait s’ouvrait la route de la Mésopotamie, si Byzance prédominait, ou bien celle du plateau anatolien, si c’était son l’adversaire.
Ainsi très tôt, le prince que Byzance désignait comme le meilleur représentant de ses intérêts obtint la dignité de curopalate. Or cette dignité, octroyée à titre exceptionnel à un sujet du basileus, fut, de fait, réservée jusqu’au XIe siècle aux membres de la famille impériale. La conférer à un archonte arménien ou géorgien invitait à le considérer comme un membre de la famille impérialeet lui donnait un prestige sans égal vis-à-vis non seulement de ses propres dépendants, mais aussi des princes rivaux.
En revanche, les étrangers qui venaient se mettre au service de l’Empire, le plus souvent comme officiers dans l’armée,obtenaient des dignités plutôt inférieures à celles qu’ils auraient reçues s’ils avaient été Byzantins de souche. Kékauménos (aristocrate byzantin, fin XIe) déplore la fin de cette politique prudente, lorsque les empereurs de son temps, dans la seconde moitié du XIe siècle, se sont mis à brader les dignités à des étrangersqui, en conséquence, nous dit-il, ont méprisé les Romains.
En réalité, cette générosité impériale s’explique par la crise militaire que connaît alors l’Empire et qui implique de s’attacher plus solidement encore les ethnikoi.Au XIIe siècle, la même conjoncture entraîna un apport massif d’étrangers et engendra des critiques identiques sur les revenus excessifs alloués aux nouvelles recrues. La survalorisation des étrangers est perceptible aussi en Occident, comme le montre la progression des dignités accordées au doge de Venise.
De plus, elle permet de suivre de façon remarquable la dévaluation des dignités byzantines au XIe siècle, et elle atteste aussi qu’à Venise on était au fait de l’évolution de la hiérarchie. À partir du VIIIe siècle, les premiers doges furent hypatoi, ou parfois spathaires. Les empereurs macédoniens améliorèrent l’honneur en conférant le protospatharat puis, au cours du XIe siècle, les doges devinrent successivement patrices, magistres, protoproèdres, puis finalement, par le fameux chrysobulle d’Alexis Ier en 1082, protosébastes.Cette faveur était encore augmentée, car la dignité, innovation spectaculaire, était automatiquement transmise au doge choisi par les Vénitiens, ce qui dérogeait au principe de la liberté complète du choix impérial.Une certaine ambiguïté caractérise ces relations : pour les Vénitiens, il ne s’agissait que d’une alliance, alors que les Byzantins considéraient ceux-ci, peut-être sans trop y croire, comme des sujets de l’empereur. Car la dignité octroyée au doge en 1082 le plaçait au rang de proche parent du souverain, puisque les titres de sébaste ou des termes composés n’étaient attribués sous les premiers Comnène qu’à un parent du basileus, du moins à l’intérieur de l’Empire.
Sans quitter l’Italie, évoquons le cas de Robert Guiscardqui conclut un accord avec Michel VII (1071-1078) et reçut un chrysobulle de confirmationpar lequel Robert, reconnu duc de Pouille, était honoré de la dignité de nobélissime et recevait un certain nombre de dignités, mais, fait extraordinaire, l’empereur lui accordait le droit de les offrir en son nom à ceux de ses fidèles qu’il désignerait. Une fois de plus, on voit à l’œuvre le système byzantin qui vise à conforter ceux qu’il a choisis comme alliés et à leur donner les moyens de l’emporter sur d’éventuels rivaux.Le message est clair, qui a le soutien de Byzance sera le maître.
Une incertitude subsiste sur le paiement effectif de la roga.En ce qui concerne Guiscard, le doute n’est pas permis car le chrysobulle précisait le montant global annuel, qui constituait en fait une forme élégante du versement d’un tribut. Mais il est établi que, parfois, la roga due n’était pas versée. D’une façon plus générale, l’État a connu des moments de crise financière et de pénurie aiguë de numéraire.
La limite est donc vraiment ténue entre les étrangers auxquels l’Empire confiait parfois le gouvernement des marches frontières et les princes locaux établis juste de l’autre côté, objets de toute l’attention des basileis.L’Empire n’était cependant pas toujours gagnant et certains émirs réussirent à surprendre un stratège voisin et enlever sa forteresse. D’autre part, les souverains devaient traiter avec ménagement les stratèges des frontières qui, nous l’avons vu, étaient largement issus de l’aristocratie locale et fiers de leur race. Les exemples abondent où des stratèges, accusés à tort ou à raison de comploter contre l’empereur, passèrent à l’ennemi avec leurs partisans.
Le facteur religieux
Les régions frontières étaient souvent peuplées d’hérétiques, du moins en Orient car, en Occident, coexistaient en Italie l’Église latine et l’Église grecque, qui, opposées sur les rites, ne s’accusaient pas d’hérésie, même après le schisme de 1054.
Les principes de la politique religieuse des empereurs sont assez figés :ils acceptent de fait l’existence des communautés non orthodoxes et, à l’occasion, y puisent des serviteurs, tout en favorisant le clergé chalcédonien, dès qu’ils le peuvent. G. Dagron, dans son article sur l’immigration syrienne, a montré de manière convaincante l’évolution de la stratégie impériale pour cette région au cours des Xe-XIe siècles. Dans un premier temps, après la reconquête, Nicéphore Phocas s’était efforcé d’inciter les chrétiens monophysites à s’établir dans les territoires repris aux Arabes, car les nouvelles provinces s’étaient vidées de la majeure partie de leurs habitants musulmans, qui par la mort, la captivité, ou la fuite.
Pour remédier à cette perte, la population des vieux thèmes d’Anatolie n’était pas si abondante qu’elle ait pu fournir les effectifs souhaités. C’est pourquoi Nicéphore fit venir des monophysites encore sous la domination musulmane.Lui-même et ses successeurs laissèrent l’Église jacobite fonder de nouveaux évêchés pour les fidèles qui avaient émigré dans le duché d’Antioche ou la Cilicie voisine, liberté qu’illustrent la création de nouveaux évêchés et une floraison monastique remarquable.
À partir de Romain III Argyros, les empereurs, plus assurés de leur domination sur ces régions ou encore soucieux d’affirmer leur orthodoxie à Constantinopleoù leur pouvoir pouvait être fragile, reprirent l’attitude traditionnelle de leurs lointains prédécesseurs, qui souhaitaient faire de l’Empire un ensemble homogène, par l’hellénisation et la réduction des dissidences religieuses. C’est ainsi qu’en Orient les jacobites furent inquiétés. Parfois il s’agissait d’une initiative locale : un métropolite de Mélitène (Anatolie) combattit avec passion les monophysites de sa circonscription, mais il n’obtint même pas le soutien des autorités civiles. En réalité, les rapports ne furent qu’assez brièvement conflictuels et, en cas de besoin, les empereurs firent appel à des chefs arméniens, attachés à leur religion nationale, pour sauver les provinces.
La carrière de l’ancien roi d’Ani, Gagik II, est à cet égard caractéristique. C’est bien à contrecœur qu’il avait quitté son pays pour vivre en Cappadoce, mais il obtint finalement des dignités et même un poste de stratège de thème, sans doute dans les années 1070. Les empereurs s’efforcèrent clairement de le rallier à la cause de l’Empire. Gagik était toujours regardé, même après la perte de son royaume, comme le chef de la communauté arménienne en exil et il conservait la prééminence sur les autres princes, notamment les descendants du roi du Vaspourakan, qui se refusaient à agir sans l’avis de Gagik. Dès lors, s’assurer la fidélité de Gagik, c’était entraîner la communauté arménienne derrière soi, quelque divisée qu’elle fût par ailleurs.
Il est vrai qu’en règle générale, Byzance favorisa ceux qui partageaient la foi de Constantinople, les chrétiens chalcédoniens.Si un jeune étranger aspirait à une brillante carrière, il valait mieux pour lui adopter le chalcédonisme. Toutefois, ce serait une erreur de croire que cette règle fut toujours strictement appliquée.Si le besoin s’en faisait sentir, nous l’avons vu, les chrétiens non chalcédoniens obtenaient de hautes charges militaires. Ajoutons qu’à l’égard des Latins, le schisme de 1054 n’a eu strictement aucune conséquence.Jamais les grands commandements ne leur manquèrent et ils obtinrent, pour les plus valeureux, la main de princesses impériales. Ne pas être chrétien, et choisir de rester païen ou bien adepte de la foi musulmane, n’interdisait pas d’accéder au service de l’empereur.
Conclusion
Le bilan de cette politique fut positif jusqu’au dernier quart du XIIe siècle, puisque Manuel Comnène était encore capable de se créer une vaste clientèle en Italie et en Orient.Il peut même se vanter de contrôler à nouveau l’Anatolie, puisque, par un mélange de séduction et de pression militaire, il a su inciter le sultan seldjoukide, l’émir danishmendide, mais aussi les princes arméniens à se reconnaître comme ses douloi.Profonde illusion, que la campagne de Myrioképhalon se chargea de dissiper.La pire conséquence de cette bataille n’est pas d’ordre militaire, car elle fut coûteuse pour les deux camps, mais se situe sur un plan psychologique, car elle a, à terme, ruiné l’attraction exercée par Constantinople sur les confins de l’Empire.
Le bon contrôle des marges a déterminé l’attractivité de l’Empire et partant sa prospérité politique.En dépit des coups subis au VIIe siècle, l’Empire redevint assez vite capable d’attirer dans son camp de nombreux chefs étrangers qui souhaitèrent appartenir au groupe des alliés de l’empereur, voire entrer à son service et devenir leurs sujets comme les Byzantins de souche. Ce ralliement de nombreux nobles arméniens et archontes slaves a contribué au moins autant que les victoires militaires à l’expansion de l’Empire aux Xe-XIe siècles, car le mouvement s’est accéléré lorsque l’adversaire traditionnel, le califat abbasside, s’est lui-même affaibli et a donc perdu son propre pouvoir de séduction.
À l’inverse lorsque, en Italie, la croissance économique a enrichi les villes marchandes, les avantages économiques et les valeurs symboliques qu’offrait Byzance ont moins attiré de clients dès la fin du XIIe siècle, compromettant toute la politique occidentale des Comnène et des Ange.Mais l’échec fut le plus patent à l’égard des Turcs de la seconde vague d’invasion.Alors que des chefs arabes avaient été nombreux à accepter et même rechercher les subsides et les titres impériaux, sans qu’ait été exigée de leur part une conversion au christianisme,Byzance fut incapable d’obtenir les mêmes succès auprès des émirs turcs.