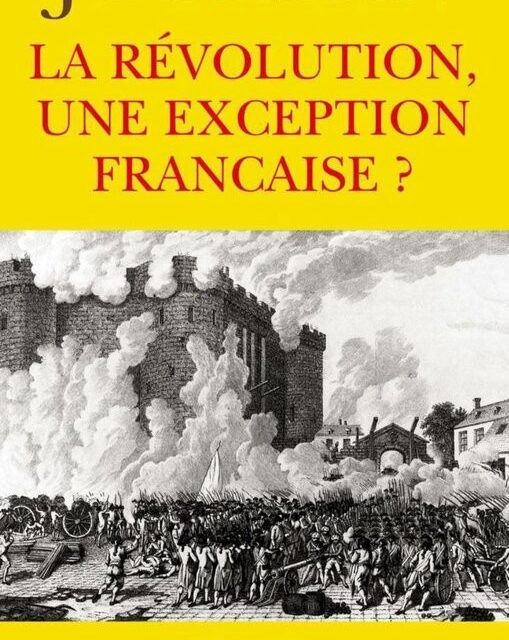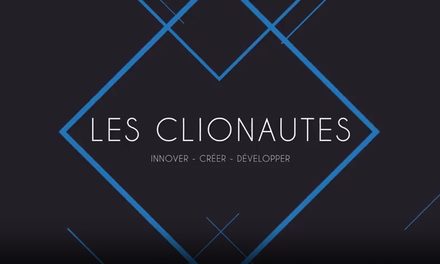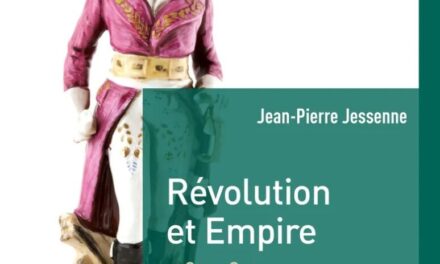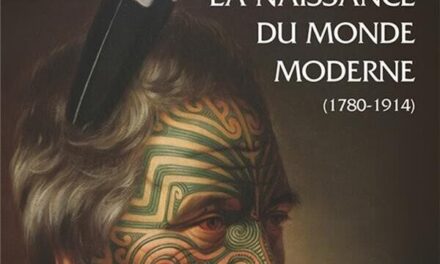Une sélection de chapitres de l’ouvrage d’Annie Jourdan qui cible particulièrement les exemples des « républiques sœurs » de la République française en Révolution et de la République américaine. La lecture de ces lignes s’intègre dans la question d’agrégation interne et montre que la Révolution n’est pas une exception qui n’affecterait que la France à la fin du XVIIIe siècle.
Introduction : un évènement fondateur
1789 comme lieu de mémoire de la DDHC. Les querelles entre contre-révolutionnaires et révolutionnaires semblent terminées depuis 1945. Encore des dissonances dans l’unanimité du bicentenaire venant des nostalgiques de l’Ancien Régime ou des communistes attachés à l’épopée de l’an II.
Au XIX les libéraux et républicains modérés célébraient la liberté de 1789, les socialistes et radicaux célébraient 1793 et la république sociale. Puis les marxistes : la dictature populaire de 1793 préfigurait celle du prolétariat. A partir des années 1970 : les révisionnistes mettent en avant les facteurs idéologiques et minorent les facteurs sociaux et éco. = la Terreur serait en germe dès 1789 à cause de l’idéologie de la volonté générale. Certains y voient une préfiguration des horreurs totalitaires, une Révolution synonyme de sang voire de génocide.
L’histoire politique des années 1980 focalisée sur les représentations et les discours a tendance à voir « d’en haut » et néglige les expériences des populations. Antoine de Baecque conseille en 1991 de concilier les approches culturelle (Vovelle) et les approches politiques (Furet).
N’en demeure pas moins qu’il reste de très nombreux questionnements à éclairer à l’aune de nouveaux travaux = le vécu quotidien, les cadres de vie transformés, les expressions culturelles et artistiques, l’émergence d’une culture démocratique…
Il s’agit aussi de recenser les réalisations effectives de la Révolution et leurs conséquences au-delà des violences de la Terreur (sans les occulter) qui furent un épouvantail souvent brandit au XIX. Il est nécessaire de suivre la révolution après la Terreur, importance de l’histoire du directoire où s’élabore un État républicain autoritaire mais soucieux de garantir les acquis de 1789 et qui multiplie les contacts avec les peuples voisins.
La Révolution devient supranationale notamment via la guerre. Comprendre les réceptions de la révolution française par des patrimoines étrangers non dénués de principes et de lumières. L’historien européen doit défaire les poncifs sur l’influence universelle de la révolution française = originalité des républiques sœurs, inclure l’histoire de la révolution dans celle des voisins, avoir une relation critique au passé national, ne pas négliger les interactions et les échanges, étudier la mobilité des hommes des Lumières et l’entourage cosmopolite des Mirabeau, La Fayette, Brissot ou La Rochefoucauld.
L’Amérique a la première donné le signal révolutionnaire. La République des Provinces-Unies avait pris le relais. En France, l’aristocratie libérale et Louis XVI ont soutenu les deux. Ne pas oublier les révolutions anglaises du XVII.
Le qualificatif « révolution » n’est-il attribuable qu’à la France ? S’interroger sur le terme et quitter l’exception française. Nécessité aussi d’une approche comparative pour confronter des évènements et distinguer des originalités et interroger les transferts culturels.
Il ne s’agit pas de rabaisser artificiellement l’influence de la révolution française mais plutôt de ne pas nier les expériences, les spécificités et les apports des autres pays.
Première Partie : La Révolution française
Chapitre 4 : la Révolution française et l’Europe
22 mai 1790 = la Constituante renonce à entreprendre des guerres en vue de faire des conquêtes et n’emploiera pas la force contre la liberté des peuples (devient le titre VI de la Constitution de 1791).
Deux ans plus tard, Louis XVI déclare la guerre à François II roi de Bohème et de Hongrie, déclaration souhaitée et ratifiée par l’Assemblée nationale.
L’Europe de l’Ancien Régime
En 1789, l’Autriche est préoccupée par les soulèvements de ses États : Belgique, Bohème, Hongrie, Galicie voire Tyrol contre les réformes imposées par Joseph II. + mauvaises récoltes et menaces ottomanes. Léopold II fait preuve de plus de souplesse.
La Grande-Bretagne se remet de sa guerre contre ses anciennes colonies américaines et leurs alliés français et espagnols.
Prusse et Russie rèvent d’expansion. Partage de la Pologne en1772. La Russie est en guerre contre la Suède et la Turquie et rêve d’un nouvel empire byzantin.
L’Autriche se méfie de la Prusse et de la Russie. L’Autriche devient antipathique à l’Angleterre qui refuse le projet d’échange de la Belgique (Pays-Bas autrichiens) contre la Bavière. L’Angleterre craint l’indépendance de la Belgique ou qu’Anvers puisse faire concurrence aux Provinces-Unies allées de la Grande-Bretagne.
Un équilibre fragile
L’équilibre de l’Europe d’Ancien Régime est fragile. Seules la Russie et la Grande-Bretagne profitent d’une position géographique qui les protège.
Les pays continentaux cherchent l’alliance russe. Léopold II protège la Pologne comme intermédiaire aux expansionnisme prussien et russe.
La France a souvent noué des alliances avec Suède, Prusse ou Turquie pour acquérir des monopoles commerciaux. Alliée avec l’Autriche et l’Espagne pour mener la guerre de Sept Ans. Conséquences de la guerre : la France a perdu une partie de ses colonies et la GB maîtrise les mers.
A la veille de la Révolution : France et Autriche sont affaiblies et se méfient l’une de l’autre, GB malgré sa défaite en Amérique a la suprématie sur mer. La Russie prospère et la Prusse est prudente.
La règle diplomatique qui prévaut alors : compensation et indemnité territoriale au profit de ses allis en cas de conquête victorieuse d’un État. Souci de l’équilibre des puissances (au détriment des nations/peuples).
Affaire de Nootka : en 1789, des commerçant britanniques sont arrêtés par des vaisseaux espagnols sur la cote de Vancouver. L’Espagne revendique le monopole de la cote pacifique. L’Espagne doit se soumettre et enrage contre la France qui ne lui vient pas en aide. A l’été 1790, la France commence à contester le pacte de famille entre les Bourbons d’Europe signé en 1761.
Une réception modérée
Pour limiter la puissance maritime anglaise, la Russie a lancé en 1780 une ligue des neutres. En retour, l’Angleterre scelle en 1788 la Triple-Entente : GB, Prusse et Provinces-Unies. Cette entente ne dure pas.
La Prusse est déçue par l’Angleterre qui ne veut pas soutenir les révolutionnaires belges afin de créer un État indépendant soustrait à l’influence autrichienne. La Prusse se tourne vers l’autriche en 1791. Cette nouvelle alliance Autriche-Prusse permet de soutenir la Pologne (qui vient d’achever sa Constitution de mai 1791) contre l’expansion Russe et se réjouit de la perte de puissance de Louis XVI. La déclaration austro-prussienne de Pillnitz en aout 1791 appelle à une alliance générale pour soutenir Louis XVI mais elle n’est pas (encore) belliqueuse car Léopold est prudent et plutôt satisfait de la monarchie constitutionnelle française (ce qui enrage le comte d’Artois qui veut une intervention rapide).
La Grande-Bretagne se réjouit aussi de la monarchie constitutionnelle française qui y voit une Glorious Revolution à la française dont on fête le centenaire. Les Whigs sont divisés après la publication de « sur la révolution de France » d’Edmund Burke mais les radicaux soutiennent la monarchie constitutionnelle française et le gouvernement mène une politique pacifique.
Seules la Suède, l’Espagne et la Russie s’opposent à la nouvelle monarchie (et encore la Russie visent une stratégie d’affrontement afin de justifier une attaque contre la Pologne révolutionnaire…)
Donc en mai 1790 lorsque la Constituante renonce à la guerre, il n’y a pas de réelle menace.
La Révolution en Europe
Les premières réunions
Le discours de Brissot le 20 octobre 1791 est moins un appel à la guerre qu’une interrogation sur le danger des émigrés. En Octobre 1791, les départs augmentent à vive allure (2000 officiers quittent soudainement la France). Est-ce par crainte ou un plan fomenté par l’Autriche ? Léopold est en fait concentré sur le cas belge et pour mener la répression les troupes autrichiennes passent par le nord de la France avec l’accord de l’assemblée…
Vous souhaitez lire la suite ?
Actifs dans le débat public sur l'enseignement de nos disciplines et de nos pratiques pédagogiques, nous cherchons à proposer des services multiples, à commencer par une maintenance professionnelle de nos sites. Votre cotisation est là pour nous permettre de fonctionner et nous vous en remercions.