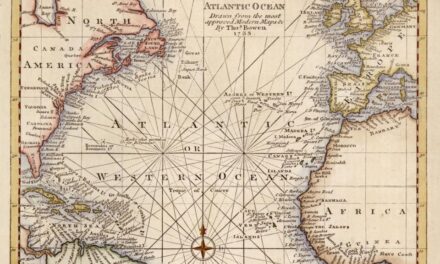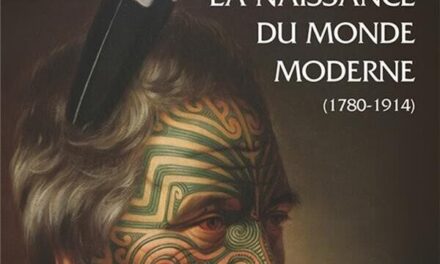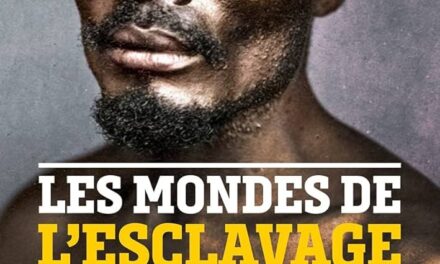Mémoire d’HDR de Marc Bélissa portant sur la révolution américaine intégrée à l’Atlantic History et à l’étude d’un trickster: La Fayette.
Définition de l’Atlantic History et jalons historiographiques
L’Atlantic History n’est pas une nouveauté. Elle est déjà mise en action par Fernand Braudel et par Pierre Chaunu dans les années 1960 et 1970, avant d’être délaissée en France ; elle est aussi une héritière des travaux de Jacques Godechot et de Robert Palmer dans les années 1950. Le point de départ de ces deux historiens, en 1955, a été reformulé 5 ans plus tard par Jacques Godechot dans un article de la revue L’information historique : « La Révolution française qu’on fait traditionnellement commencer en 1789 est-elle un phénomène proprement français ? Ou bien ne forme-t-elle qu’un aspect, qu’une phase d’une révolution plus vaste qui a touché la plupart des Etats de l’Occident, et a même quelque peu débordé sur l’Europe orientale ? ». En 2004, Annie Jourdan reprend cette question dans La Révolution, une exception française ? La même année, Laurent Dubois a publié Avengers of the New World: The Story of the Haitian Revolution. Les riches travaux de Wim Klooster sont orientés dans la même direction.
L’historiographie française de la Révolution des années 1960 à la fin des années 1970 s’est très peu intéressée à la perspective ouverte par Godechot et Palmer. Ce n’est que depuis la fin des années 80 que le balancier historiographique est revenu vers la perspective de la Révolution française comme moment d’une vague révolutionnaire quasi mondiale.
Pour Marc Bélissa, l’Atlantic History, c’est simplement « un paradigme interprétatif des transformations économiques, sociales, politiques et culturelles des quatre continents qui bordent l’océan Atlantique à l’époque moderne ». C’est la méthode épistémologique qui explique le mieux la rencontre entre l’Ancien et le Nouveau Monde et les conséquences de cette rencontre. L’échelle la plus pertinente étant celle d’un « système régional » et non plus de « systèmes nationaux » ou de « systèmes impériaux », il convient de parler d’une « histoire atlantique ». Les espaces considérés sont alors intégrés dans une approche globale à l’échelle des empires et de leurs relations réciproques. Cela compose un « tout » systémique qui s’analyse au travers de ses connexions et des circulations entre les espaces.
Depuis 40 ans, l’historiographie (surtout anglo-saxonne) s’est intéressée aux conséquences diplomatiques, militaires et culturelles de la Révolution, un événement qui dépasse largement les frontières de la France de 1789. De plus, longtemps ignorée, l’histoire des mouvements révolutionnaires des esclaves dans les îles sucrières des Antilles a été entièrement renouvelée ces dernières années. « On a largement réévalué l’importance de la question coloniale dans le déroulement de la Révolution française mais aussi les conséquences des mouvements révolutionnaires des Antilles dans l’évolution économique, politique et sociale des Amériques et même des colonies africaines et asiatiques des puissances européennes ». Cette histoire prend aujourd’hui une dimension « globale », comme l’ont montré deux ouvrages collectifs récents : le premier dirigé par David Armitage, Sanjay Subrahmanyam et Gary Nash en 2010 s’intitule The Age of Revolutions in Global Context, c. 1760-1840, le second dirigé par Suzanne Desan, Lynn Hunt et William Max Nelson en 2013 s’intitule The French Revolution in Global Context.
Aujourd’hui, la dimension « atlantique » des révolutions américaine, française et haïtienne se présente sous 3 aspects principaux :
- La Révolution américaine a été le premier exemple de l’indépendance d’une colonie par rapport à sa métropole. L’onde de choc de la Révolution française, quant à elle, impulse un « souffle de liberté » (Bayly) qui se propage aux Etats européens et radicalise l’opinion. Cette radicalisation de l’opinion entre « partis » à la Convention nationale (Montagnards, Girondins…) engendre aux Etats-Unis un « effet-retour » qui contribue à la création du système bi-partisan américain.
- La Révolution française et les guerres à partir de 1792 renversent les équilibres entre les empires coloniaux européens. Cela affecte donc les circulations des hommes et des marchandises dans l’Atlantique, à l’intérieur des systèmes impériaux mais aussi entre les empires rivaux.
- Les Antilles, en tant qu’interface entre ces différents empires coloniaux, sont particulièrement touchées par les conséquences des deux premières révolutions (américaine et française) et cela crée des mouvements révolutionnaires locaux qui s’ajoutent aux précédents. La Révolution de Saint-Domingue aboutit à la création de la première République noire à Haïti en 1804. La création de Sociétés des Amis des Noirs en Grande-Bretagne et en France donne une impulsion décisive aux mouvements émancipateurs des Caraïbes.
La révolution américaine
Les historiens s’accordent aujourd’hui pour dire que les événements qui se déroulent en Amérique du Nord de 1763 à 1787 peuvent être appelés « Révolution ». Il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’un bouleversement politique d’ampleur, non seulement pour les Treize colonies d’Amérique, mais aussi pour l’Europe : à travers l’océan Atlantique s’est exposé un « modèle » réinterprété dans la plupart des mouvements révolutionnaires de la période suivante.
La Révolution américaine a son propre point de départ, son étincelle : la lutte entre les colons et la métropole britannique au sujet de questions essentiellement fiscales. Mais les enjeux sont aussi plus larges, et cela rend l’événement comparable à d’autres révolutions dans le monde (voir David Motadel (dir), Revolutionary World. Global Upheaval in the Modern Age). C’est la question de la représentation et de la liberté qui est au centre des débats sur la taxation. « No taxation without representation ». « C’est au nom des principes whigs eux-mêmes que les Américains rejettent la politique de George III. Le pourrissement de la situation et la répression britannique contribuent à radicaliser les colons et de 1774 à 1776, l’idée d’une séparation d’avec la métropole mûrit. Pour Thomas Paine qui écrit « Le Sens Commun » en 1776, ce qui est en jeu dépasse le cadre d’une contestation coloniale et « la cause de l’Amérique est dans une grande mesure la cause de l’humanité ».
Vous souhaitez lire la suite ?
Actifs dans le débat public sur l'enseignement de nos disciplines et de nos pratiques pédagogiques, nous cherchons à proposer des services multiples, à commencer par une maintenance professionnelle de nos sites. Votre cotisation est là pour nous permettre de fonctionner et nous vous en remercions.