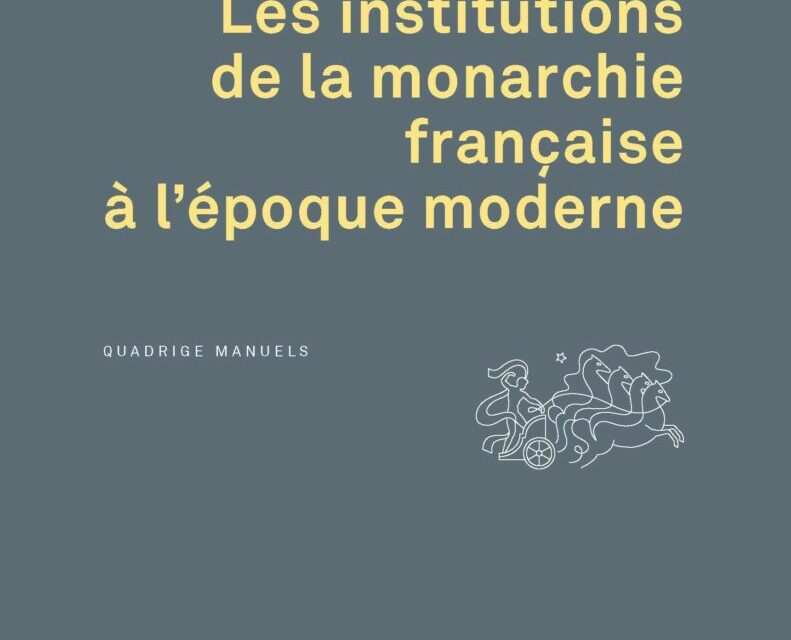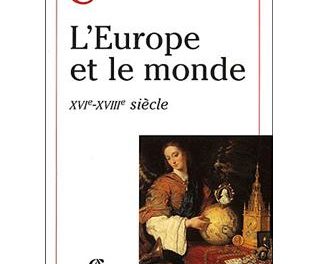L’ouvrage très clair de Bernard Barbiche, archiviste-paléographe, historien, directeur de l’Ecole Nationale des Chartes, professeur d’histoire des institutions de la monarchie française à l’époque moderne à l’époque moderne, est indispensable pour comprendre la construction et le fonctionnement de l’Etat monarchique. Les chapitres synthétisés ici ont été choisis pour servir le mieux possible les candidats aux concours à comprendre le système étatique et administratif du XVIIe et du XVIIIe siècle. Cette synthèse permet à tous de se familiariser avec les structures monarchiques pré-révolutionnaires. L’objectif est de situer efficacement les institutions dont les noms peuvent être lus dans d’autres ouvrages (tels que les présidiaux, les Etats généraux, la polysynodie, les sénéchaussées, les pays d’Etat, les lits de justice…) dans la pyramide de l’Etat (et particulièrement de l’Etat absolu) en construction.
Introduction. Le régime monarchique, XVIe-XVIIIe siècle. Première approche
Pour désigner la période sur laquelle porte le présent manuel (du début du XVIe siècle à la Révolution exclue), on emploie souvent l’expression « Ancien Régime ». Cette formule est apparue à l’époque révolutionnaire. Elle a été forgée en 1790 par les membres de l’Assemblée constituante pour définir le régime qu’ils étaient en train d’abolir. C’est une formule commode, qui a été consacrée par l’usage.
Certains historiens, comme Yves-Marie Bercé, évitent donc d’utiliser cette expression, lui préférant « France moderne »
Il faut donc être réaliste et se résoudre à continuer d’employer l’expression « Ancien Régime », qui est commode. Toutefois, il est sans doute préférable de restreindre son emploi aux deux derniers siècles de l’époque moderne, et même à la période 1661-1789 ; pour désigner le XVIe et la première moitié du XVIIe siècle, on emploie volontiers aujourd’hui l’expression « premier âge moderne », qui correspond grosso modo à ce que les historiens anglo-saxons appellent « Early modern France ».
La confusion des pouvoirs
Nous vivons depuis deux siècles sous le régime officiel de la séparation des trois pouvoirs.
Sous la monarchie absolue, cette distinction n’existait pas. Tous les pouvoirs étaient confondus dans la personne du roi, et par conséquent dans celles de ses agents. Administration et justice sont pratiquement synonymes dans l’ancienne France, ou tout au moins étroitement imbriquées.
Cette confusion entre justice et administration se retrouve à tous les échelons de la hiérarchie et se traduit dans le vocabulaire institutionnel. Les décisions du Conseil du roi, qu’elles portent sur des matières proprement judiciaires ou sur des objets de caractère administratif, prenaient la forme d’arrêts, terme du vocabulaire judiciaire (décision de justice rendue en dernier ressort). De même, les parlements et les conseils souverains ou supérieurs rendaient, en matière administrative, des arrêts de règlement. Les agents locaux, baillis et sénéchaux, bureaux des finances, élus, intendants, étaient à la fois des administrateurs et des juges.
Les « libertés et privilèges »
Notre droit contemporain est, pour l’essentiel, un droit commun : il s’applique, sauf dérogations exceptionnelles, à tous les citoyens et à l’ensemble du territoire ; la loi s’impose à tous. Dans l’ancienne France, c’était l’inverse : le droit commun était en quelque sorte l’exception. En tout cas, il était borné dans d’étroites limites par ce qu’on appelait les « libertés et privilèges ». Le privilège n’était pas un passe-droit, un avantage exorbitant consenti au haut clergé et à la noblesse. C’était un statut particulier, propre à une certaine catégorie de personnes et impliquant des droits et des devoirs spécifiques. C’était une loi particulière qui prévalait sur la loi générale.
La France était une société de corps. Le roi de France s’adressait moins à des individus qu’à des groupes : les trois ordres traditionnels du royaume, clergé, noblesse et tiers état ; les compagnies d’officiers ; les communautés de métiers ; les communautés territoriales et locales, provinces, pays, villes, bourgs et villages, et leurs habitants ; les protestants entre 1598 et 1685, etc. Ces corps avaient leurs coutumes et leurs statuts propres. Ils pouvaient s’exprimer dans des assemblées, formuler, suivant les cas, des doléances et des remontrances.
Absolutisme, monarchie absolue
Le terme d’« absolutisme », comme l’expression « Ancien Régime », est tardif ; il est apparu en 1797, sous la plume de Chateaubriand dans son Essai sur les révolutions. Il évoque couramment un régime où le pouvoir du souverain est sans limites, une sorte de dictature ou de despotisme.
Si le mot lui-même est postérieur à la chute de la monarchie, en revanche les expressions « roi absolu », « puissance absolue » étaient employées depuis fort longtemps.
La plupart s’accordent pour considérer que l’absolutisme a atteint son apogée sous le règne de Louis XIV, dont le nom seul évoque, presque intuitivement, comme l’accomplissement et la plénitude du pouvoir monarchique. Mais quand est-il apparu ? Ici encore, des points de vue variés ont été avancés. Pour Yves-Marie Bercé, « la naissance dramatique de l’absolutisme » (1992) se situe pendant la période 1598-1661, du fait de la multiplication des résistances et des formes d’opposition au pouvoir royal (pamphlets, complots, révoltes) caractéristiques de cette époque.
En tant que doctrine, la puissance absolue du roi est affirmée et définie dès le XIVe siècle. Elle repose sur des formules tirées de la Bible ou inspirées du droit romain. « Le roi est empereur en son royaume », Rex est imperator in regno suo). Cette théorie est encore développée une trentaine d’années plus tard par Jean Bodin, qui, en pleine période des guerres de Religion, définit, dans son œuvre maîtresse La République (1576), la souveraineté royale, signe de l’État bien ordonné, conforme à la nature et à la raison.
Un roi absolu n’est pas nécessairement un roi qui est obéi. Louis XIV n’a pas été moins absolu pendant la Fronde que pendant son règne personnel.
Le Roy Ladurie, par exemple, propose comme date de naissance de l’absolutisme les dernières sessions d’états généraux (1614) et d’assemblées de notables (1627) tenues avant la fin du règne de Louis XVI. Et le grand historien américain J. Russell Major, de son côté (Representative Government in early modern France, 1980 ; From Renaissance Monarchy to Absolute Monarchy, 1994), pense que la monarchie absolue a été définitivement instaurée dans les années 1670, époque à laquelle ont disparu un bon nombre d’états provinciaux. L’historiographie traditionnelle, en effet, a longtemps présenté le développement de l’absolutisme en termes d’affrontement. Son établissement serait le résultat d’un combat séculaire mené par la royauté contre les autonomies provinciales, contre les cours souveraines, contre les libertés et privilèges des différents corps constitutifs de la société française. Combat commencé dès le XIIe siècle, qui se termine avec Louis XIV. Tous leurs efforts auraient tendu à briser les résistances, à gommer les particularismes, à étrangler les libertés municipales et à gouverner sans contrôle, en un mot à déposséder d’une partie de leurs attributions les pouvoirs intermédiaires. L’histoire de la monarchie française à l’époque moderne ne serait qu’une longue épreuve de force, un bras de fer dans lequel elle aurait eu tantôt le dessus, tantôt le dessous.
En fait, ce type d’explication n’est pas pleinement satisfaisant. Tout d’abord, s’il est exact que les états généraux n’ont pas été réunis entre 1614 et 1789, et que de nombreux états provinciaux ont disparu au XVIIe siècle, il n’en est pas moins vrai que d’autres assemblées ont subsisté sans solution de continuité jusqu’à la fin de l’Ancien Régime : les assemblées du clergé, les états provinciaux dans plusieurs grandes provinces. Non seulement ces assemblées ont survécu, mais elles étaient florissantes au XVIIIe siècle.
En dehors des poussées de fièvre conflictuelles, les relations courantes entre la monarchie et les cours ont été moins conflictuelles qu’on ne l’imagine. L’historien américain Albert Hamscher a étudié, d’après les documents d’archives, les rapports entre le Conseil privé et les parlements sous le règne personnel de Louis XIV (The Conseil privé and the Parlements in the age of Louis XIV : a study in French absolutism, 1987), rapports traditionnellement décrits comme exécrables : le Conseil privé à cette époque aurait passé le plus clair de son temps à casser les arrêts des parlements, à évoquer les procès ; il aurait livré une guerre permanente aux cours supérieures. Or, on ne trouve dans les arrêts du Conseil que très peu d’évocations et de cassations, et au contraire la trace d’une étroite collaboration pour le bon fonctionnement de la justice. Des constatations analogues ont été faites par un historien français, le P. Pierre Blet. Étudiant l’histoire des assemblées du clergé dans les vingt dernières années du règne de Louis XIV (Le clergé de France, Louis XIV et le Saint-Siège de 1695 à 1715, 1989), il observe que pendant toute cette période, en matière religieuse, c’est un climat de coopération qui a prévalu dans les rapports entre le roi et le parlement de Paris, tout au moins jusqu’à l’affrontement de 1715 sur la constitution Unigenitus. Louis XIV apparaît ici non pas comme un tyran, mais comme un souverain qui recherche autant que possible, pour surmonter les difficultés, les voies de la conciliation (comme l’empereur Auguste recherchait le consensus universorum).
Certes, il ne s’agit pas de nier les évidences, à savoir qu’il y a eu parfois des rapports difficiles entre la monarchie et les institutions représentatives ou les cours supérieures. Il s’agit de trouver une explication, une analyse, qui prenne en compte la totalité des éléments du problème. Il faut réviser la théorie selon laquelle le roi de France, pour devenir un monarque absolu, aurait été nécessairement et perpétuellement en guerre contre les autonomies locales, les assemblées d’états et les parlements.
Le pouvoir absolu ne doit pas être assimilé à la tyrannie, ni au despotisme, ni à la dictature. Le royaume de France, on l’a vu, était une pyramide de communautés, de privilèges, de traditions et de symboles, pyramide au sommet de laquelle se trouvait le souverain. Sous Louis XVI comme sous François Ier, le pouvoir absolu était une fonction suprême d’arbitrage. Le roi était le régulateur des privilèges. Son rôle consistait à reconnaître, valider, confirmer ou octroyer les privilèges, à obliger chaque corps à les observer, à apaiser les différends ou rivalités entre les corps. Le roi de France, monarque absolu, n’était pas un tyran, c’était un arbitre.
Cela permet de mieux comprendre quel a été le ressort véritable de l’absolutisme. La monarchie française a eu pour objectif de faire régner l’ordre et l’harmonie dans le royaume, d’assurer le bon fonctionnement des pouvoirs publics, de bien gérer l’État : c’est la fameuse « maxime de l’ordre » de Louis XIV et de Colbert. Tout ce qui concourait à ce but a été maintenu, et même développé. Tout ce qui faisait obstacle à la réalisation de ce programme a été éliminé ou neutralisé. Ainsi s’éclaire l’histoire des assemblées d’états à l’époque moderne.
Les états généraux pendant cette période sont une institution de crise. Entre la fin du XVe siècle et le règne de Charles IX, ils n’ont pas été réunis. Ce sont les troubles de Religion qui ont provoqué leur résurgence après une longue mise en sommeil. Ils ont été de nouveau plusieurs fois convoqués pendant la Fronde, entre 1649 et 1653, mais la session annoncée, toujours différée, n’eut finalement pas lieu. Si Louis XVI les a de nouveau réunis en 1789, c’est parce que le royaume traversait une conjoncture grave et se trouvait dans une situation de blocage. Cette analyse s’applique aussi aux états provinciaux. Au début du XVIIe siècle, les trois ordres des états du Dauphiné, ne s’entendant pas, ont fait appel au roi. Celui-ci, en 1628, a cessé de les convoquer et ils ont donc disparu jusqu’en 1788. Ce n’est pas le roi qui a supprimé autoritairement les états du Dauphiné, mais plutôt ceux-ci qui ont préféré ne plus se réunir. On peut faire des observations analogues à propos des parlements. Sous Louis XIV, ceux-ci ont coopéré avec le roi dans les domaines législatif, judiciaire et ecclésiastique. Sous Louis XV, ils se sont dressés contre l’autorité royale ; ils ont été réformés en 1771.
En définitive, si l’on voit dans le roi l’arbitre suprême, qui assurait la cohésion de la mosaïque de corps, d’ordres et d’états constitutifs de la nation, on constate que la monarchie absolue n’était pas incompatible avec les privilèges et les statuts particuliers. : la monarchie s’est appuyée sur les élites toutes les fois que cela pouvait concourir à faire régner l’ordre dans une partie du royaume.
Si donc l’absolutisme pouvait s’accommoder, et s’est de fait accommodé, des « libertés et privilèges », d’où vient alors cette réputation de despotisme et de tyrannie qui, au XVIIIe siècle, s’est attachée à la monarchie et qui, en définitive, a débouché sur la Révolution – Révolution paradoxale à bien des égards, puisqu’elle a eu lieu sous le règne d’un souverain qui, moins que tout autre, avait l’allure et le comportement d’un despote ? Il faut chercher ailleurs la cause de cette désaffection des peuples à l’égard de la monarchie, de ce processus qui, au XVIIIe siècle, a transformé aux yeux de ses sujets le roi arbitre en roi arbitraire. Peut-on trouver cette cause dans le développement de la centralisation ?
Vous souhaitez lire la suite ?
Actifs dans le débat public sur l'enseignement de nos disciplines et de nos pratiques pédagogiques, nous cherchons à proposer des services multiples, à commencer par une maintenance professionnelle de nos sites. Votre cotisation est là pour nous permettre de fonctionner et nous vous en remercions.