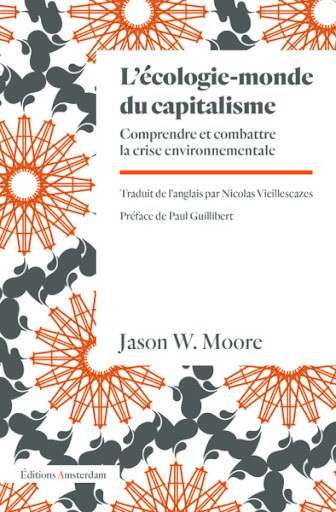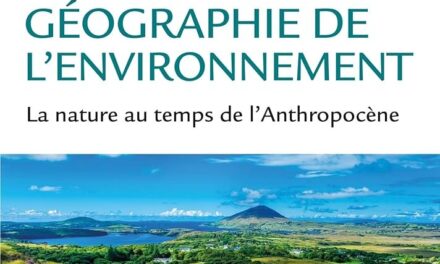Jason Moore est historien, professeur à l’université de Binghamton (États-Unis) où il coordonne le World-Ecology Research Collective. Spécialiste d’histoire agraire et environnementale, il est notamment l’auteur de Capitalism in the Web of Life (2015, traduit en français en, 2020), de Anthropocene or Capitalocene? Nature, History, and the Crisis of Capitalism (2017) et, avec Raj Patel, de A History of the World in Seven Cheap Things. A Guide to Capitalism, Nature, and the Future of the Planet (2018, également traduit en français). Cet ouvrage est l’assemblage et la traduction de 3 anciens articles de l’auteur écrits en 2017, 2018 et 2021, et qui résument la pensée déjà présentée dans ses autres ouvrages.
Jason Moore est connu pour sa critique du capitalisme fossile qui, en se fondant sur l’extraction constante des énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz) et sur la consommation à outrance, provoque une inégalité planétaire et une accélération de la destruction de la Nature. L’Anthropocène n’est pas seulement la période au cours de laquelle l’être humain devient un argent géologique ou une force capable de transformer la nature. La notion universalise le problème et culpabilise des sociétés et des groupes qui n’ont qu’une très faible responsabilité dans les transformations actuelles de la biosphère. Ce sont davantage des victimes d’une autre force, beaucoup plus puissante et sélective: le Capitalocène. Le concept d’Anthropocène est un concept occidentalo-centré qui permet de partager et de diluer les responsabilités du changement climatique avec les autres sociétés de la planète. Reprenant les théories de William Cronon, de Andreas Malm et de John McNeill, il est le 4e historien majeur à se servir de l’histoire pour expliquer une réalité géographique particulièrement menaçante.
Comme le dit le 4e de couverture: « Pourquoi il faut renoncer à la notion d’Anthropocène, qui renforce ce qu’elle prétend combattre. Le récit de l’Anthropocène définit déjà une orientation politique. Il présuppose une séparation problématique entre Homme et Nature, socle idéologique de la destruction généralisée que l’on nomme aujourd’hui « crise écologique », qui a justifié la conquête planétaire menée par les pays occidentaux et l’émergence du capitalisme. Dans ce cadre de pensée, tout ce qui relève de la Nature est dévalorisé, donc exploitable à l’envi. Ainsi, la notion d’Anthropocène s’appuie sur cela même qu’il faudrait mettre en cause. Parler de Capitalocène, à l’inverse, c’est souligner l’intégration de l’ensemble de l’humanité dans le « tissu de la vie », proposer une périodisation historique plus longue, identifier les causes profondes de la crise planétaire et se donner les moyens d’en sortir ».
INTRODUCTION
Il est inexact de dire que le changement climatique est causé par l’humanité, car cela ne permet pas d’identifier les responsables, et donc cela empêche une politique climatique appropriée.
L’Anthropocène, nouvelle forme du déni climatique
L’Anthropocène est une forme de déni climatique qui ne porte pas sur la réalité du changement climatique mais sur ses responsables : les origines de la crise planétaire actuelle se trouvent dans l’essor du capitalisme après 1492.
Parler d’Anthropocène c’est fonder sa réflexion sur une division binaire entre l’Homme et la Nature. Ce mode de pensée, apparu au XVIIème siècle, est la cause de la crise planétaire et ne peut donc permettre de la résoudre.
La vague écologiste des années 70 est une écologie de riches qui ne prête aucune attention aux problèmes concrets rencontrés par les travailleurs et repose sur l’éco-managérialisme.
Cette pensée repose sur le dualisme Homme-Nature que Bruno Latour appelle « le Grand Partage » et que Jason Moore appelle « le Conflit éternel ». Ce dualisme est apparu dans les deux siècles après 1492 et a progressivement remplacé les holismes organiques du Moyen-Age. On en retrouve une expression dans l’idéologie impérialiste qui permet la domination des Eclairés sur la Nature – qui contient non seulement les animaux, sols, eaux… mais aussi la majorité de l’humanité considérée comme « sauvage ». Ce naturalisme bourgeois justifie toutes les idéologies de la domination. L’Homme, concept abstrait, domestique la Nature, pensée comme extérieure. C’est le « paradigme écologique ».
Marx et Engels ont très tôt dénoncé ce concept d’Homme abstrait. Ils ont montré que l’histoire est faite par des organisations concrètes (empires, entreprises, syndicats, partis, églises). L’homme historique (et non abstrait) est le produit d’ensembles de rapports de travail et de rapports avec et dans le tissu de la vie.
Cette conception dualiste Homme-Nature empêche toute critique socialiste de la crise climatique, toute révolte sociale et conduit à une menace pour la démocratie : puisqu’il y a une « urgence climatique », il y a un état d’urgence, il faut prendre des mesures qui nécessitent une centralisation et une soumission à un état bio-sécuritaire dirigé par les banquiers, les technocrates, les scientifiques et les chefs d’entreprise (cf. Naomi Klein, La Stratégie du choc. La Montée d’un capitalisme du désastre, trad 2008). La « fin de l’histoire » est devenue une farce climatique au centre des affaires politiques mondiales.
Récemment, William R. Catton Jr. et Riley E. Dunlap ont défini un « nouveau paradigme écologique », plus adapté à une société post-abondance ou à un capitalisme de la finitude. Leur travail montre que la sociologie s’est développée dans le contexte d’une vision occidentale dominante du monde extrêmement anthropocentrique, selon laquelle les humains seraient séparés du reste de la nature et considéreraient l’abondance des ressources, la croissance et le progrès comme allant de soi. La sociologie a adopté cette vision du monde optimiste et le paradigme de l’exemptionnalisme humain : les sociétés modernes industrialisées auraient été « exemptées » des contraintes écologiques.
Homme, Nature et Capitalogenèse
103 grandes entreprises sont responsables de 70% des émissions de carbone depuis 1951. Comme pour les génocides liés à la colonisation des Amériques ou à ceux de la Seconde Guerre mondiale, la crise climatique n’est pas causée par l’Homme mais par le Capital. C’est la conséquence de la « Grande Accélération » identifiée par John McNeill et Peter Engelke.
Jason Moore présente une objection possible : il est scientifiquement nécessaire de distinguer la causalité humaine (ex. les usines, les élevages intensifs) de la causalité naturelle (ex. les éruptions volcaniques, les variations orbitales).
L’Anthropocène ne relève pas uniquement de procédures scientifiques. Il est au centre de l’infrastructure scientifique du capitalisme. La science est d’ailleurs façonnée par des forces sociales et des idéologies déterminées. Par exemple, les scientifiques qui défendent l’Anthropocène dérivent très souvent vers des thèses scientifiques néomalthusiennes. Moore critique ainsi Paul Crutzen : ce dernier positionne l’an 0 de l’Anthropocène en 1784, date de la mise au point par James Watt de la machine à vapeur, puis rattache cette invention à l’expansion démocratique un siècle plus tard sans qu’on comprenne comment.
Les natures des transitions historiques : climat, classe et révolte
1492 est le point de départ des révolutions environnementales du capitalisme car l’invasion de 1492 mêle la géobiologie eurasiatique à celle des Amériques. Le capitalisme est donc une force géo-biologique.
Le capitalisme n’est pas seulement le producteur de la crise climatique actuelle, c’est aussi le produit de l’imbrication du climat et des rapports de classe au cours de deux périodes de transition antérieures.
Première période de transition : la crise du féodalisme qui commence au début du petit âge glaciaire à la fin du XIIIème siècle. La faim et les épidémies ont surgit du jour au lendemain, mais aussi les révoltes populaires. Cette période de contraction économique et de refroidissement climatique a été un âge d’or des travailleurs du point de vue de leurs conditions de vie, pendant que les classes dominantes se retournaient les unes contre les autres.
Pour nous qui pensons plus facilement la fin du monde que celle du capitalisme, nous voyons ici que les moments de changement climatique défavorable sont lourds de possibilités politiques. C’est parce que le climat est impliqué dans les rapports socio-écologiques de pouvoir, de production, de croyance. Les deux moments d’assujettissement de la paysannerie sous le féodalisme (VIIIème et XIème siècles) correspondent aux périodes climatiques les plus favorables du Moyen-Age. La dégradation des conditions climatiques a nuit aux classes dominantes (cf. implosion de l’Occident romain décrite par Kyle Harper, Comment l’Empire romain s’est effondré. Le climat, les maladies et la chute de Rome, trad. 2019).
Deuxième période de de transition : la crise du long et froid XVIIème siècle. Suite aux conquêtes, il a été nécessaire de trouver une force de travail bon marché : considérer les peuples autochtones comme appartenant à la Nature permettait de les réduire en esclavage. La prolétarisation des esclaves africains a suivi.
Vous souhaitez lire la suite ?
Actifs dans le débat public sur l'enseignement de nos disciplines et de nos pratiques pédagogiques, nous cherchons à proposer des services multiples, à commencer par une maintenance professionnelle de nos sites. Votre cotisation est là pour nous permettre de fonctionner et nous vous en remercions.