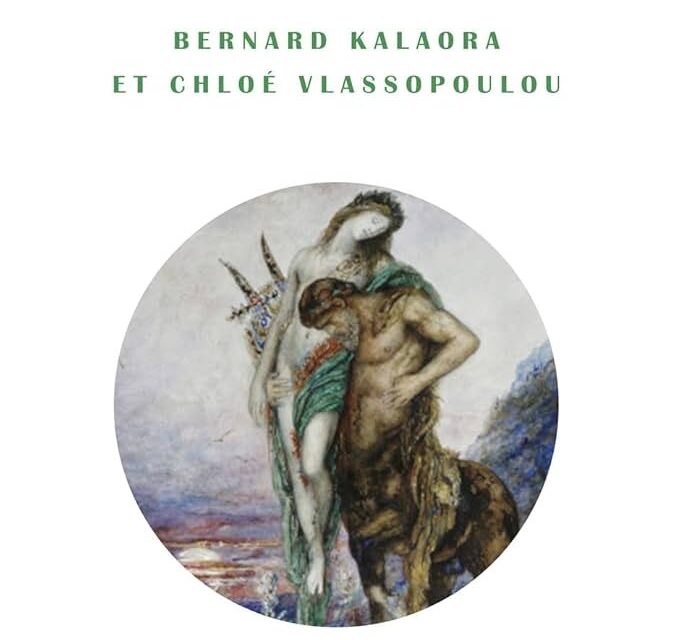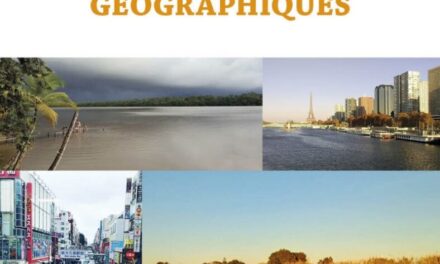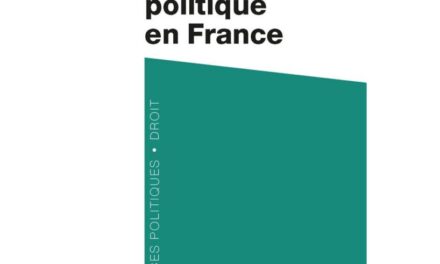L’environnement est de plus en plus médiatisé dans la société française contemporaine, alors qu’il occupe encore une maigre place dans les sciences humaines et sociales. Seul un petit nombre de chercheurs, sociologues, politistes, juristes, historiens, pour certains engagés, ont fait de la question environnementale leur thème de prédilection. Les auteurs analysent la résistance des sciences sociales à se saisir de cette question comme une spécificité française liée aux préjugés scientifiques, aux découpages institutionnels et aux conflits disciplinaires. L’environnement est un objet périphérique. Rien de tel dans les pays anglo-saxons où l’environnement dans les sciences sociales occupe une place majeure comme processus dynamique d’interaction entre des facteurs naturels et sociaux. Les auteurs (un socio-anthropologue et une docteure en sciences politiques, spécialiste des politiques publiques de l’environnement) explorent alors les causes à l’origine de cette relégation de la sociologie de l’environnement en France et les difficultés à faire valoir son existence dans la recherche sociologique et dans l’espace public.
Cette fiche a été réalisée à partir d’une IA, dont le texte et les interprétations ont été patiemment mises en adéquation avec le texte du livre.
Introduction
La difficulté interne aux sciences humaines et sociales françaises de penser l’environnement doit être mise en relation avec la forte présence d’un pôle techno-étatique qui revendique et qui monopolise la connaissance et la gestion de l’environnement. Dans les années 1970 c’est en effet à l’État et aux grands corps techniques à qui revient la tâche de constituer l’environnement en tant que domaine de l’action publique en l’absence d’une réflexion sociale et sociologique sur la définition du terme et sa problématisation. Ce n’est qu’à la suite de l’institutionnalisation du secteur de l’environnement que les sciences humaines s’y sont intéressées.
L’absence sur le plan de la recherche d’une communauté ayant en charge la problématique environnementale commune se traduit par une démultiplication de la question environnementale en autant d’objets (air, eau, sol, nature, etc.) qu’il existe de chapelles et de particularismes scientifiques et disciplinaires. À cela se rajoute le fractionnement de l’environnement au sein de l’appareil d’État et au sein même de l’administration de l’environnement. Différentes administrations se déclarent compétentes en la matière (ministères de l’environnement, de la recherche, de l’équipement, des transports, de l’agriculture, etc.) et engagent des budgets pour des programmes d’études. Il en résulte une multiplicité de l’offre institutionnelle qui renforce l’éparpillement de la recherche faute de coordination entre ces initiatives. Au sein même du ministère de l’Environnement, l’environnement est divisé en sous-secteurs (risque et pollutions, nature et protection, aménagement et cadre de vie).
A contrario, dans les pays anglo-saxons, existe historiquement une forte réflexion et cela autant dans les domaines de la sociologie, de la philosophie de l’histoire ou de l’anthropologie. La sociologie et l’anthropologie américaines se sont très précocement intéressées à la dimension écologique du social dont l’École de Chicago est l’exemple le plus emblématique. De même, la philosophie américaine constitue une source importante pour penser la relation de l’homme à son environnement dans un contexte d’appropriation et de socialisation d’une nature sauvage au fondement même de l’identité américaine. Enfin, les analyses historiques de l’environnement contribuent à faire de ce domaine un objet légitime et reconnu par l’ensemble des communautés qui trouvent dans l’histoire un socle de connaissances utiles. Les travaux contemporains sont donc l’aboutissement d’une longue maturation intellectuelle au fondement d’un paradigme environnemental largement partagé et de l’existence d’un dialogue entre sciences sociales et sciences de l’environnement. Rien de comparable en France. Il n’y a aucune antériorité de l’environnement comme objet de recherche qu’il s’agisse des domaines de la sociologie, de l’histoire, de la philosophie ou, à moindre degré, de l’anthropologie.
Chapitre 1 : Les cadres cognitifs pour penser l’environnement
Le premier chapitre explore l’historicité de la préoccupation environnementale. Contrairement à l’idée selon laquelle les sociétés occidentales auraient découvert les enjeux environnementaux dans les années 1960-70, les auteurs montrent que cette question est le fruit d’une longue maturation, influencée par des contextes culturels variés.
L’environnement comme préoccupation ancienne
Depuis l’Antiquité, des penseurs comme Hippocrate ont souligné l’influence du milieu sur la santé et les sociétés.
Dès le XIVe siècle, des règlements urbains visent à limiter les pollutions (exemple des ordonnances du prévôt de Paris en 1348).
Dès l’origine de l’Holocène, il s’agit, pour l’Homme, de dompter la nature pour créer les conditions de la sédentarisation des communautés humaines.
Un premier changement se produit avec l’ère industrielle : le défi du contrôle de la nature devient un défi technologique. C’est le début du « technosolutionnisme ».
Un deuxième changement se produit fans les années 1970 : c’est ce que les auteurs appellent « l’ère environnementale » (les limites du modèle productiviste face aux crises pétrolières, la montée des revendications sociales en faveur de l’environnement, l’apparition d’institutions publiques et de politiques publiques en faveur de la défense de l’environnement). Cette fois, Il ne s’agit plus d’agir pour contrôler l’environnement mais pour le préserver contre l’interventionnisme démesuré des sociétés modernes. « L’ère environnementale » est à l’origine d’une « éthique de responsabilité envers les générations présentes et futures » (lien avec Chakrabarty, sur les générations futures).
Les cadres français : une émergence éclatée
Les trois cadres d’émergence de la pensée environnementale en France
1. Une filiation esthétique et naturaliste : la nature comme patrimoine
a. L’émergence d’une sensibilité paysagère
Dès le XVIIIe siècle, le regard porté sur la nature change. Les paysages ne sont plus seulement perçus comme des espaces hostiles ou utilitaires, mais comme des objets esthétiques et patrimoniaux.
Le romantisme et la redécouverte de la nature sauvage influencent cette sensibilité (ex. Rousseau et son attrait pour la nature pure).
Le XIXe siècle est marqué par une fascination croissante pour le paysage et la représentation artistique du territoire.
Face à la révolution industrielle, conscience du risque d’altération, de détériorations, de ravages de la nature causée par le mercantilisme, l’urbanisation et l’industrialisation.
Nouvel intérêt pour la nature face au risque de sa disparition. L’élite découvre son historicité et sa fragilité, ce qui transforme les attitudes sociales : la nature devient objet de sollicitude et d’action conservatrice.
b. Le rôle des artistes et écrivains
Les peintres et écrivains du XIXe siècle participent à la construction d’un imaginaire de la nature sublime et menacée (ex. les œuvres de Gustave Courbet, Victor Hugo).
La prise de conscience de la fragilité de certains espaces pousse à l’émergence d’un discours conservationniste.
Dans les salons, intérêt pour les tableaux de forêt, de mer, de montagne ou de désert.
c. L’institutionnalisation de la protection des paysages
La protection de la nature s’organise sous l’impulsion des élites urbaines et artistiques.
La création des premières lois de protection des sites naturels s’inspire de cette vision patrimoniale.
Le mouvement aboutit à des dispositifs comme les parcs nationaux, dont le premier en France est celui de l’Oisans en 1913.
Différence à faire entre protection de « la nature » (par esthétisme) et protection de « l’environnement » (approche scientifique et technique).
d. Limites de cette approche
Cette sensibilité esthétique est élitiste : elle concerne surtout les paysages spectaculaires et ne prend pas en compte les problématiques environnementales plus globales (pollution, ressources). Elle s’inscrit dans une vision contemplative et passive plutôt qu’écologique ou sociale.
2. Une filiation hygiéniste : l’environnement comme enjeu de santé publique
a. Un contexte marqué par les épidémies et l’urbanisation
A partir du XVIIIe siècle, l’urbanisation rapide et les conditions sanitaires précaires dans les villes posent de nouveaux défis. Ce qui inquiète tout d’abord, c’est la dégradation de l’air et de l’eau, plus que le paysage.
Les grandes épidémies (choléra, typhus) révèlent les liens entre insalubrité et santé publique.
Cela fait de l’hygiénisme « une première forme de défense de l’environnement » (JP Baux). L’eau potable, l’air pur et l’assainissement deviennent des priorités.
b. Le rôle des médecins hygiénistes
Les hygiénistes, en particulier au XIXe siècle, militent pour une meilleure gestion de l’environnement urbain.
Ils influencent les premières réglementations contre les pollutions industrielles et domestiques.
Le décret de 1810 sur les établissements insalubres marque une première tentative de régulation des nuisances industrielles. Une loi sur l’eau en 1902, sur les fumées en 1932, sur les pollutions atmosphériques et les odeurs en 1961.
c. Les premières politiques publiques environnementales
Création de structures comme le Conseil de salubrité publique (1802), le Conseil supérieur de santé (1822), le Service de l’hygiène publique (1831), le Conseil supérieur d’hygiène publique (1848), chargé de conseiller l’État sur les questions sanitaires. Le premier Ministère de l’hygiène date de 1920.
L’hygiénisme rencontre donc les préoccupations des élites urbaines et accélère la prise de conscience de la défense de la qualité du milieu naturel, de l’hygiène au travail, de l’hygiène alimentaire et surtout de la gestion protectrice des forêts qu’ils voient comme des régulateurs du climat et de la qualité de l’atmosphère.
Création de l’Ecole forestière de Nancy en 1824, le Code forestier en 1827 pour la gestion raisonnée des forêts.
d. Limites de cette approche
L’environnement est perçu uniquement sous l’angle sanitaire, sans prise en compte des dimensions écologiques ou sociales. La lutte contre la pollution est souvent subordonnée aux impératifs économiques et industriels.
3. Une filiation technocratique : l’État et la gestion rationnelle de l’environnement
a. Le rôle des grands corps de l’État
Dès le XIXe siècle, la gestion de l’environnement est confiée aux ingénieurs et techniciens de l’État. Elle dépasse la surveillance des élites artistiques et devient technocratique.
Trois grands corps se partagent les compétences :
- Les Forestiers (École forestière de Nancy, 1824) → conservation et gestion des forêts.
- Les Ingénieurs des Mines (École des Mines, 1783) → développement industriel et pollution.
- Les Ponts et Chaussées (1747) → aménagement du territoire et infrastructures.
b. Un modèle basé sur la rationalité technique
L’environnement est traité comme un ensemble de ressources à gérer selon des principes scientifiques et économiques.
La régulation passe par des normes, des contrôles et des plans d’aménagement.
Grands débats sur la fonction écologique des forêts, avant la découverte des gaz à effet de serre (lien avec une autre fiche). Lutte de l’Etat pour la surveillance des forêts privées, la responsabilité des propriétaires, le reboisement et la restauration des forêts malmenées, surtout en milieu montagneux.
Sous le Second Empire, va plus loin : contre les régions insalubres, les marais, les zones de montagne isolées et peu développées, les ravages des torrents et des inondations. Le Saint-simonisme pousse à modifier l’environnement, pour moderniser la France (et permettre de redynamiser des régions entières en y installant des voies de chemin de fer ou des stations balnéaires). Plantation concertée des forêts de pins dans les Landes.
c. Exemples de politiques technocratiques
- La gestion forestière : lutte contre la déforestation, planification des reboisements (code forestier de 1827).
- Le contrôle des nuisances industrielles : réglementation progressive des émissions polluantes, mais avec des compromis pour ne pas freiner le développement économique.
- Les grands travaux d’aménagement : assèchement des marais, maîtrise des rivières, gestion des risques naturels (ex. l’ingénieur A. Surell des Ponts et Chaussées et la lutte contre les torrents dans les Alpes).
d. Limites de cette approche
Une vision centralisée et descendante, excluant souvent la société civile et les acteurs locaux.
Une approche compartimentée (forêts, pollution, eau…) qui empêche une vision systémique de l’environnement.
Une priorité donnée au développement économique sur la protection de l’environnement.
Ainsi, l’histoire de la pensée environnementale en France montre une évolution marquée par ces trois cadres distincts, qui ont influencé la manière dont les problèmes écologiques ont été abordés :
1. L’approche esthétique a permis de protéger certains paysages mais a longtemps ignoré les enjeux globaux.
2. L’approche hygiéniste a introduit une prise en compte de l’environnement dans la santé publique, mais avec une vision utilitariste.
3. L’approche technocratique a structuré les politiques environnementales, mais en restant cloisonnée et subordonnée aux impératifs économiques.
Aujourd’hui, la question environnementale dépasse ces approches traditionnelles. La montée des crises écologiques impose une réflexion plus globale, intégrant les dimensions sociales, politiques et écologiques dans une approche interdisciplinaire.
Vous souhaitez lire la suite ?
Actifs dans le débat public sur l'enseignement de nos disciplines et de nos pratiques pédagogiques, nous cherchons à proposer des services multiples, à commencer par une maintenance professionnelle de nos sites. Votre cotisation est là pour nous permettre de fonctionner et nous vous en remercions.
Conclusion
L’environnement est un fait social total. En effet, l’environnement est une composante que l’on retrouve dans toutes les pratiques sociales. En ce sens, il constitue un champ qui devrait se décliner dans tous les compartiments.
Pourquoi alors l’environnement est-il en France un objet fantôme? Il faut abandonner Vidal pour Latour et Descola. Face à l’anthropologie, l’aveuglement des sociologues est lié à plusieurs facteurs. D’abord, l’accent a toujours été mis sur la question sociale, sans prendre en compte que l’homme est partie intégrante de l’environnement sans lequel il ne peut exister. Ensuite, l’assimilation par les tenants de la sociologie « dure » de l’environnementalisme à une action militante a entaché de suspicion les travaux qui existent en sciences sociales sur l’environnement. Enfin, l’environnement depuis l’épuisement du mouvement hygiéniste, est devenu une affaire d’ingénieurs et, qui plus est, des grands corps d’état, imposant une approche technocratique et essentiellement normative.
Il faut changer de paradigme et permettre une approche interactionniste, dynamique et multi-scalaire.
Fort heureusement, depuis quelques années, cette dualité entre homme et nature est de plus en plus remise en question du fait des conséquences de la modernité et des effets non intentionnels de l’activité humaine.
Dans le monde anglo-saxon, si l’on retrouve des clivages du même ordre qui marquent l’ensemble des cultures occidentales, de Bacon à Darwin, et au-delà, semble s’être affirmée une tradition beaucoup plus ouverte, qui accorde fondamentalement à la nature, conçue comme active et opératoire, une place beaucoup plus importante dans tous les registres et à toutes les échelles. Le tropisme naturaliste, qui constitue le cadre principal de l’action collective en France, a constitué un obstacle majeur à la compréhension dynamique des liens entre l’homme et la nature, ostracisant de fait cette dernière du pacte social et politique.
Même si on se situe dans un contexte d’extension massive de la question
environnementale, la tradition française, dans son mélange de scientisme, de positivisme et de corporatisme, persiste à faire de l’environnement une affaire de spécialistes ou de militants.
Cette approche française de l’environnement se trouve récemment bousculée par la globalisation qui fait de l’environnement un objet transfrontalier et de la gouvernance une affaire supra-nationale. La montée des thématiques globales sur le risque et les enjeux altermondialistes donne à l’environnement un nouveau statut en tant qu’objet sociologique « à la mode » sans pour autant que les sciences sociales s’ouvrent véritablement aux sciences de l’environnement pour générer un paradigme nouveau.
L’intéressement à l’environnement exige une forte conscience morale et collective. Il est l’affaire de l’individu, de sa responsabilité à l’égard de ce qui constitue son environnement, et au-delà la biosphère, mais aussi celle des individus dans leur interaction réciproque. Il suppose l’avènement d’un sujet libre qui choisit son destin non à partir du sens commun et de l’opinion publique majoritaire mais sur la base des réseaux d’échange de sens et de dialogue. La prise en compte de l’environnement suppose en effet une forme de résistance à l’égard du conformisme ambiant, des tendances, des modes et du vouloir toujours plus consommer. L’individu dans cette épreuve prend conscience de la valeur universelle de la nature et s’ouvre à des horizons de significations le reliant à un ordre plus vaste que la seule dimension humaine. Cette perspective est certainement à l’origine d’une sensibilité anglo-saxonne plus marquée à l’environnement qui reflète une conscience morale et individuelle plutôt qu’étatique et qui suppose des sujets libres capables de s’opposer à tout conformisme social ou politique.
Dans la société française c’est sans doute l’équilibre entre l’État et les individus qu’il convient de questionner. L’environnement n’est pas seulement une affaire étatique mais aussi celle de sujets libres et non conformistes ayant une conscience réflexive des conséquences de leurs actes et non soumis aux injonctions d’un pouvoir d’où qu’il procède. Là réside sans doute une des explications de la difficulté à faire de l’environnement une composante du vivre ensemble.