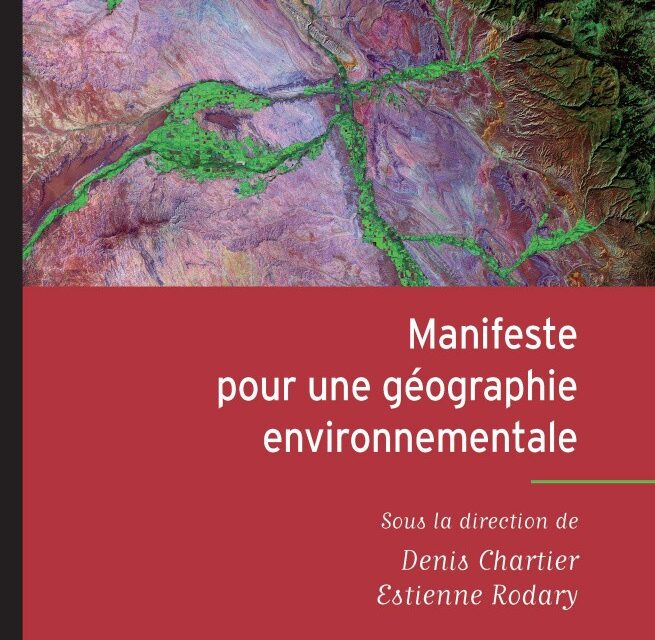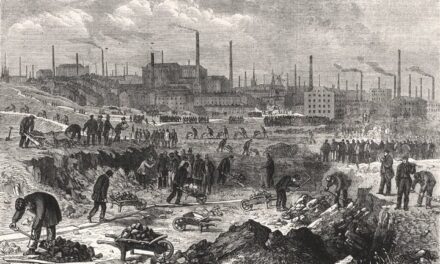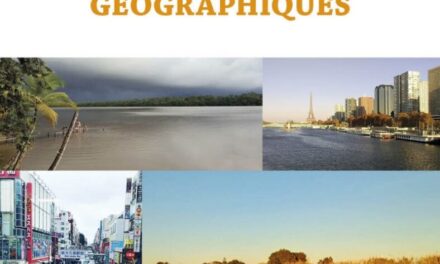Denis Chartier et Estienne Rodary défendent une vision « cosmopolitique » de la gestion de la crise environnementale. Après un premier article publié en 2007, appelant à une géographie politique de la conservation de la biodiversité (aussi bien locale que transnationale), ils ont rassemblé plusieurs géographes autour de leur projet. Leur vision se transforme alors en un « manifeste pour une géographie environnementale » en 2016. Engagés, les auteurs alertent l’opinion non éclairée sur les dangers que l’humanité impose à la biosphère et qui hypothèquent sa propre capacité à se reproduire. L’interdépendance renforcée entre l’action humaine et l’environnement planétaire crée à présent une symétrie qui appelle une nouvelle gestion des relations de l’humanité avec la Terre. Il faut désormais penser le « Monde unifié », une « société-monde », un « commun planétaire » qui permette de saisir que les décisions des Etats-nation dépassent les frontières nationales. L’agir politique est en même temps un agir climatique et géologique qui implique à la fois les décideurs politiques, les citoyens, les ONG, les FTN…
Introduction. Géographie, écologie politique. Un climat de changement (Denis Chartier, Estienne Rodary)
La France n’est pas favorable aux idées environnementales. C’est l’un des pays au monde où l’on consomme le plus de pesticides à l’hectare ; plusieurs des objectifs du Grenelle de l’environnement sont désormais hors de portée ; la France est aussi le dernier pays d’Amérique du Sud à mettre en place une aire protégée (en Guyane) ; l’empreinte carbone des Français a augmenté de 11 % entre 1990 et 2010 ; le pays est le dernier des grandes nations nucléarisées à attendre un accident majeur sur son sol (après Three Mile Island, Tchernobyl, Fukushima) ; nous vendons aux autres pays des réacteurs nucléaires de deuxième génération (EPR) ; nos hommes et femmes politiques pratiquent de plus en plus une « écologie du spectacle » (Clément Sénéchal, Pourquoi l’écologie perd toujours, Seuil, 2024)…
Parmi les plus « brillantes » plumes françaises, beaucoup se sont essayées à la critique de « l’écologie », depuis les salves de Luc Ferry (Le Nouvel Ordre écologique, Grasset, 1992) ou celles de Marcel Gauchet (« Sous l’amour de la nature, la haine des hommes », dans Marcel Gauchet, La Démocratie contre elle-même, Gallimard, 2002, p. 199-206) jusqu’aux développements climatosceptiques de Pascal Bruckner (Le Fanatisme de l’apocalypse. Sauver la Terre, punir l’Homme, Grasset-Fasquelle, 2011) ou de Claude Allègre (L’Imposture climatique, Plon, 2010) ) qui, ces dernières années, ont défrayé la chronique. Il y a aussi des géographes qui se sont engagés dans une entreprise résolument écolosceptique, cristallisée autour de la Société de géographie et de son ouvrage Le Ciel ne va pas nous tomber sur la tête (Sylvie Brunel, Jean-Robert Pitte (dir), JC Lattès, 2010).
Ici, les auteurs du Manifeste veulent « rendre compte, de manière distanciée et engagée, dans une démarche scientifique qui ne soit plus hantée par le spectre du « militantisme » mais qui cherche efficacement à être au plus proche du monde dans lequel nous vivons, d’une suite de phénomènes que l’on peut résumer ainsi : une prise de conscience et une prise en compte – partielles, conflictuelles et contestées mais néanmoins croissantes – de l’impact des activités humaines sur la Terre ; les modifications que cela entraîne dans les différentes sphères d’existence ; et plus spécifiquement les transformations scientifiques que cela génère ».
L’ouvrage est engagé: il est écrit pour faire face aux écolo-sceptiques qui nous rassurent sur notre avenir, face au ventre mou de la discipline géographique qui voudrait se contenter de définir la géographie comme une science réduite à ses outils ou à sa position de carrefour, ou comme une science qui porterait seule la maîtrise des relations entre les sociétés et la nature. Il s’agit aussi d’analyser la réticence flagrante de la géographie française à problématiser son rapprochement avec l’écologie et la politique. Roger Chartier entend poser les jalons d’une « géographie environnementale » en tant qu’elle est elle-même travaillée et transformée par cet adjectif.
Une géographie contre le déterminisme ?
Comment comprendre la difficulté de certains géographes et de la géographie à saisir le tournant environnemental ? Faut-il y voir un attachement au modernisme qui empêcherait toute rencontre avec la question environnementale, sauf à parler de modernisation écologique, faisant obligatoirement de l’Homme le maître de la nature ?
Intégration et césure de la géographie
La géographie européenne de la fin du XIXe siècle et du début du XXe s’est construite sur le modèle des sciences naturelles et a été une des premières disciplines à développer une démarche englobante incluant l’étude des sociétés humaines et des milieux naturels.
A travers les concepts de milieu et de paysage, les géographes de cette période ont tenté de comprendre la relation société-nature en articulant le social au biophysique. Les géographes cherchaient à analyser la manière dont les sociétés modèlent la matérialité de la nature. Mais la question du déterminisme amène les géographes français du début du XXe siècle à s’extraire d’un cadre naturaliste en s’inscrivant dans un positionnement radicalement possibiliste, abandonnant alors l’objectif de constituer un véritable appareillage méthodologique et conceptuel pour appréhender la société. De là, une césure entre une géographie physique visant à reconstituer le milieu naturel et ses évolutions sous l’effet de forces telluriques et d’agents climatiques, ou, de manière subalterne, les distributions des groupement végétaux, ignorant ainsi l’action perturbatrice des humains ; et une géographie humaine, s’attachant à l’étude des paysages et aux pratiques sociales qui le produisent en transformant les milieux.
La géographie française, c’est-à-dire majoritairement vidalienne, n’était pas une science sociale. C’est avec le tournant spatialiste des années 1960 que la géographie s’approchera davantage d’un modèle de sciences sociales en extrayant de son champ de vision la question naturelle, celle-ci réduite à une question de localisation et de déplacement d’une ressource, et la biosphère considérée comme un réservoir de matières inépuisables ou un postulat de recherche ceteris paribus. Il s’agissait alors de contester la géographie classique en abandonnant les notions de paysage et de milieux, et en s’orientant, pour une partie importante de la discipline, vers des analyses quantitativistes utilisant, en les spatialisant, les données statistiques sociales et économiques. Cette nouvelle géographie « hors-sol » faisait pendant à une géographie physique éclatée en sous-disciplines (géomorphologie, climatologie, hydrologie, biogéographie) d’où étaient exclues les questions se rapportant aux comportements humains ou aux valeurs. La division entre géographie humaine et géographie physique a longtemps primé.
Lourdeurs historiques face à l’environnement
Aujourd’hui, les choses semblent n’avoir bougé qu’à la marge et la discipline reste encore trop souvent réticente ou embarrassée lorsqu’il s’agit de traiter des problèmes écologiques. Si les géographes français abordent désormais ce champ d’investigation, ils le font généralement de manière prudente et apolitique, ce qui témoigne de la méfiance dont l’institution fait preuve à propos de cet objet dont on pourrait presque croire que la « demande sociale » la charge à son corps défendant.
Une autre géographie est possible : l’exemple de la political ecology
L’ampleur de la difficulté que la géographie française a eue à intégrer la problématique environnementale prend tout son relief dans la comparaison avec l’évolution de la discipline aux États-Unis. Là-bas, la géographie a considéré davantage la nature comme une question sociale, portée en cela par un contexte où la « nature » a constitué un facteur de construction d’une identité nationale (Nash, 1967). L’ouvrage du diplomate et géographe George Perkins Marsh, Man and Nature (1864), a jeté les bases d’une analyse compréhensive des dynamiques de dégradation des espaces naturels par les sociétés humaines.
Dans la première partie du XXe siècle, la géographie institutionnelle se divise en deux écoles principales.
- L’école du Middle West adopte une approche régionaliste dans laquelle les conditions environnementales sont principalement vues comme des contraintes.
- À l’inverse, l’école de Berkeley, rassemblée autour des travaux de Carl Sauer, se préoccupe directement d’environnement dans une ouverture qui préfigure des travaux d’écologie politique : approche paysagiste, critique de la mondialisation et de l’eurocentrisme, défense des milieux naturels.
En 1956, les géographes contribuent largement à l’ouvrage collectif Man’s Role in Changing the Face of the Earth, notamment le Français Pierre Gourou. Malgré cela, les géographes anglophones manquent le train de la montée politique de la question environnementale dans les années 1970, occupés qu’ils sont à révolutionner la discipline par une approche quantitative ou à traiter de questions environnementales spécialisées et ponctuelles.
On peut donc dire que la discipline des années 1970 se trouve sensiblement dans la même position des deux côtés de l’Atlantique. Pourtant, les deux vont suivre des itinéraires très différents dans les décennies suivantes. Dans le monde anglophone, la political ecology va rapidement se construire dans le milieu universitaire, en particulier dans les départements de géographie, d’anthropologie et de sociologie rurale. Fondée sur une analyse politique des enjeux d’environnement, et notamment de la tendance à naturaliser les processus de dégradation des milieux, elle développe, sur fond marxiste, une double critique : d’une part, en prenant en compte des éléments négligés par les approches écologiques, en particulier les déterminants économiques ou politiques qui interviennent directement sur les processus naturels ; d’autre part, en luttant contre des postures néomalthusiennes et en portant une attention particulière à la déconstruction des discours qui justifient les actions de gestion de milieux, comme ceux concernant les paysans que les rhétoriques officielles accusaient d’être la cause des dégradations de l’environnement. Dans ce contexte, les géographes ont pris une part active dans le développement d’une écologie politique universitaire, au point que la political ecology est dominante comme sous- discipline de la géographie dans les années 1990.
En France, l’écologie politique est représentée par des auteurs qui, dès les années 1950, pensent de manière politique la place de l’environnement dans nos sociétés. Mais la géographie est, pour tout dire, absente de ces débats, à quelques exceptions près, dans lesquelles on discernera des traits d’écologie politique sans que le terme ne soit utilisé par les auteurs eux-mêmes. Il faut attendre la fin des années 1980 pour voir se multiplier les études de géographie de l’environnement ; néanmoins celles-ci ne s’inscrivent pas dans le cadre de l’écologie politique, jugée trop « engagée . Aujourd’hui donc, la political ecology telle qu’elle s’est formée dans les pays anglophones se trouve très largement institutionnalisée dans le corps académique, notamment aux États-Unis dans les départements de géographie. Parallèlement, l’écologie politique française, issue d’une longue culture de critique économique, sociale et politique des questions écologiques, est dépourvue d’une structuration universitaire équivalente à son homologue états-unienne et relève davantage, loin du monde des géographes français, d’une institutionnalisation partisane et d’une activité transdisciplinaire (notamment autour de la revue Écologie & Politique). Cependant, ces différences se réorganisent à mesure que les échanges entre communautés épistémiques se font plus denses, selon des formes où les processus de globalisation-domination de l’anglais exacerbent les tensions entre géographie de l’environnement en France et political ecology anglophone.
Une géographie apolitique ?
La géographie du XIXe siècle, en consolidant ses orientations épistémologiques, ses démarches et ses institutions, défrichait une voie dans laquelle l’imbrication des sociétés et de la nature était centrale ; notamment à travers le concept de milieu. Ce concept est travaillé par Élisée Reclus, mais également par Paul Vidal de La Blache. L’opposition entre approche déterministe et approche possibiliste s’est ainsi affermie plus tard, dans un contexte où les sciences sociales (et notamment l’histoire, sous l’impulsion de Lucien Febvre) se distinguaient des sciences naturalistes.
De la réticence des géographes français à aborder politiquement la question écologique
Vous souhaitez lire la suite ?
Actifs dans le débat public sur l'enseignement de nos disciplines et de nos pratiques pédagogiques, nous cherchons à proposer des services multiples, à commencer par une maintenance professionnelle de nos sites. Votre cotisation est là pour nous permettre de fonctionner et nous vous en remercions.