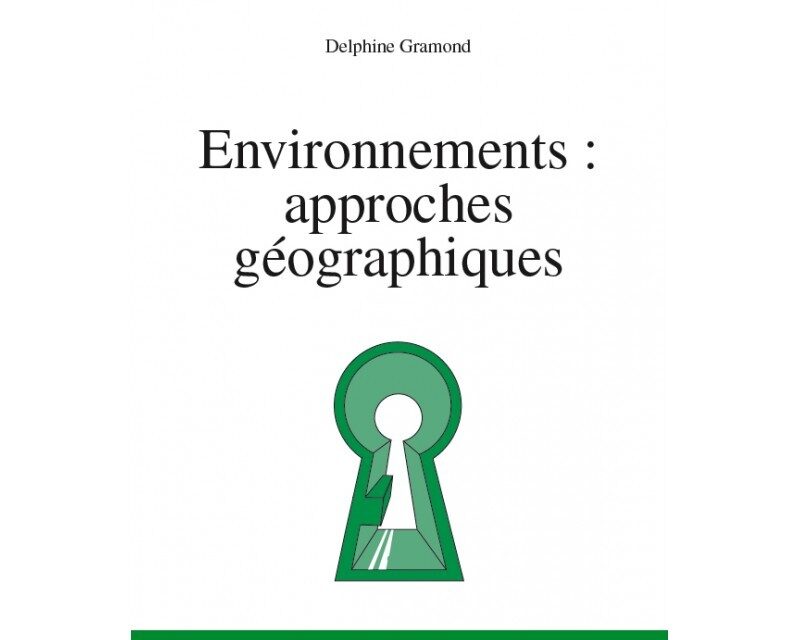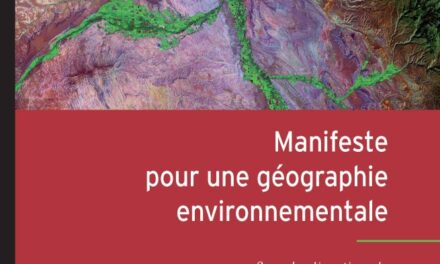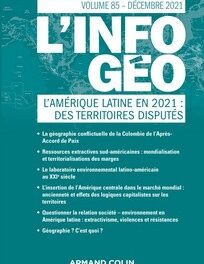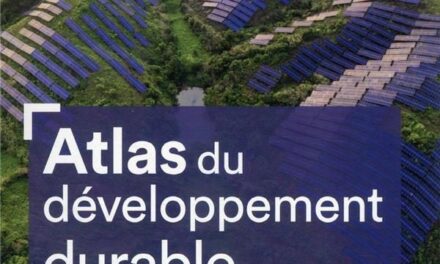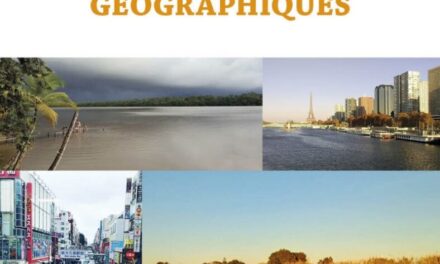INTRODUCTION GÉNÉRALE
étude de l’évolution du concept, approche complexe, multidimensionnelle et relative, englobant non seulement des éléments naturels et matériels mais aussi sociaux, politiques et culturels ; dans les programmes scolaires, l’environnement est abordé à travers les notions de « développement durable » ou de « transition » ;
objectif : comprendre la façon dont le concept environnement est encadré, développé et enseigné en allant des fondements théoriques aux applications pédagogiques ;
étude de l’anthropocène = ère où l’influence humaine est devenue le principal moteur des changements planétaires ; réflexion sur les changements globaux, y compris les évolutions sociétales ;
4 exemples étudiés:
- les risques environnementaux = résultats de l’interaction complexe entre les sociétés et leur environnement ; → apport des sciences sociales nécessaire ; inégale vulnérabilité des sociétés face à ces risques
- les environnements arctiques = régions les plus touchées par les changements climatiques ; fonte des glaciers, du pergélisol, rétractation de la banquise ; élévation du niveau des mers
- la crise de la biodiversité
- le géo-patrimoine = construit hybride à dimension naturelle, sociale et culturelle ; focus sur la forêt française
étude des impacts environnementaux indirects des changements dans les systèmes de production comme la métropolisation ou la littoralisation ;
6 défis environnementaux étudiés :
- transition dans les systèmes agricoles et alimentaires de l’Afrique subsaharienne
- risques environnementaux dans les contextes urbains du Sud
- urbanisation rapide et santé publique
- impact environnemental des transports
- protection et mise en valeur des littoraux
- potentiel de énergies marines
FONDEMENTS THÉORIQUES ET CONCEPTUELS DE L’ENVIRONNEMENT EN GÉOGRAPHIE
L’ENVIRONNEMENT, UN CONCEPT GÉOGRAPHIQUE
selon Bernadette MERENNE-SCHOUMAKER :
concept = produit de la science ; démarche déductive, hypothèse et vérification d’hypothèses notions : issues du monde empirique = observations de faits expliqués de manière inductive ;
ex : habitat groupé/habitat dispersé = notion environnement = concept
I/ Une définition à géométrie variable
l’environnement n’existe pas en soi, il est toujours relatif à un espace, à un sujet aussi bien individuel que collectif ou à un système-coeur ;
environnement = englobant sur lequel l’englobé a prise ( LÉVY et LUSSAULT) ; sens étroit : environnement naturel (eau, air, sol, flore, faune)
environnement physique = tout ce qui est matériel et construit par l’homme ; mais terme ambigu, on peut lui préférer environnement matériel ;
au sens large : interaction d’éléments naturels, matériels, sociaux, politiques, culturels, psychologiques ,… Florian CHARVOLIN, sociologue de l’environnement : « ce n’est que quand on aura remonté les chaines de causes entre l’ici et le lointain, entre le contemporain, le passé ou le futur, que pourra être établi l’environnement » ;
au cours des années 1970, l’environnement est associé à l’écologie, sciences des relations entre les êtres vivants et leur milieu naturel, puis à l’écologisme = courant politique visant à un meilleur équilibre entre l’homme et son environnement ;
ex : 100 mesures pour l’environnement, juin 1970, gouvernement CHABAN-DELMAS ;
1972 : conférence des NU sur l’environnement, Stockholm ; en lien avec la publication du rapport Meadows, Les limites de la croissance, 1972, qui alerte sur la pénurie des ressources ;
le terme environnement s’enracine alors dans les sociétés et connait une inflation rapide de ses emplois ;
la géographie entame également dans les années 1970′ un tournant environnemental en adoptant le référentiel de l’environnement ; permet de reconnecter géographie humaine et géographie physique qui étaient devenues étanches l’une à l ‘autre ;
contribue à la diffusion du courant systémique ;
Pierre MERLIN : « l’environnement est un système » = ensemble cohérent d’éléments qui agissent et réagissent les uns sur les autres ;
l’approche par territoire, proprement géographique, à toutes les échelles, est privilégiée ;
II/ L’ENVIRONNEMENT OU LES ENVIRONNEMENTS ?
l’usage du pluriel nécessite de de croiser la géographie avec d’autres disciplines comme le droit ; renouvellement de la géographie physique, qui intègre complètement le fait social ;
Georges BERTRAND a pris en compte des composants anthropiques dans le concept de géosystèmes
→ l’humain a pris entièrement place dans les complexes territoriaux ;
le géosystème relie des composants :
- abiotiques (lithomasse, aéromasse, hydromasse) = géome
- biotiques (phytomasse et zoomasse) = biome
- anthropique
renouvellement de la géographie sociale (étude de l’organisation des sociétés et de la dynamique sociale des dynamiques spatiales) ; les organisations sociales sont pensées comme des environnements emboités ;
géopolitique (étude des rapports de force dans l’espace) : l’environnement est un actant activé par des acteurs multiples qui ne sont pas forcément inclus dans cet environnement ; → diverses configurations spatiales : contrôle exclusif, collaboration, partition, conflit ;
dans les années 1970′-80′, l’approche environnementale a contribué à une refonte structurelle de la politique publique de l’aménagement en France , l’aménagement est désormais systématiquement envisagé dans l’aspect durable ; → procédures réglementaires, démarches contractuelles ;
géographie culturelle (étude du vécu, des perceptions, des représentations de l’espace approprié et ressenti) → caractérisation subjective de l’environnement → des environnements, selon les différentes perceptions ;
ouvrage de référence : The perception of environnement, Tim INGOLD, 2000 ; l’auteur développe le concept d’internalisation progressive de ce qui est à l’extérieur pour passer d’une perception du local à une perception du global ;
III/ Un concept culturellement construit
nécessité de l’usage du pluriel pour prendre en compte la variété des constructions du concept en fonction des contextes nationaux et socio-culturels ;
la conquête de l’Ouest américain (de 1803 =vente de la Louisiane aux EU par la France à la fin fin XIXè
=soumission de l’ensemble des tribus amérindiennes) a marqué une rupture dans les rapport nature- société ;
le terme anglais environnement a été associé à cette idée de conquête ;
Philippe DESCOLA développe le concept de naturalisme pour décrire cette représentation d’un environnement comme une ressource à exploiter, prenant source dans les écrits de DESCARTES et de VON HUMBOLDT ; DESCOLA oppose cette conception occidentale à celle des Achuars (peuple amazonien) qu’il qualifie de sur-adaptés à la nature, à tel point que celle-ci n’existe pas pour eux ; il n’y a pas de dualisme nature/société car plantes comme animaux sont des partenaires sociaux, dotés d’une
« dignité de sujets » avec qui une communication est établie ;
la conception japonaise de l’environnement est elle basée sur un rapport intériorisé à l’environnement (c’est en éprouvant le froid que l’être humain conçoit le froid extérieur) ;
l’environnement est un construit à replacer dans un contexte socio-culturel ; de même que Bruno LATOUR parle de natures-cultures en niant l’idée d’une nature universelle, il n’y a que des
« environnements-cultures »
IV / Corollaires et termes voisins
➤ espace géographique = ensemble des combinaisons physiques, économiques et sociales s’exerçant sur un espace donné ;
➤ milieu ; VIDAL DE LA BLACHE imaginait l’environnement comme une enveloppe d’extériorité, ce qui ne caractérise pas le milieu ;
le biologiste Jakob VON UEXKÜLL introduit le concept d’environnement signifiant appelé l’Umwelt (ex : pour la tique : les mammifères à sang chaud) de l’Umgebung, le reste, l’environnement non signifiant
➤ nature = éléments biologiques et écologiques de l’environnement = tout ce qui existe hors de l’être humain et de son action ;
la nature a fait l’objet d’une idéalisation
1971 : ministère de la protection de la nature et de l’environnement , sous-entendu l’environnement peut être dégradé par les atteintes de l’homme à la nature ;
➤ développement durable ; associé au respect d’objectifs environnementaux mais dans une logique utilitariste : se développer durablement pour conserver à terme son bien-être et son confort matériel ;
définition de 1987, rapport Brundtland : « développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs » ;
certains rejettent cette notion de développement durable qu’ils estiment totalement dépassée pour répondre aux urgences du changement global ou par d’autres qui rejettent le bien-fondé même de la notion de développement ;
➤ changement global = ensemble des transformations inhérentes au changement climatique (années 2000)
= résultat systémique de changements aux multiples dimensions jusqu’à engendrer un nouveau système ;
➤ transition ; = passage d’un état à un autre ou état après le changement ;
➤ transition écologique ; ex : monde rural ; pourvoyeur de ressources → support de pratiques agricoles respectueuses de la nature et de nouvelles fonctions (énergie renouvelables, tourisme ,…)
V/ Dans la géographie scolaire
Ernest LEVASSEUR et Auguste HIMLY sont les instigateurs des programmes scolaires de géographie en 1872 ;
ce n’est qu’en 1968 que le CNRP intime de mettre fin à une vision encyclopédique et purement descriptive de la géographie, vu comme un assemblage de pièces de puzzle ;
plusieurs propositions de réforme :
- introduire un paradigme d’interface société/nature
- introduire des enjeux géopolitiques
- sortir de l’européocentrisme
- intégration des sciences sociales
l’environnement a pris sa place dans ce champ de réformes, il est considéré comme une question socialement vive (p 267) → outil de renouvellement des programmes scolaires ;
apparition y compris en histoire du concept dans les programmes en 2015, puis en 2020, à tous les niveaux (6è : environnement à la préhistoire, 5è environnement dans les campagnes féodales, 4è nouveaux rapports à l’environnement lors de la révolution industrielle ,…)
programmes de géographie de 2015/2020 :
- environnementaux : 30 occurrences ; le premier terme de l’intitulé général du programme de seconde ;
- milieu : 13 occurrences
- changement global : 10 occurrences
- transition : 5 occurrences
usage polysémique du terme environnementaux : souvent employé en lien avec le milieu ;
la notion de risques introduite en 2008 ne répond pas selon Caroline LEINIGER-FRÉZAL à une démarche scientifique car la présentation se limite à une entrée par les catastrophes et une maitrise par
des solutions technologiques propres aux pays développés ;
les programmes scolaires portent aussi un message écologiste, incitant l’élève-citoyen à devenir acteur dans la transition écologique ; cette tendance « comportementaliste » a été dénoncé par certains auteurs qui déplorent le déficit en réflexion que cela engendre ;
le concept d’environnement permet une ouverture spatio-temporelle, c’est un vecteur de décentrement spatial (étude de la Chine, de l’Afrique australe, …) et l’instrument de prospectives temporelles (La ville de demain en 6è)
les programmes invitent avec ce concept à travailler en interdisciplinarité, particulièrement avec la SVT ;
le cas particulier du programme de 5è dédié à la notion de développement durable ; il décline, thème après thème, les différents ODD édictés par l’ONU = volonté de promouvoir une géographie connectée et globalisée ;
l’ONU avec ses programmes EDD (éducation au développement durable) et ERE (éducation relative à l’environnement) incite à des méthodes de travail actives, vivantes et participatives ;
une éducation à l’environnement et non de l’environnement
de nombreux projets ont cours pour sensibiliser les élèves à leur environnement, une sensibilisation qui se veut effectivement sensible afin de se former une identité écologique (expression de Mitchell THOMASHOW) ; mais ce sont des initiatives locales, le programme lui-même incitant peu à varier les approches pédagogiques ;
ÉPISTÉMOLOGIE ET HISTOIRE DE L’ENVIRONNEMENT EN GÉOGRAPHIE
Introduction
à partir des années 1970′, le terme environnement est devenu un marqueur de la « néo-géographie » de par la dimension dynamique qu’il recouvre, il oblige à une « nouvelle intelligence de l’espace, défini dynamiquement en terme de flux » (François DAGOGNET, philosophe) ; ce concept a également permis une meilleure articulation avec les autres sciences ;
Vous souhaitez lire la suite ?
Actifs dans le débat public sur l'enseignement de nos disciplines et de nos pratiques pédagogiques, nous cherchons à proposer des services multiples, à commencer par une maintenance professionnelle de nos sites. Votre cotisation est là pour nous permettre de fonctionner et nous vous en remercions.