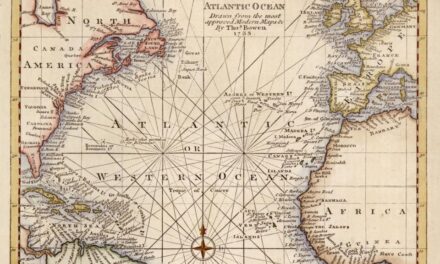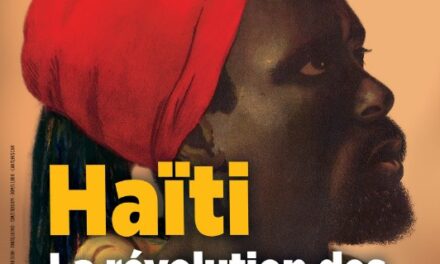Se fondant sur deux décennies de recherche dans les Archives nationales, celles de presque tous les 83 départements créés en 1789 et de nombreuses archives municipales, la Bibliothèque nationale et celles locales, le livre de Melvin Edelstein réaffirme la place de la Révolution française comme l’un des ancêtres de la démocratie moderne. En même temps que la révolution américaine, la Révolution française donne naissance aux élections démocratiques à la fin du dix-huitième siècle. Dans ce livre, nous sommes les témoins de la création de la démocratie moderne. Face au cynisme général concernant les élections aujourd’hui, il est rassurant de découvrir des élections tenues sans l’influence néfaste de l’argent, des médias et des groupes d’intérêt. Malgré les difficultés de son accouchement, l’apprentissage de la démocratie en France a laissé un héritage durable pour le développement de la démocratie moderne en France, en Europe et dans le monde entier. Ce livre est essentiel pour les historiens, les politologues, les sociologues et tous les lecteurs qui s’intéressent aux origines de la démocratie libérale moderne.
Dans l’imaginaire populaire, la Révolution française évoque encore parfois l’image créée par Charles Dickens : Madame de Farge tricotant alors que roulent les têtes des victimes de la Terreur. Mais la Terreur ne fut qu’éphémère alors que la Révolution a laissé en héritage les élections démocratiques. En effet, l’urne est un symbole beaucoup plus fort de cet important bouleversement que la guillotine. La Révolution française a fait des élections le fondement de la légitimité politique, l’expression de la volonté populaire, le mode de sélection du personnel politique et rendu responsables les élus. Des élections des États généraux en 1789 jusqu’à l’accession de Napoléon par le moyen du plébiscite constitutionnel de 1799, des millions de citoyens ont voté dans au moins vingt consultations pendant la décennie révolutionnaire.
Thèse centrale de l’ouvrage
Melvin EDELSTEIN soutient que la Révolution française a été le moment fondateur de la démocratie électorale moderne. Il montre comment l’élection, absente de l’Ancien Régime (ou strictement encadrée), devient au cours de la Révolution un mode central de légitimation du pouvoir, marquant une rupture politique, juridique et symbolique majeure.
Le cœur de l’ouvrage est la transformation politique majeure introduite par la Révolution française : le passage de la souveraineté royale à la souveraineté populaire, via le vote et l’élection, c’est-à-dire l’invention concrète de la démocratie électorale.
Cela correspond pleinement aux problématiques de la question, qui invite à penser les révolutions non seulement comme des ruptures politiques, mais aussi comme des laboratoires d’expériences démocratiques, parfois très différentes d’un pays à l’autre.
EDELSTEIN montre que l’élection devient une modalité centrale du nouveau régime, dès 1789 avec les États généraux, puis dans la mise en place des assemblées constituantes, des municipalités, des juges, etc.
Il insiste aussi sur le caractère inédit, massif et expérimental du suffrage dans la période, avec des débats sur le suffrage censitaire vs. universel, sur les procédures, les pratiques de vote, les tensions entre participation et représentation.
Limites de l’ouvrage
Le livre est centré exclusivement sur la France, sans étude comparée directe. Il accorde par ailleurs peu de place accordée à la dimension coloniale ou aux femmes. Enfin, c’est un ouvrage parfois daté dans ses cadres d’interprétation (historiographie des années 1970).
Table des matières
Préface de Michel VOVELLE 3
Chapitre I – Les élections aux États généraux de 1789 7
Chapitre II – La transformation des sujets en citoyens 10
Chapitre III – Les premières élections municipales 17
Chapitre IV – Les premières élections cantonales de 1790 18
Chapitre V – La politisation des élections et l’émergence d’une nouvelle élite politique en 1790 19
Chapitre VI – La culture électorale révolutionnaire et les dynamiques du vote en assemblée 20
Chapitre VII – Les élections des juges de paix : école de la citoyenneté moderne 21
Chapitre VIII – Les élections de juin 1791 pour la constitution de la première assemblée législative 21
Chapitre IX – Les élections de juin, août et septembre 1791 et le renouvellement des élites 22
Chapitre X – L’établissement de la Première République française 23
Chapitre XI – Le vote sur les constitutions de 1793 et de l’an III 24
Chapitre XII – La transformation de la politique électorale sous le Directoire et l’ère napoléonienne 26
Conclusion 28
Préface de Michel VOVELLE
Jean-René SURATTEAU dans les années 1950 est l’un des seuls à se risquer à étudier les élections de la période directoriale. En 1980, tournant avec une multiplication des recherches sur les élections. Melvin EDELSTEIN fait le choix des élections comme une voie privilégiée d’une expression de démocratie politique. L’auteur trouve comme un partenaire avec Patrice GUENIFFEY (élève de François FURET) qui a dans son ouvrage Le nombre et la raison a développé une lecture critique de l’expérience électorale française sous la Révolution.
Le principe électoral généralisé est une des singularités majeures de l’opinion démocratique naissante.
Au début, empressement plus grand des électeurs pour les scrutins de proximité plus attirants que les consultations nationales.
Michel VOVELLE : « La révolution invente la citoyenneté moderne, reposant sur l’individualisation du vote, manifestation de la souveraineté populaire ». (p. 14)
L’approche de Melvin EDELSTEIN est relativement comparatiste.
Les Grecs ont inventé la démocratie directe mais la démocratie représentative est un héritage des révolutions américaine et française. Ainsi, les citoyens font les lois par l’intermédiaire de leurs représentants élus. Les élections sont la seule façon de légitimer l’autorité, de désigner des hauts fonctionnaires. René RÉMOND : « De la désignation par les électeurs, la Révolution a fait l’usage le plus extensif qui se puisse concevoir et qu’ait connu notre société. […] la Révolution a substitué le choix par les citoyens à tous les autres modes de recrutement et de sélection » .
De 1789 à 1799, la France a appliqué de façon très extensive le principe électif. P. GUENIFFEY estime que 1.2 million de charges publiques électives furent créées en 1790. Près de 4.3 millions d’individus masculins adultes reçurent le droit de vote en 1791 et ils furent environ 6 millions en 1793 (chiffres énormes pour l’époque).
Le mot « élection » en lui-même a évolué entre le XVIIIe et le XIXe siècle. Ainsi par exemple, dans le Dictionnaire de l’abbé Expilly et celui de Bruzen de la Martinière (1768), le mot désignait une circonscription financière administrée par un élu. Il désignait aussi l’électorat de certaines régions d’Allemagne, où les souverains avaient le droit de voter pour élire un nouvel empereur. Le Dictionnaire de l’Académie française (1762) : « Action d’élire, choix fait par plusieurs personnes » citant le cas de l’empereur du Saint Empire romain. Evolution dans la 6e édition publiée en 1832-1835 : « Action d’élire, choix fait en assemblée par voie des suffrages ».
Enfin, dans le Dictionnaire de la langue française d’Émile Littré (1872-1877) : « Choix qui est fait de quelqu’un en assemblée et par voie de suffrage » (élections municipales et législatives en particulier).
Jusqu’à très récemment, les historiens spécialistes de l’histoire politique de cette période, ne parlaient pas des élections.
Au XIXe siècle, peu d’intérêt pour cette question. Tournant avec la IIIe République, les élections étant une des caractéristiques du régime démocratique, les historiens ont pris conscience du rôle important qu’elles avaient joué pendant la Révolution. La célébration du Centenaire (1889) contribua à renouveler l’intérêt des historiens pour cet évènement fondateur.
Si le tournant du XIXe siècle fut l’âge d’or de l’histoire électorale, tous les ouvrages sur la Révolution écrits durant cette période n’étaient pas pour autant élogieux. 2 adversaires de la démocratie, Hippolyte TAINE et Augustin COCHIN, furent les premiers à formuler le concept moderne de complot à propos de la Révolution, et soulignaient l’importance des élections pour la compréhension d’une issue qu’ils considéraient comme fatale. Traumatisé par la Commune, Taine détestait les masses populaires et craignait la démocratie. Aucun des 2 n’étaient historiens ce qui expliquent leur méthodologie. Pour P. GUENIFFEY, leurs travaux constituent néanmoins, « la première sociologie du fait électoral ».
Taine dans son œuvre décortiquait les mécanismes par lesquels une minorité déterminée et sans scrupule avait confisquée les fruits de la démocratie électorale.
Cochin = catholique traditionnaliste. Pour lui, la démocratie française avait pris naissance dans les sociétés de pensée qui s’étaient répandues autour de 1750. Celles-ci étaient devenues des modèles pour les clubs jacobin. Cochin interprétait le vote de 1789, comme la manipulation des assemblées électorales par une minorité de militants. Il explique qu’alors qu’il était impossible pour les votants de faire des choix pertinents, les cahiers de doléances furent néanmoins rédigés et les députés élus comme par magie. Pour lui, les votants étaient manipulés par un groupe anonyme, sans en avoir conscience, il parle d’une « machine électorale » et dont l’objectif était d’éliminer les ennemis potentiels. Ces idées ont influencé la pensée de François FURET et de Ran HALÉVY, et ont servi de modèle à l’analyse de GUENIFFEY concernant les élections révolutionnaires.
Pendant l’entre-deux-guerres, un regain d’intérêt pour l’histoire sociale empêcha l’essor d’une histoire politique de la Révolution. Les historiens s’intéressèrent plutôt au Directoire (étude des plébiscites constitutionnels de la Révolution et de la période napoléonienne ainsi que les élections sous Napoléon).
Après-guerre, l’attention est portée sur les conditions de vote ainsi que sur l’éligibilité et les élections à la Convention.
Tout au long du XXe siècle, les chercheurs français firent œuvre de pionniers dans l’étude de la sociologie électorale. L’analyse des élections était considérée comme fondamentale dans la compréhension scientifique de la vie politique de la nation.
Cette tradition fut initiée par André SIEGFRIED dans son Tableau Politique de la France de l’Ouest sous la Troisième République, publié en 1913. Son étude des élections législatives dans l’Ouest, de 1876 à 191à, lui permit de dégager 3 facteurs principaux ayant une influence sur le comportement politique : la relation au sol (le type de propriété et de culture), l’habitat et la religion. Son disciple, François GOGUEL publia un ouvrage avec de nombreuses cartes pour étudier l’évolution géographique des opinions politiques de 1870 à 1951, et une comparaison entre géographie politique et géographie sociale. Il y examinait aussi les causes de la participation électorale et de l’absentéisme.
Maurice AGULHON considérait l’histoire électorale de la France avant 1848 comme « la préhistoire de la démocratie moderne ». Pour Raymond HUARD si le suffrage universel était apparu pendant la Révolution (trop éphémère), pour lui, 1848 est le véritable point de départ de l’histoire du suffrage universel en France.
A cette période, véritable consensus autour de l’idée que l’histoire électorale de la France contemporaine commençait avec la Deuxième République.
Les historiens de la Révolution ne réussirent pas à modifier cette vision de l’apprentissage de la démocratie. La situation change dans les années 1960-1970, avec la parution de travaux annonçant la naissance d’une sociologie électorale de la Révolution.
Deux ouvrages : une étude de Paul BOIS sur la Sarthe en 1960 et une analyse politique de l’Alsace par Roland MARX en 1966 = ouvrirent un nouveau chapitre de l’histoire électorale de la Révolution. L’originalité de MARX réside dans l’analyse de l’impact des conditions de vote et d’éligibilité sur le corps électoral, sur la participation électorale et sur la composition socioprofessionnelle du personnel politique. L’ouvrage de ce dernier poussa Jean-René SURATTEAU à réfléchir aux difficultés que rencontraient les chercheurs intéressés par la sociologie électorale de la Révolution, pointant les obstacles qui empêchaient l’exploitation quantitative et qualitative des sources. 3 questions essentielles pointées par lui dans le livre de Marx :
- Une analyse sociologique de l’électorat et des élus nécessaire
- Problème du niveau de participation et d’abstention
- Le vote des assemblées électorales départementales ne correspondait pas exactement aux opinions des votants
En soulignant les difficultés rencontrées par les historiens, Suratteau réussit à décourager toute tentative sérieuse de recherche en sociologie électorale de la Révolution.
L’article de Melvin EDELSTEIN, publié en 1975 était une synthèse de ce que les historiens avaient découvert. Il y soulignait les contradictions contenues dans leurs conclusions sur la participation électorale des citadins et des campagnards de 1789 à 1793 . Il espérait susciter de nouvelles études qui feraient la lumière sur le comportement politique des votants des villes et des campagnes.
Dans les années 1980, l’analyse socio-économique qui avait dominé le champ de l’historiographie révolutionnaire pendant des décennies fut enterrée. Le décès subit de Soboul en 1982 et son remplacement l’année suivante par Michel VOVELLE inaugurèrent une période de transition entre histoire sociale et histoire politique. Cet historien s’est attaché à la « redécouverte de l’histoire politique » qui créent un nouveau paradigme, celui de la « culture politique ».
Selon François FURET, la Révolution avait inventé une culture politique démocratique et l’avait révélée au monde. Elle représentait la première expérience de démocratie de l’époque moderne. Influencé par Cochin, il expliquait la Révolution avec les mots de la linguistique. Le vide politique provoqué par l’effondrement de la monarchie avait été envahi par la rhétorique politique démocratique : l’idéologie avait remplacé le pouvoir. Les Jacobins, incarnaient la sociabilité démocratique et en prenant le pouvoir, ces derniers avaient tenté d’organiser la société sur un mode politique et idéologique. La Révolution avait glissé vers ce qu’il appelait la démocratie pure, pour aboutir finalement à la terre. Furet affirmait que la Révolution avait inventé la culture démocratique moderne, mais il la croyait ancrée dans le discours et l’idéologie plutôt que dans la société et les institutions : il ne tenait pas compte des pratiques politiques concrètes, de la politique électorale et de la sociologie politique.
Son principal disciple Keith BAKER, fit tout pour accélérer le passage de l’histoire sociale à l’histoire politique. Il défend l’idée de culture politique mais pour Melvin EDELSTEIN , vision trop abstraite et étriquée, privilégiant le discours, la théorie politique, l’analyse de textes plutôt que les véritables pratiques politiques (élections notamment). Vision centrée sur une élite et sur Paris, prenant peu en compte l’histoire sociale et des questions de genre.
L’approche du bicentenaire donna à Baker et à Furet l’occasion de diffuser leurs opinions révisionnistes. Des textes ont suivi mais aucun ne portaient sur les élections sauf 2 essais sur le règlement du 24 janvier 1789.
Pour Lynn HUNT, la Révolution était fondamentalement politique : elle a généré un langage commun et des symboles mais aussi une nouvelle classe politique qui donnait une cohérence à la culture politique. Son unité était cimentée par une série de valeurs partagées. En créant une tradition de démocratie républicaine, la Révolution avait provoqué une « révolution dans la culture politique ». Lynn Hunt ne s’est pas intéressée aux pratiques électorales, mais le fait qu’elle se soit concentrée sur les résultats électoraux a fait d’elle une pionnière dans l’histoire électorale de la Révolution. Elle fut aussi la première à tracer la géographie politique des années 1792-1799.
L’âge d’or des études sur les élections de la période révolutionnaire débuta dans les années 1990. La parution du livre de GUENIFFEY sur la Révolution française et les élections fut le premier ouvrage d’importance sur le sujet suivi peu de temps après par celui de Malcom CROOK, Elections in the French Revolution, premier livre en langue anglaise à explorer la question.
En 1999, un groupe de chercheurs de l’Institut d’histoire de la révolution française publia un guide à l’usage des jeunes chercheurs intéressés par l’étude des élections de la décennie révolutionnaire.
Sur le livre de Gueniffey : « critique pugnace » de l’expérience électorale révolutionnaire (Isser WOLOCH).
EDELSTEIN note les faiblesses de l’ouvrage de GUENIFFEY. Pour Jeff HORN, la principale faiblesse de cette thèse est l’insistance de l’auteur sur les évènements nationaux alors que pour lui, c’est seulement au niveau local que peut être appréhendé le caractère essentiel des pratiques et des principes démocratiques dans la politique révolutionnaire . Il prend comme exemple le département de l’Aube où la montée en puissance du club jacobin fut profondément démocratique et les élections de 1790-1793 constituèrent un véritable apprentissage de la démocratie.
L’objectif de ce livre est d’étudier la naissance de la démocratie électorale pendant la Révolution et la création d’une culture politique moderne entre 1789 et 1799.
Dans un sens plus large, ce livre étudie la démocratie populaire et est par conséquent centré sur la participation aux assemblées électorales, primaires et secondaires. Il s’intéresse principalement aux pratiques et aux comportements électoraux : il propose une explication du processus électoral et de ses résultats. Il analyse les procédures et les pratiques électorales ainsi que les taux de participation ; à partir d’un corpus très large de données quantitatives. S’il s’intéresse essentiellement à l’histoire politique, il analyse aussi l’aspect social, à la composition socioprofessionnelle des élus mais aussi à la géographie électorale et propose un aperçu de ce que VOVELLEappelle la « géopolitique » de la Révolution. Les élections sont nombreuses et de type varié.
La Révolution n’offre pas un contexte favorable pour l’étude des élections. L’absence de partis politiques, de campagne électorale et de candidats déclarés rend problématique tout interprétation des résultats électoraux.
Ce livre présente une synthèse des élections entre 1792 et 1799 à partir de sources secondaires. Il constitue à ce jour, l’étude la plus complète sur les élections révolutionnaires, et, malgré les difficultés rencontrées, il permet de réaffirmer que la Révolution française, comme la révolution américaine, a donné naissance à la démocratie électorale.
Chapitre I – Les élections aux États généraux de 1789
Vous souhaitez lire la suite ?
Actifs dans le débat public sur l'enseignement de nos disciplines et de nos pratiques pédagogiques, nous cherchons à proposer des services multiples, à commencer par une maintenance professionnelle de nos sites. Votre cotisation est là pour nous permettre de fonctionner et nous vous en remercions.