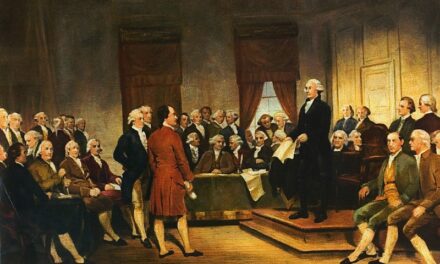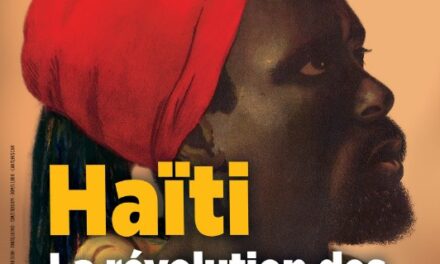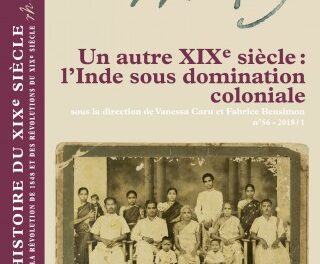Cette composition de plusieurs fiches est proposée pour les candidats qui souhaitent une synthèse complète, chronologique et multi-thématique sur la Révolution française, de 1789 à 1804. Chaque fiche est crée à partir de la lecture d’un ensemble d’ouvrages généraux ou de monographies sur des sujets comme la Terreur, le mythe de Robespierre-roi, la place des femmes en Révolution, le coup d’Etat de Bonaparte, la Contre-Révolution, le rôle de la presse… Elles tiennent également compte de l’historiographie classique, mais aussi et surtout des débats historiographiques récents et des nouveaux champs de recherche actuels.
Cette cinquième fiche porte sur les femmes dans la Révolution française.
Elle peut être accompagnée de la lecture de la Documentation Photographique, dossier numéro 8141, CNRS éditions 2021 (numéro dirigé par Pierre Serna)
Les autres fiches du dossier:
La Révolution française (1): Les débuts de la Révolution française
La Révolution française (2): Les débuts chaotiques de la Première République
La Révolution française (3): La République en crise
La Révolution française (4): Les nouvelles expériences électorales
La Révolution française (6): Etat et religions
La Révolution française (7): La Contre-Révolution
La Révolution française (8): Le symbole révolutionnaire
V. La place particulière des femmes dans la Révolution
A. Des Etats Généraux à la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen : l’apparition des femmes en tant qu’individus et leur éloignement de la citoyenneté politique
Le XVIIIe siècle a une vision « naturaliste » du statut de la femme. La misogynie est l’une des explications, sans en être la seule. Les femmes sont fréquemment reléguées dans leur rôle de mère, d’épouse, de maîtresse du foyer, prolongeant une tradition au long cours. Jean-Jacques Rousseau écrit dans Emile (1762) que « la femme est faite spécialement pour plaire à l’homme », « pour céder à l’homme et pour supporter son injustice », « il est dans la nature des choses que la femme obéisse à l’homme ». Les philosophes des Lumières, les médecins rapportent leur trop grande sensibilité, leur tendance à verser des larmes, la fragilité de leur corps, leur immobilité. Dans les grandes villes, certaines femmes possèdent toutefois un rôle social et culturel important : elles animent les salons, sont les favorites des membres de la cour.
En 1788 et 1789, les salons parisiens de Mme Roland, de Sophie de Condorcet, celui de Suzanne Necker, de Germaine de Staël ou de Louise de Kéralio sont fréquentés par toute l’élite française ; le magasin de Rose Bertin, qui fournit les robes à la reine Marie-Antoinette, est tout aussi fréquenté. Sa boutique est elle-même un salon dans lequel les femmes se retrouvent pour admirer les robes, partager une tasse de thé et engager de longues conversations mondaines.
Sans trop bouleverser la vision traditionnelle des femmes, la Révolution modifie pourtant leur statut au sein du clergé régulier, de la noblesse, de la bourgeoisie et de la roture. Dès le début de l’année 1789, elles peuvent disposer d’une voix lors des élections des délégués aux Etats Généraux et dans la composition des cahiers de doléances. Leur voix peut être utilisée pour réclamer des libertés ou pour les empêcher.
C’est le 24 janvier 1789 que le roi Louis XVI publie les lettres de convocation des Etats Généraux, dont la réunion est prévue le 1er mai suivant. Le texte décrit les modalités de l’élection des délégués des trois ordres, laquelle doit se dérouler entre les mois de février et d’avril.
Dans le cas des moniales, le règlement royal prévoit qu’elles soient représentées par un procureur de leur ordre. Elles ne se déplacent donc pas pour voter mais élisent, à l’intérieur de leur structure monastique, leur propre délégué. Elles rédigent en revanche des cahiers de doléances, dans lesquels elles insistent sur la défense de leur statut, sur la non-taxation de leurs produits et réclament la diminution de la gabelle et une justice plus vertueuse.
Au sein du monde laïc, il est certain que des femmes se sont déplacées et ont participé aux assemblées, aux élections et à la rédaction des cahiers. Dans la noblesse, ce sont les femmes possédant elles-mêmes un fief ; dans le monde rural du Tiers-Etat, ce sont les femmes chefs de feu (les veuves, les femmes célibataires). Quelques femmes ont donc participé aux assemblées au niveau de la paroisse rurale (pour le Tiers-Etat) puis du baillage (pour le Tiers-Etats et la noblesse). Les procès-verbaux conservés de quelques assemblées permettent de repérer les noms de certaines femmes. Il faut ajouter, même si ce sont des fils et des maris qui se sont effectivement rendus aux assemblées, l’influence psychologiques de certaines femmes sur les hommes, les conseils donnés avant de partir, les avis forcés, etc…
Quelques mois plus tard, la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 grave dans le marbre le nouveau statut des français : les anciens sujets deviennent des citoyens. Elle proclame que « tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits » (article 1), mais aussi que « le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation » (article 3) et que « la loi est l’expression de la volonté générale ; tout citoyen a le droit de concourir à sa formation » (article 6). Le texte, toutefois, est écrit dans une circonstance particulière, comme le rappelle Christine Fauré : la Grande Peur et l’abolition des droits féodaux dans la nuit du 4 août. Il fait alterner les mots de « peuple » et de « nation », qui n’ont pas le même sens.
Pour Jean-Claude Caron (La nation, l’Etat et la démocratie en France de 1789 à 1914, Paris, Armand Colin, 1995), le peuple désigne « une catégorie ethnographique définie par une origine commune, une culture, une langue, des coutumes, un genre de vie, une religion… » tandis que la Nation est « la conscience de former un groupe qui a un passé et un avenir commun ». Les femmes font naturellement partie du peuple ; mais le peuple est une communauté qui délègue son pouvoir à la nation. C’est l’Assemblée Nationale, uniquement composée d’hommes, qui est détentrice de la souveraineté.
Dans cette configuration, les femmes se voient reconnaître les mêmes droits civils que les hommes (droit à l’instruction, au travail, à l’expression, à l’opinion…) ; en revanche, la Déclaration ne semble définir que les hommes en tant que « citoyen » au sens strict, dans la continuité des représentations masculines de la souveraineté Les femmes sont reconnues comme faisant partie du « peuple » mais sont exclues de la « nation » qui exerce le pouvoir souverain. C’est à partir de ce cadre législatif initialement ouvert mais limité qu’il faut replacer les réclamations des femmes pendant la Révolution.
B. Que réclament les femmes en Révolution ?
Vous souhaitez lire la suite ?
Actifs dans le débat public sur l'enseignement de nos disciplines et de nos pratiques pédagogiques, nous cherchons à proposer des services multiples, à commencer par une maintenance professionnelle de nos sites. Votre cotisation est là pour nous permettre de fonctionner et nous vous en remercions.
Bibliographie:
- BARTHELEMY Pascale, SEBILLOTTE CUCHET Violaine, « Sous la citoyenneté, le genre », Clio, 43, 2016, p. 7-22
- BIARD Michel, DUPUY Pascal, La Révolution française, enjeux, débats, tendances historiographiques, 1787-1804, Armand Colin, 2004
- BIARD Michel, DUPUY Pascal, La Révolution française Dynamique et ruptures, 1787-1804, Armand Colin, 2008
- BIARD Michel (dir), La Révolution française. Une histoire toujours vivante, Tallandier, 2010
- BIARD Michel (dir), 1792. Entrer en République, Dunod, 2013
- BIARD Michel, BOURDIN Philippe, MARZAGALLI Sylvia, Révolution, Consulat, Empire (1789-1815), Belin, 2014
- DEVANCE Louis, « Le féminisme pendant la Révolution française », Annales Historiques de la Révolution Française, 229, 1977, p. 341-376
- DUPUY Roger, MORABITO Marcel (dir), 1795. Pour une république sans révolution, PUR, 1996
- FAURE Christine, « La prise de parole publique des femmes sous la Révolution française », dossier spécial dans Annales Historiques de la Révolution Française, 344, avril-juin 2006
- FRAISSE Geneviève, Les femmes et leur histoire, Paris, Gallimard, 2010 (1ère édition 1998)
- GODINEAU Dominique, « Autour du mot citoyenne », Mots, 16, 1988, p. 91-110
- GODINEAU Dominique, « Privée par notre sexe du droit honorable de donner notre suffrage… », Cahiers de Cedref, 1996, mars 2008
- GODINEAU Dominique, Les citoyennes tricoteuses. Les femmes du peuple à Paris pendant la Révolution française, Paris, Alinéa, 1988
- GODINEAU Dominique, Les femmes dans la France moderne (XVIe-XVIIIe siècles), Paris, Armand Colin, 2015
- LIGNEREUX Aurélien, La France. Révolution et Empire (1788-1815), Dunod, 2024
- MARTIN Jean-Clément, La Révolution française, une histoire socio-politique, Belin, 2004
- MARTIN Jean-Clément, La révolte brisée. Femmes dans la Révolution française et l’Empire, Paris, Armand Colin, 2008
- MARTIN Jean-Clément, Nouvelle histoire de la Révolution française, Perrin, 2012
- PERROT Michelle, Les femmes ou le silence de l’histoire, Paris, Flammarion, 1998
- SERNA Pierre, Que demande le peuple? Les cahiers de doléance de 1789, Textuel, 2019
- SERNA Pierre, La Révolution Française, La Documentation Photographique, n°8141, 2021
- VERJUS Anne, Le cens de la famille (1789-1848), Paris, Belin, 2002
- VOVELLE Michel, Nouvelle histoire de la France contemporaine. Vol. 1. La chute de la monarchie : 1787-1792, Seuil, 1999
- VOVELLE Michel, La Révolution française, Armand Colin, 2015 (3e édition)
- WAHNICH Sophie, La longue patience du peuple. 1792. Naissance de la République, Payot, 2008
- WAHNICH Sophie, La Révolution française : un événement de la raison sensible (1789-1799), Hachette, 2012