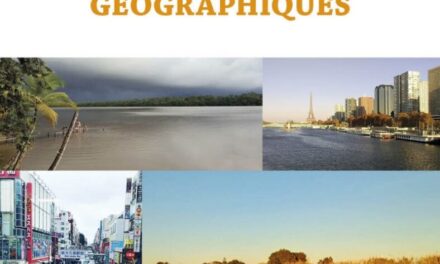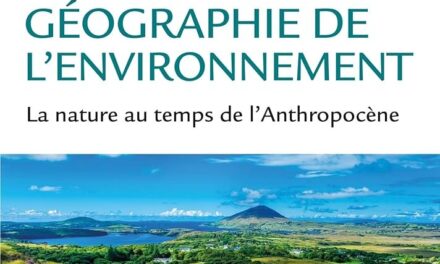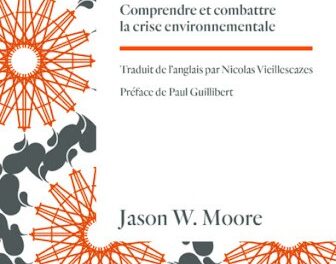Un article collectif récent publié dans la revue les Annales en 2022. L’article insiste sur la paléo-écologie, une forme d’histoire environnementale et une science en devenir, qui se veut nécessairement interdisciplinaire.
Les auteurs sont Adam Izdebski, Kevin Bloomfield, Warren J. Eastwood, Ricardo Fernandes, Dominik Fleitmann, Piotr Guzowski, John Haldon, Francis Ludlow, Jürg Luterbacher, Joseph G. Manning, Alessia Masi, Lee Mordechai, Timothy P. Newfield, Alexander R. Stine, Çetin S¸ enkul et Elena Xoplaki
Traduction d’Antoine Heudre
C’’est en Europe que l’interdisciplinarité est devenue partie intégrante de la recherche en histoire environnementale. Elle forme une alliance polymorphe de chercheurs en sciences naturelles et d’historiens. Ces collaborations reflètent cependant différentes conceptions des relations entre l’être humain et l’environnement : si la plupart d’entre elles dérivent de l’écologie scientifique, d’autres sont issues de la discipline historique, comme le modèle des conséquences climatiques élaboré par Christian Pfister et d’autres historiens du climat – qui s’inspire de l’histoire économique et considère les forces naturelles comme des « influenceurs » externes de l’expérience humaine –, ou le modèle de Richard C. Hoffmann et Verena Winiwarter, qui se concentre davantage sur les boucles de rétroaction entre processus naturels et action humaine.
Les données paléo-environnementales du point de vue de l’historien
Parmi les méthodologies à l’interface entre l’histoire et les sciences naturelles, c’est l’étude des changements climatiques passés qui possède la plus longue tradition de recherche (depuis Emmanuel Le Roy Ladurie, « Histoire et Climat », Annales ESC, 14-1, 1959, p. 3-34).
L’histoire climatique passée a laissé des traces dans les archives humaines et naturelles ; ces dernières peuvent prendre la forme de sédiments lacustres ou marins, de dépôts de tourbe, de spéléothèmes (stalactites ou stalagmites) dans des grottes, d’arbres vivants ou morts, de couches de glace, de courbes dans le bois, de pollens, etc. Ces archives sont susceptibles de fournir un grand nombre de proxies, ou données indirectes, c’est-à-dire d’indicateurs chiffrés, physiques ou chimiques, permettant d’approcher les conditions environnementales passées. C’est ainsi que fonctionnent la dendrochronologie ou la polynologie, dans le cadre de la paléo-écologie ou de la paléo-climatologie.
Nous obtenons ainsi des estimations de la température ou des précipitations pour des périodes spécifiques d’une année donnée. Dans certains cas, les données indirectes permettent de reconstituer à la fois des températures et des précipitations, fournissant dès lors des informations plus générales au sujet des conditions hivernales ou des épisodes de sécheresse. ainsi que sur les conséquences sociales.
Dans la majorité des cas, les chercheurs paléo-environnementaux travaillent sur des carottes de sédiments, soit de longs cylindres de boue extraits de fonds lacustres, de tourbières ou de la glace de l’Antarctique qui favorisent l’accumulation de cette matière couche par couche et, partant, garantissent sa conservation sur de longues périodes. Ces carottes peuvent être analysées à l’aide de diverses méthodes, surtout la géochimie des sédiments, qui permet d’établir des schémas d’érosion locaux et de déterminer les processus physico-biologiques responsables de la production et de l’accumulation des sédiments. Par l’amplitude de leur variation, ces paramètres peuvent témoigner de transformations importantes de l’écosystème local, voire du paysage tout entier, à des moments spécifiques du passé, le plus souvent d’origine anthropique. Ces interventions humaines apparaissent par exemple à l’examen des grains de pollen conservés dans les sédiments et produits par des plantes présentes autour des bassins sédimentaires (nos lieux d’étude) : la palynologie permet ainsi de retracer les modifications des cultures et des systèmes agricoles.
Un certain nombre d’autres techniques permettent d’évaluer l’influence humaine sur les paysages, notamment une série de biomarqueurs – des composés organiques révélant la présence de plantes ou d’animaux dans le passé, comme les betastanols présents dans les excréments des omnivores, en général les porcs ou les humains. Aucun de ces indicateurs, pris isolément, n’autorise une mesure ou une reconstitution directe des activités humaines ou des écosystèmes passés à l’échelle du paysage. Cependant, une fois combinés, ils rendent possibles des approximations fiables que les historiens et les archéologues peuvent utiliser et contextualiser à l’aide de sources écrites ou matérielles.
Un défi épistémologique : relier phénomènes climatiques et indicateurs chiffrés
Les phénomènes liés au climat peuvent être locaux, régionaux, hémisphériques ou mondiaux. Le changement climatique se déroule à des échelles d’une troublante diversité. Les variations affectant l’ensemble d’un hémisphère voire la planète entière sont relativement rares – et souvent associés à des types de forçage spécifiques, comme de fortes éruptions volcaniques tropicales ou le phénomène El Niño. Elles se traduisent ensuite différemment dans les climats régionaux, entraînant par exemple des modifications des schémas pluviométriques saisonniers sur une échelle semi- continentale, en lien avec les fluctuations des moussons ou les températures de sur- face des océans. Enfin, en raison des variations microclimatiques et microrégionales, les mêmes phénomènes climatiques hémisphériques, ou même régionaux, peuvent avoir des effets locaux différenciés, voire opposés, en fonction d’un grand nombre de facteurs, notamment les interactions terre/mer, la nature de la végétation ou la morphologie des sols. Les températures tendent à varier de façon plus homogène à l’échelle de zones plus étendues (souvent continentales ou sous-continentales), tandis que les conditions hydroclimatiques (pluie, neige, humidité du sol, etc.) peuvent osciller de manière significative à des échelles régionales ou locales.
Les études de type enquête : mettre en relation des jeux de données disparates
Les études de type enquête ont été les premiers exemples d’histoire environnementale interdisciplinaire. On peut les décrire comme des tentatives de contextualiser historiquement des données issues des sciences naturelles, lesquelles ont parfois été produites bien antérieurement ou sur une longue période, et souvent indépendamment des questionnements historiques traditionnels.
Voir par exemple Michael McCormick et al, « Climate Change during and after the Roman Empire: Reconstructing the Past from Scientific and Historical Evidence », The Journal of Interdisciplinary History, 43-2, 2012, p. 169-220 ; John Haldon et al., « The Climate and Environment of Byzantine Anatolia: Integrating Science, History and Archaeology », The Journal of Interdisciplinary History, 45-2, 2014, p. 113-161 ; Kristina Sessa, « The New Environmental Fall of Rome: A Methodological Consideration », The Journal of Late Antiquity, 12-1, 2019, p. 211-255.
Misère et richesse de la quantification et de l’inférence statistique
Les Annales irlandaises du Moyen Âge fournissent un exemple de récit fiable des principaux événements historiques du pays, à partir du VIe siècle au XVIIe siècle, sous l’effet des bouleversements liés à la colonisation anglaise. Ces textes recensent 65 « phénomènes de froid » extrême pendant cette période. Les informations fournies peuvent être rapportées à la chronologie des éruptions volcaniques explosives qui ont entraîné d’importantes retombées de sulfate atmosphérique sur la calotte glaciaire du Groenland et peuvent donc être identifiées par des mesures du sulfate dans les carottes de glace extraites de la région. Ce recoupement révèle l’influence majeure de l’activité volcanique explosive sur le climat de la région de l’Atlantique nord-est, à laquelle appartient l’Irlande.
Voir Michael McCormick, Paul E. Dutton et Paul A. Mayewski, « Volcanoes and the Climate Forcing of Carolingian Europe, A. D. 750-950 », Speculum, 82-4, 2007, p. 865-895 ; Christian Pfister et al., « Winter Air Temperature Variations in Western Europe During the Early and High Middle Ages (AD 750-1300) », The Holocene, 8-5, 1998, p. 535-552 ; Francis Ludlow al., « Medieval Irish Chronicles Reveal Persistent Volcanic Forcing of Severe Winter Cold Events, 431-1649 CE », Environmental Research Letters, 8-2, 2013.
Des traces de froid extrême, en décalage avec la relative douceur du climat maritime irlandais, ont été relevées dans les sources écrites et quantifiées par type, fréquence et saisonnalité. Pour établir des correspondances, il a fallu évaluer la précision des chronologies respectivement fournies par les carottes glaciaires et les chroniques des Annales, ainsi que les échelles de temps des processus atmosphériques et climatiques pertinents.
Au terme de l’examen, il apparaît que 37 épisodes de froid (soit 56,3 % des épisodes recensés) se sont produits quelques années seulement après la date d’une éruption, ce qui laisse penser que l’activité volcanique a joué un rôle non négligeable dans le déclenchement de ces épisodes, aux répercussions considérables sur la société irlandaise.
Il en ressort aussi, il est vrai, que le climat irlandais a pu connaître des refroidissements extrêmes sans que l’activité volcanique en ait été la cause. Cependant, lorsqu’elle existe, la corrélation est très forte : la probabilité qu’un tel niveau de cooccurrence soit dû au hasard est quasiment nulle (0,03 %), renforçant les arguments en faveur de la réalité du lien apparent. Par ailleurs, la plupart des épisodes de froid consignés dans les annales l’ont été en hiver, qu’ils aient été associés ou non à des éruptions.
La documentation écrite permet donc de mieux comprendre les répercussions historiques de l’activité volcanique : les archives naturelles (biologiques) comme les cernes des arbres n’offrent que des indications sur le climat du printemps et de l’été (période de croissance active des végétaux). Comme l’ont souligné certains chercheurs, les « archives naturelles » ne doivent pas automatiquement primer sur les archives humaines dans les études sur les interactions entre les hommes et l’environnement : l’exemple irlandais montre combien les deux ensembles doivent être considérés comme complémentaires. Mais l’historien ne doit pas négliger l’étude critique de ces documents et mettre systématiquement en doute leur véracité. Dans l’étude de John Moreland sur les conséquences de l’éruption volcanique de 536 (« AD 536 – Back to Nature? », Acta Archaeologica, 89-1, 2018, p. 91-111), il fallait se demander comment les événements climatiques extrêmes étaient perçus et par les scribes, et par leur lectorat (notamment comme des présages ou des vecteurs d’une punition divine) ; il fallait aussi déterminer si leurs exagérations voire leurs inventions pouvaient s’expliquer par des motifs politiques, rhétoriques ou théoriques.
L’Égypte constitue un excellent laboratoire pour l’étude des relations entre l’homme et l’environnement. En effet, la faible pluviométrie générale qui caractérise la région a induit une forte dépendance au Nil pour l’irrigation et la culture de décrue, rendant la société égyptienne particulièrement vulnérable aux répercussions hydroclimatiques du forçage volcanique. L’injection d’aérosols sulfatés dans la stratosphère à la suite d’éruptions explosives entraîne des déséquilibres énergétiques à court terme affectant le système climatique : en modifiant la réflexion des rayons du Soleil, de tels événements peuvent conduire non seulement à des refroidissements intenses en surface, à l’échelle hémisphérique ou planétaire (c’est ce mécanisme qui est responsable, au moins partiellement, des hivers rigoureux en Irlande), mais aussi à des changements du cycle hydrologique.
Or, la modélisation climatique suggère que les grandes éruptions tropicales tendent à faire baisser les précipitations globales moyennes (principalement du fait d’un refroidissement qui réduit l’évaporation), tandis que les éruptions dans des latitudes plus élevées de l’hémisphère nord peuvent également contribuer à réduire le contraste thermique entre le nord et le sud, contraste qui entraîne la migration vers le nord des vents de la mousson estivale porteurs d’humidité. C’est un facteur clef pour la crue estivale du Nil, alimentée principalement par les pluies de la mousson africaine sur les hauts plateaux éthiopiens. Avant la construction de barrages, au XXe siècle, les pluies de la mousson déclenchaient la crue du Nil à la hauteur d’Assouan, à la frontière sud de l’Égypte, à partir du début du mois de juin. Les niveaux les plus élevés étaient atteints en août et en septembre et la décrue s’amorçait en général à la fin du mois d’octobre, date à laquelle les semis commençaient.
La période ptolémaïque a été un tournant dans l’histoire de l’Égypte. Elle coïncide avec l’émergence de nouveaux cadres politiques et économiques, notamment l’établissement d’une nouvelle capitale à Alexandrie, rapidement devenue l’un des plus grands centres urbains du monde méditerranéen. Le blé à grain nu, relativement vulnérable à la sécheresse, était l’une des principales cultures de l’Égypte à cette époque, adaptée au goût de l’élite grecque et destinée à fournir un marché méditerranéen plus large. De nouvelles institutions fiscales, la diffusion de la monnaie, le développement des banques et le fermage des impôts permirent à l’Égypte d’exercer un contrôle plus serré de sa productivité agricole déjà fameuse, en autorisant l’État à extraire davantage de surplus de son territoire. Des conflits majeurs entre l’Égypte et son principal rival, le royaume séleucide en Asie occidentale, dominèrent les relations interétatiques au cours des IIIe et IIe siècles avant JC. Généralement considérée comme le plus riche et le plus accompli des États hellénistiques successeurs de l’empire d’Alexandre le Grand (et correspondant également à la plus longue dynastie de l’histoire égyptienne), l’Égypte ptolémaïque connut des troubles croissants à la fin du IIIe siècle avant JC : rongée par un désordre social intermittent mais grandissant et soumise à la pression de Rome, alors en pleine expansion, elle devait aussi faire face à l’hostilité persistante de ses rivaux séleucides et à des tensions internes liées, au moins en partie, à la croissance démographique.
Le lien entre l’histoire politique et économique de l’Égypte ptolémaïque et l’activité volcanique explosive a pu être établi grâce, à la fois, à l’intégration de données sur le forçage volcanique fournies par des carottes de glace, à l’utilisation de la modélisation climatique et à des preuves tirées d’inscriptions et de papyrus anciens. Joseph G. Manning et al. (« Volcanic Suppression of Nile Summer Flooding Triggers Revolt and Constrains Interstate Conflict in Ancient Egypt », Nature Communications, 8, 2017) ont commencé par comparer les niveaux de la crue estivale, enregistrés principalement par le célèbre nilomètre de l’île de Roda, près du Caire, avec les dates des éruptions volcaniques explosives, obtenues à partir de l’étude de carottes de glace, entre 622 et 1902. Ils ont ainsi mis en évidence une baisse persistante de la crue estivale après des éruptions tropicales ou extratropicales. Cette corrélation est étayée par les données de sortie des modèles climatiques, qui montrent que les principales éruptions du XXe siècle ont été suivies par un assèchement du bassin-versant du Nil. Afin de confirmer que le même phénomène caractérisait la période ptolémaïque, des indicateurs qualitatifs extraits de papyrus et d’inscriptions ont été utilisés pour établir un classement qualitatif de la crue annuelle sur une échelle ordinale. Il en ressort bien que la qualité de la crue tendait à être plus faible les années où se produisait une éruption. On peut donc faire l’hypothèse d’un lien de causalité plausible entre les éruptions et les événements historiques marquants de l’Égypte ptolémaïque.
Parmi les événements historiques récurrents aptes à la datation, on compte notamment dix révoltes contre les souverains lagides. Or trois d’entre elles ont commencé au cours d’une année durant laquelle une éruption s’est produite et cinq autres dans un délai de deux ans après une année marquée par une éruption. Sur les neuf périodes durant lesquelles le conflit entre l’Égypte ptolémaïque et le royaume séleucide a cessé, trois coïncident avec une année ayant connu une éruption, deux autres se situent dans un délai de deux ans après une éruption et une troisième dans un délai de trois ans.
Ce qui frappe, donc, c’est la coïncidence répétée entre un petit nombre d’événements dont on connaît précisément la date : éruptions volcaniques, révoltes internes et cessation (probablement liée) des campagnes militaires extérieures, tentatives pour réaffirmer ou maintenir l’ordre politique par le biais de décrets sacerdotaux promulgués au nom des souverains ptolémaïques et fréquence accrue des ventes de terres.
Ce test permet aux auteurs de l’étude d’affirmer l’existence d’un lien causal entre les éruptions volcaniques et le déclenchement des révoltes. Ils reconstituent à partir de là une chaîne de conséquences qui pourrait s’énoncer de la sorte : l’activité volcanique a eu une incidence hydroclimatique démontrable sur le Nil ; ces variations de la crue ont influé sur la productivité agricole égyptienne ; la baisse significative des rendements des cultures aurait provoqué des pénuries alimentaires, des hausses de prix, la crainte de famines, des difficultés à s’acquitter des impôts levés par l’État, un abandon des terres et une migration des populations vers les centres urbains pour y trouver de l’aide ; ces bouleversements ont alors pu conduire à des révoltes, en particulier lorsque le contexte général – notamment les tensions ethniques continues entre les Égyptiens natifs et les élites grecques, mais aussi les mobilisations militaires coûteuses – aggravait une situation déjà tendue.
D’autres enchaînements comme les éruptions pourraient, par exemple, avoir déstabilisé la société égyptienne en provoquant un brusque refroidissement, entraînant une diminution des récoltes et une hausse de la mortalité animale. Une autre hypothèse est encore possible : en voilant ou en modifiant le rayonnement solaire, les éruptions auraient conduit à des désordres nourris par des interprétations religieuses locales – la poussière volcanique en suspension pouvant être interprétée comme un signe de la colère divine. Par ailleurs, ces liens de causalité variaient en intensité en fonction des interventions humaines qui tantôt les atténuaient, tantôt les renforçaient. Ainsi, l’aggravation des tensions sociales provoquée par la baisse des rendements agricoles pouvait être limitée par des baisses d’impôts, l’imposition de prix plafonds pour les denrées alimentaires, des interdictions d’exporter, des greniers d’État ou encore par l’importation en urgence de céréales. C’est d’ailleurs pourquoi tous les événements volcaniques survenus durant la période ptolémaïque ne sont pas associés à une révolte : l’Égypte lagide est manifestement parvenue à résister à certains chocs hydroclimatiques causés par les éruptions.
Certaines éruptions se traduisaient seulement par des troubles ponctuels et locaux de la crue du Nil, tandis que d’autres entraînaient des années de sécheresse affectant toute la vallée du fleuve et déclenchaient des famines aiguës. L’ampleur des troubles aurait varié en fonction du dérèglement climatique.
Réinterpréter les sources textuelles à la lumière des données scientifiques
C’est à Cassiodore (v. 485-v. 580) que l’on doit la plus riche description de l’événement 536, « la pire année de l’Histoire », conservée dans ses Variae, qui rassemblent sa correspondance alors qu’il se trouvait au service de la monarchie ostrogoth, à la tête du pays entre 493 et 553. A première vue, les lettres corroborent une interprétation catastrophiste. On y apprend que le Soleil n’a plus sa luminosité habituelle et que les températures ont été fraîches pendant près d’une année. Le cycle des saisons lui-même a été bouleversé : « nous avons eu un hiver sans orages, un printemps sans temps mitigé, un été sans vagues de chaleur », explique l’auteur. Comprenant que les cultures ne pousseront pas dans ces conditions, Cassiodore ordonne l’ouverture de greniers d’État pour écarter le risque d’une famine imminente.