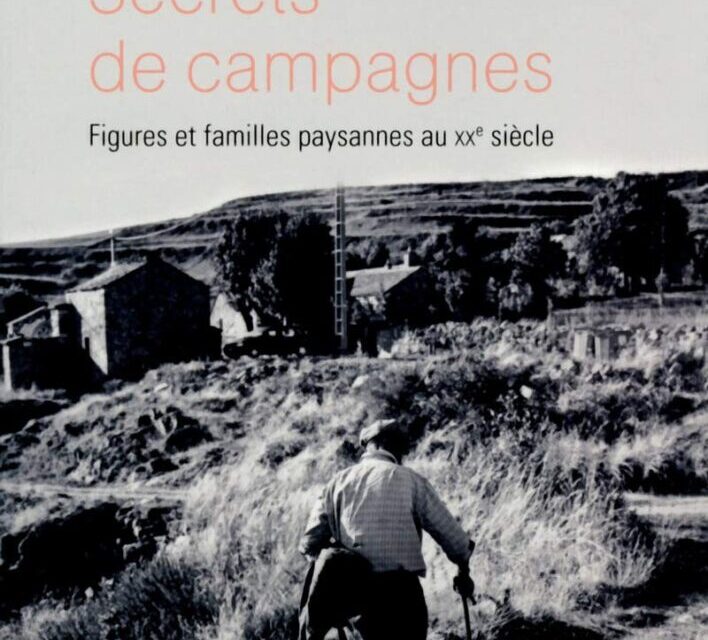Cette fiche porte sur l’ouvrage de Jean-Marc Moriceau qui retrace le parcours de cinq familles paysannes, issues de régions diverses, suivies sur cinq générations : les Virely en Côte d’Or, les Bourrut Lacouture en Charente, les Chartier et les Boucher entre l’Île-de-France et la Normandie et enfin les Malacan dans le Cantal. En s’appuyant à la fois sur des sources écrites et sur des entretiens menés auprès des paysans eux-mêmes (soulignant par là même l’importance de la transmission orale dans les familles paysannes), l’auteur dessine une « histoire intérieure des familles paysannes » (p. 12).
La fiche de lecture peut être accompagnée de L’Histoire des paysans français (Éric Alary, Perrin, 2016) et Nous paysans – une épopée moderne (Édouard Lynch, Agnès Poirier, Flammarion, 2021).
L’auteur structure son questionnement en trois temps. D’abord, il cherche à comprendre pourquoi, avant comme après la mécanisation de l’agriculture, les agriculteurs continuent de travailler si dur alors que la plupart des hommes ont conquis des modes de vie moins contraignants. Cela le conduit à se demander à quelles conditions peut-on rester paysan de part et d’autre d’une révolution agricole qui a bouleversé la donne économique, à partir des années 1950. Enfin, il cherche à mettre en exergue les manières dont ces agriculteurs se sont perpétués en dépit des intenses secousses qui ont frappé le milieu agricole tout au long du XXe siècle. De fait, il cherche à démontrer que le statut d’agriculteur assigne à une place économique dans la société certes, mais renvoie aussi et peut-être surtout à une identité culturelle. En effet, si être agriculteur, des siècles durant, renvoyait à un statut contraint et subi, à la fin du XXe siècle, il relève bien davantage d’un choix. L’auteur n’aspire pas à tirer de ces cinq trajectoires une histoire globale des familles paysannes et des individus qui les composent, conscient des singularités aussi bien géographiques qu’individuelles dont sont empreintes ses sources, mais tente tout de même de mettre en exergue des grands traits de la paysannerie française du XXe siècle.
Chapitre 1
Le premier chapitre est consacré à la famille des Chartier, attachée à la terre depuis sept siècles au moins, à proximité de l’Île-de-France. Jean-Marc Moriceau, tout en racontant ses différentes visites chez les descendants des Chartier (ce qui permet d’illustrer clairement l’enquête de l’historien), érige le tableau d’une famille de grands laboureurs comptant au début du XIXe siècle parmi l’une des plus belles fortunes du pays, ruinée pendant l’entre-deux-guerres, accablée par les dettes. En effet, Fernand Chartier, qui hérite d’une grande ferme en 1912, chute totalement pendant l’entre-deux-guerres, à tel point qu’il termine sa vie comme simple ouvrier agricole. C’est surtout à Pierre Chartier, le fils de Fernand, que s’intéresse Jean-Marc Moriceau. Il retrace dans le détail la manière dont ce dernier a voué sa vie à redevenir cultivateur. Forcé de s’exiler en Beauce pour espérer cultiver une ferme, il s’installe dans une exploitation à Boutervilliers avec l’aide de la famille de sa compagne qu’il épouse quelques mois après leur installation, en 1954. La ferme est en très mauvais état, le propriétaire leur propose un bail de 9 ans pour un fermage annuel de 340 quintaux de blé froment. Dans les faits, le contrat de fermage sera payé par chèque, un arrangement par rapport au contrat signé, que l’auteur décrit comme une « tradition immémoriale du monde rural ». Le propriétaire entend cependant récupérer rapidement la ferme une fois que Pierre et son épouse, Marie-Louise, l’auront remise en état. Ainsi, l’auteur parle d’une « parenthèse » pour désigner la période au cours de laquelle les Chartier cultivent la ferme de Boutervilliers. Les premières récoltes sont difficiles, notamment en raison des conditions climatiques (gel). L’auteur décrit à la fois les conditions de vie difficiles des Chartier (7°C dans la maison en hiver), mais également la diffusion des nouvelles techniques (agricoles ou non) dans le milieu paysan : les Chartier acquièrent un tracteur quelques années après leur installation, et disposent déjà du téléphone à la fin des années 1950. En 1958, Letourneau, un directeur d’usine à Paris, leur propose de mettre en culture ses 150 hectares situés à côté de leur exploitation, en échange de la moitié des bénéfices annuels. Après quelques années, les Chartier ont remis la ferme des Letourneau en état, ce dernier propose d’acheter du matériel avec les bénéfices de la ferme, que les Chartier pourront utiliser. Jean-Marc Moriceau parle d’une Coopérative d’utilisation de matériel agricole (CUMA) avant l’heure. L’achat d’un séchoir par les Letourneau permet aux Chartier de s’essayer à une nouvelle culture, celle du maïs. Après que le contrat de fermage de Boutervilliers ait été renouvelé plusieurs fois, les propriétaires souhaitent reprendre la ferme afin de la confier à un de leurs petits-enfants. Les Chartier doivent de nouveau s’exiler, cette fois pour se rendre en Normandie, où ils achètent une ferme de 82 hectares près de Lisieux en 1969, avec l’aide d’un membre de leur famille qui prête une part de l’argent nécessaire à l’achat. De nouveau propriétaires, comme l’étaient leurs ancêtres, les Chartier achètent un tracteur Renault pour le labour, les semailles et la fenaison, puis un second tracteur McCormick quelques années plus tard. Ils se lancent également dans l’élevage de vache à lait au moyen d’un bail à cheptel, solution qui leur permet d’investir rapidement dans une machine à traire, la première de la région. Sur leurs trois enfants, c’est la cadette, Florence, qui étudie au lycée agricole de Tourville-la-Rivière et qui épouse un fils d’agriculteur de la région en 1981 avant de reprendre la ferme avec ses parents. L’auteur décrit que lors de sa première visite chez les Chartier, en 1988, ces derniers ont agrandi leur exploitation qui couvre désormais 210 hectares et regroupe 130 vaches à lait.
Chapitre 2
Le deuxième chapitre est dédié à la famille des Malacan, plus particulièrement à René et Jeanine Malacan, un couple d’agriculteurs du Cantal (massif du Cézallier), en Auvergne dont les origines agricoles remontent à au moins trois siècles. L’auteur commence par décrire les conditions générales de vie des agriculteurs dans cette région au début du XXe siècle. Ce milieu montagneux aux conditions difficiles implique que la survie des exploitants agricoles passe à la fois par la pluriactivité (par exemple, la femme garde l’exploitation pendant que le mari occupe une activité de maçonnage) et par la migration temporaire (l’exploitation rapportant peu, le mari peut partir l’hiver pour aller travailler dans un autre secteur). Les terres sont largement morcelées. Les familles y sont nombreuses, tous les enfants ne peuvent rester, l’indépendance passe largement par l’itinérance (de la micromobilité dans les villages voisins à la mobilité plus lointaine dans les villes du Massif central). Les enfants, depuis les lois Ferry, doivent descendre à l’école à pied, ce qui peut prendre plusieurs heures pour les exploitations les plus éloignées du bourg. Jeanine ainsi que ses parents illustrent bien ce que décrit Jean-Marc Moriceau : les parents de Jeanine, après leur mariage, passent un long moment à faire des allers-retours entre l’Auvergne et la région parisienne, travaillant dans la ferme de leurs parents l’été, et vendant des toiles sur les brocantes l’hiver près de Paris. C’est en 1949, après le décès d’un de leurs parents qu’ils s’installent dans la ferme d’Aubévio. Dès le début, ils s’adonnent à la polyculture et à l’élevage : culture de grain pour les poules, de paille pour les vaches, de maïs pour les cochons, élevage de chèvres pour le fromage, chasse et pêche pour varier l’alimentation. Jeanine, leur fille cadette, a commencé à travailler très tôt dans la ferme, vers l’âge de 7 ou 8 ans, comme c’était le cas pour beaucoup d’enfants de la région. Elle s’occupait notamment d’amener les vaches pâturer. Jean-Marc Moriceau souligne que les traditions se perpétuaient de siècle en siècle : il fallait rentrer les vaches dans l’étable l’hiver (de décembre à avril) ; les sortir deux fois par jour après l’hiver pour les emmener pâturer dans des champs qui n’étaient pas encore clôturés (et ce jusque dans les années 1970) ; mettre les génisses à l’estive au printemps pour qu’elles s’engraissent tout l’été, sous la surveillance d’un bâtier qui était salarié par le village. L’enneigement dictait ainsi le calendrier agricole, et plus largement la vie des agriculteurs : l’hiver, on passait beaucoup de temps enfermés dans des maisons sombres, on se rassemblait pour les veillées. Jeanine se marie à 16 ans avec René Malacan, en 1963. Au départ, le couple travaille pour les parents de René, comme main d’œuvre gratuite contre le gîte et le couvert, comme cela se faisait encore beaucoup. Il y avait peu de sorties pour le couple : les mobilités étaient très resserrées autour de leur village. C’est en 1967 qu’ils emménagent à Vèze, un bourg, où ils obtiennent le bail d’une petite exploitation ainsi que la cession d’une quinzaine de vaches. La traite est faite à la main. René se loue comme journalier de temps en temps. L’auteur décrit la mécanisation à laquelle s’adonnent les Malacan à la fin des années 1960 : ils font un premier emprunt à un ami du village pour acheter une motofaucheuse ; puis ils empruntent au Crédit agricole pour l’achat de leur premier tracteur en 1968, un Massey Ferguson 35 CV, qui se révèle trop peu puissant pour la conduite périlleuse qu’implique la région montagneuse, ils le changent donc pour un SAME 45 CV. René Malacan augmente la puissance des tracteurs qu’il achète au fil des années. L’arrivée de la télévision dans le foyer en 1975 est également décrite par Jean-Marc Moriceau. Les débuts de la Politique Agricole Commune (PAC) est fructueuse pour la famille qui agrandit la ferme en 1975. Touché par le « poumon du fermier » (maladie liée au foin), la santé de René se détériore rapidement. La ferme de Vèze est cédée à leur fils Patrick qui s’y installe avec sa femme tandis que Jeanine et René se replient dans la maison d’Aubévio à la fin des années 1970. Au cours des années 1980, Patrick et sa femme se lancent dans la spécialisation de vache de race salers, des bêtes de concours. L’auteur décrit qu’en 2014, Patrick et sa femme ont largement développé l’exploitation, puisqu’ils possèdent désormais 180 bêtes.
Chapitre 3
La famille des Virely, implantée en Auxois (Côte d’Or) est l’objet du troisième chapitre. Elle fait figure d’exemple d’une famille de fermier qui exploite les terres d’un grand propriétaire. Le premier Virely à s’implanter en Auxois est François (1855 – 1919). Orphelin à 15 ans, il effectue son service militaire avant d’épouser la fille d’un instituteur-cultivateur avec laquelle il s’installe en tant que cultivateur des 40 hectares de son beau-père, vers 1880. Avec sa femme et leurs quatre enfants, ils se trouvent rapidement à l’étroit dans la maison où vit également son beau-père, il délaisse alors son exploitation pour se faire fermier dans une autre exploitation de 160 hectares. C’est un changement de statut : certes, il passe de propriétaire exploitant à fermier, mais avec un important changement d’échelle. La ferme d’Époissotte dans laquelle s’installent les Virely est une exploitation d’un seul bloc avec une dominance de céréales, appartenant au comte de Guitaut, qui voit dans François un esprit novateur et qui par conséquent se montrera arrangeant avec lui au cours des périodes de mauvaises récoltes. Le sol de cette grande exploitation est argileux, cinq chevaux sont nécessaires pour tirer la charrue. C’est l’assolement triennal qui y est pratiqué. Des vaches y sont également élevées, et les mauvaises terres sont destinées aux moutons. En 1899, François investit dans la première lieuse de l’exploitation, une McCormick importée des États-Unis. Une seconde est achetée l’année suivante. Au fil de la mécanisation, le personnel saisonnier de la ferme disparaît. François Virely, qui continue d’effectuer tous les ans une période militaire à la saison des foins pendant que sa femme tient l’exploitation, démissionne de son poste de capitaine quelques mois avant la déclaration de guerre en 1914. S’il n’est pas mobilisé, ses fils le sont ainsi que d’autres employés de la ferme, alors que François comptait prendre sa retraite en 1917. Son fils, François, qui avait suivi le lycée agricole et qui devait reprendre l’exploitation, meurt au cours de la guerre. C’est donc un autre de ses fils, Jean, qui reprend l’exploitation, alors que son père meurt en 1919. Le traumatisme de la grande guerre perdure dans la mémoire de la famille Virely pendant plusieurs générations. Alors que Jean voulait épouser Marie, une fille de propriétaire exploitant, avant la guerre, les parents de cette dernière refusaient : il n’était pas dans les coutumes des familles propriétaires de marier sa fille à un fermier. La forte mortalité des hommes au cours de la guerre change la donne : Marie et Jean finissent par se marier en 1920. Comme son père, Jean se montre novateur en introduisant des chevaux de trait et des charolais à la ferme d’Époissotte. En effet, la pénurie de main d’œuvre qu’entraîne la guerre prive l’exploitation de charretiers, les terres labourées sont alors transformées en près. Ce passage à l’élevage se révèle largement bénéfique au regard de la chute du blé pendant l’entre-deux-guerres. Jean modernise l’intérieur de la ferme dès 1920, en y faisant arriver l’eau courante et dès 1930 avec l’électricité. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la ferme est occupée par les Allemands. Pierre, le fils de Jean, reprend progressivement la ferme. Il est proche de la Jeunesse Agricole Catholique (JAC) au sein de laquelle s’organise la Résistance dont Pierre fait partie. Pierre reprend définitivement la ferme à la fin de la guerre, alors que Jean veut se consacrer au village d’Époisses, au sein duquel il devient maire dès 1945. Pierre épouse Madeleine Leguy qui a pour dot un tracteur : c’est le premier de la ferme en 1947 : un John Deere qui remplace quelques chevaux de trait. Pierre poursuit la modernisation de la ferme notamment en y installant une douche et un lavabo. En effet, comme ses prédécesseurs, Pierre se montre novateur. En 1956, il devient président du Centre d’études techniques agricoles (CETA) et met en évidence les faibles rendements des prairies par rapport aux céréales. Pierre se tourne alors vers le blé, et vend des chevaux pour investir dans des machines : de nouveaux tracteurs, un épandeur à fumier, … Comme son père, Jean, qui a voulu se consacrer au bien collectif des agriculteurs et plus largement des habitants de la commune, Pierre cultive l’esprit du collectif qui lui vient notamment de ses années à la JAC et crée le Syndicat d’assainissement de la région d’Époisses en 1961 avec lequel il creuse 220 km de fossés pour évacuer les eaux. La même année, il achète une moissonneuse pour toute la commune en créant une Coopérative d’utilisation de matériel agricole (CUMA). Comme son père, il devient maire d’Époisses en 1965, mais il pousse son engagement encore plus loin en devenant vice-président de la Chambre d’agriculture de la région en 1970, puis président de la coopérative de Semur-en-Auxois en 1976. En 1965, c’est Bernard, son fils, qui reprend l’exploitation pour que son père se consacre à ses activités. Les mœurs ont changé et l’épouse de Bernard, Claudine, ne souhaite pas vivre à la ferme avec toute la famille de Bernard, ils s’installent donc dans une autre exploitation où Bernard cultive 80 hectares en plus des 160 de la ferme d’Époissotte. Son frère Gérard s’associe à lui pour gérer l’immense exploitation : en 1972, l’exploitation atteint plus de 300 hectares. Bernard gère les 160 hectares dédiés aux céréales tandis que Gérard s’occupe des 160 dédiés à l’élevage, spécialisé dans les charolaises.
Chapitre 4
C’est aux Bourrut Lacouture qu’est dédié le quatrième chapitre. Cette famille fait figure d’exemple d’une grande lignée d’agriculteurs propriétaires dont la modernisation est retardée par le refus d’un patriarche. Implanté dans le sud-est de la Charente, dans la commune de Gurat, à une vingtaine de kilomètres d’Angoulême, le domaine de Lémerie est aux mains d’une lignée de fermiers-gentilhommes (des notables locaux) depuis le XVIIe siècle. Au cours du XIXe siècle, l’exploitation a souffert du phylloxéra, de la crise viticole et de la chute des prix agricoles. Lorsque Jean Bourrut Lacouture reprend l’exploitation en 1911, il obtient 122 hectares sur les 350 que compte le domaine, partagés avec ses frères et sœurs. Cette dernière est orientée vers la polyculture et l’élevage. Jean donne une orientation laitière à la ferme, faisant passer le cheptel de 10 à 80 bêtes. Il poursuit un système hérité de l’Ancien Régime qui consiste à garder des terres en exploitation directe tandis que le reste est loué à des métayers. Les bâtiments sont bien équipés au début du XXe siècle : le téléphone y est installé avant la Première Guerre mondiale (c’est alors le seul du village), et au cours de l’entre-deux-guerres, le chauffage central est installé dans la ferme ainsi que des sanitaires dans les chambres. En 1939, le fils ainé de Jean, Lémerie, qui termine l’école d’agriculture et est destiné à reprendre la ferme, ainsi que la plupart des domestiques de l’exploitation, sont mobilisés. Jean demande alors à Maurice, son deuxième fils, de gérer l’exploitation. Ce dernier est cependant envoyé au STO en 1943, en Allemagne, service au cours duquel il passe 33 jours dans un Camp de rééducation au travail, expérience traumatisante. Ainsi, Jean se retrouve rapidement seul à Lémerie. Sous l’Occupation, il est nommé membre du comité agricole du canton et doit ainsi appliquer les ordres de Vichy, notamment pour la réquisition du bétail. À la Libération, cela passe pour de la collaboration (notamment du fait des idées très conservatrices de Jean), il est enfermé avec ses enfants pendant deux mois à Périgueux jusqu’à ce qu’ils soient déclarés « non coupables d’indignité nationale »). Au cours de son emprisonnement à Périgueux, Jean rencontre un directeur d’usine cherchant à marier ses deux filles. Lémerie épouse Nicole et Maurice épouse Françoise, une seule noce est organisée, comme cela se faisait beaucoup dans le monde agricole. Ainsi, après la guerre, les quatre fils de Jean et ses trois filles, travaillent à la ferme. Ils occupent des tâches d’employés domestiques sans pour autant recevoir de salaire. Peu à peu, les enfants, ne supportant pas ces conditions, quittent la ferme un à un. Seul Lémerie reste, tentant de mettre au point une deshydrateuse et se désintéressant des travaux agricoles, et Maurice, que son père accepte de faire fermier sur ses terres. Or, Jean refuse la modernisation. L’exploitation va très mal, Maurice ne reçoit pas de paie. Il décide de partir lui aussi, en 1954. Lémerie quitte également la ferme pour l’Espagne où sa deshydrateuse aura du succès. Jean reste seul dans l’exploitation pendant plusieurs années et ne parvient pas à la redresser, il finit donc par reprendre contact avec ses enfants. En 1968, Maurice, après 14 ans loin de l’exploitation (il était devenu agent immobilier) propose de prendre la tête d’un Groupement agricole foncier (GAF) pour que les terres restent indivises. En effet, malgré la mauvaise tenue de l’exploitation, Jean avait racheté progressivement les parts de ses frères et sœurs entre 1912 et 1966, rassemblant les 358 hectares que comptait le domaine, mais au prix de l’absence de modernisation. Mise à part la rénovation des bâtiments pendant l’entre-deux-guerres, la ferme n’a connu aucune évolution. Les bâtiments ne disposent même pas d’eau courante. Le GAF qui réunit l’ensemble des enfants de Jean est donc dirigé par Maurice. Il fait des emprunts, vend certaines des métairies et s’attèle à la modernisation de l’exploitation, dès 1968. Les terres cultivables, qui représentaient 40 hectares de culture et 60 de prairies en 1968, sont progressivement augmentées par le biais de défrichement des landes, bois, talus et grâce à l’achat de matériel. En 1976, 100 hectares sont dédiés à la culture et 30 aux prairies. L’exploitation est progressivement modernisée.
Chapitre 5
Le cinquième et dernier chapitre se consacre à la famille Boucher, implantée initialement en Eure-et-Loir, dans la commune de Marville, aux confins de la Normandie et de l’Île-de-France. C’est un exemple d’une famille de petit paysan qui se heurte au refus de la modernisation. C’est Edmond Boucher, né en 1854, qui acquiert une petite parcelle de 15 hectares que son fils exploite avec sa femme lorsqu’il se retire. Edmond est d’origine modeste, il travaille comme domestique agricole. C’est lorsqu’il épouse Zélaïde, bonne chez le maire du village, Rousseau, que ce dernier installe le jeune couple sur ses 15 hectares de terres. Les Boucher sont de petits exploitants, ils n’emploient pas de domestique, seulement quelques ouvriers agricoles à l’occasion des grands travaux. Ils travaillent à la main, vendent leurs produits sur les marchés : pommes de terre, œufs, beaucoup de légumes et du fromage. Le maire, Rousseau, n’a pas de descendant. Il fait des Boucher ses héritiers. Après les droits de succession payés, il reste aux Boucher une maison et 26 hectares. L’exploitation, lorsque Edmond et Zélaïde se retirent, est divisée entre leurs deux fils. Armand Boucher et sa femme Georgette reçoivent 15 hectares en 1920. Armand et Georgette n’ont qu’un seul fils, Marcel, qu’ils cherchent absolument à décourager de devenir cultivateur : ils dépeignent le métier comme trop harassant, et certaines années sont très difficiles financièrement. Or, Edmond tombe malade dans les années 1930, ce qui l’oblige à accepter que Marcel gère l’exploitation le temps qu’il se remette. En 1943, Marcel est appelé au STO, les conditions y sont très difficiles. Il s’évade avec un camarade et doit fuir les Allemands qui menacent de le condamner à la peine de mort pour désertion. Il trouve refuge chez un cousin agriculteur qui l’emploie comme domestique. À son retour à Marville en 1945, il souhaite moderniser la ferme de ses parents : des chevaux ont été réquisitionnés pendant la guerre et Marcel a vu pour la première fois des tracteurs chez son cousin. Mais sa mère refuse absolument toute modernisation. Entre 1944 et 1950, Marcel effectue plusieurs stages et occupe des postes de salarié agricole dans 5 fermes différentes, à chaque fois un peu plus moderne : la première est une exploitation de 120 hectares avec deux tracteurs, la dernière comprend 450 hectares et quatre tracteurs. Marcel est plongé dans la modernité. Or, entre temps, ses parents ont loué leurs terres, et il est impossible pour lui de reprendre l’exploitation, ses parents refusant toujours qu’il devienne à son tour cultivateur. Au cours de son dernier poste, Marcel a rencontré sa future épouse, Lucienne, qui elle aussi aspire à avoir sa propre exploitation. Le couple se marie en 1951. Marcel a plusieurs propositions pour devenir salarié agricole dans de grandes exploitations, mais il refuse et s’installe en Normandie, dans le pays d’Auge, sur une parcelle de 15 hectares cédée par ses beaux-parents. Pour Marcel qui aspirait à revenir à Marville, l’implantation en Normandie est vécue comme une forme d’exil. Jean-Marc Moriceau décrit longuement la ferme dans laquelle les Boucher s’installent : l’adaptation est d’autant plus compliquée que la ferme n’est absolument pas modernisée, il n’y a pas de tracteur, pas d’eau courante, pas d’électricité. L’eau courante arrive en 1953, l’électricité en 1954, le téléphone, seulement en 1976. Ce sont les Boucher qui effectuent la toute première insémination artificielle dans la région : les méthodes du pays d’Auge sont très traditionnelles, les agriculteurs amènent les vaches à la saillie chez un voisin qui possède un taureau. Pendant plusieurs dizaines d’années, bien que les Boucher modernisent leur ferme, l’acquisition de nouvelles terres est compliquée, d’autant qu’ils ne sont pas originaires du pays, et que leurs nouvelles méthodes, notamment les engrais, sont mal vues par les autres cultivateurs. C’est seulement en 1970 que Marcel parvient à agrandir ses terres. En 1975, l’exploitation couvre 38 hectares, possède trois tracteurs, 34 vaches, 36 génisses, 4 bœufs et un taureau. Malgré l’obstination de Marcel pour se faire cultivateur et son attachement à la terre, il ne parvient pas à retourner sur ses terres de Marville. Moriceau le décrit avec les mots suivants : « Promoteur inlassable du modernisme et fervent adepte de la liberté d’entreprendre, il a su prouver, au-delà des conditions sociales, que le changement agricole n’est pas réservé aux élites de la terre. »
Ainsi, au travers de ces cinq parcours, Jean-Marc Moriceau illustre la culture paysanne ancrée dans les familles. Plusieurs des protagonistes qu’il étudie ont fait le choix et se sont même battus pour perpétuer le métier de leurs ascendants, et ce malgré de grandes difficultés, jusqu’à payer le prix de l’exil pour plusieurs d’entre eux. Marcel Boucher résume bien cette culture paysanne, celle de l’attachement à la terre, lorsqu’il dit « Moi je voulais être cultivateur. La terre, je la sentais ». L’auteur dresse des thèmes communs aux familles paysannes. D’abord, celui de la mémoire familiale paysanne, qui se transmet oralement mais qui est aussi appuyée par des archives plus ou moins riches selon les familles. Celui de l’entre-aide également, dans les familles agricoles, entre les différentes générations, mais aussi entre les frères et sœurs, à l’image du GAF mis en place par Maurice chez les Bourrut Lacouture. L’auteur pointe l’importance de la formation (beaucoup des enfants d’agriculteurs, au XXe siècle, sont inscrits dans des lycées agricoles) et des réseaux : la Jeunesse Agricole Chrétienne semble jouer un rôle important, notamment pendant l’entre-deux-guerres. Le thème de la modernisation et de la mécanisation occupe une place importante dans l’ouvrage, les familles s’y adonnent à des rythmes différents, avec plus ou moins de résistance selon les contextes et les régions. C’est tout aussi bien la modernisation agricole qui est racontée que la modernisation des modes de vie plus largement, puisque l’auteur décrit l’arrivée de l’eau courante, de l’électricité, du téléphone, et même de la télévision. Jean-Marc Moriceau parle d’un changement « de civilisation ». Dans ce récit intime, la « Grande histoire » se mêle à la micro-histoire : l’impact des deux guerres mondiales est largement décrit. L’auteur laisse entendre qu’être paysan sous l’Occupation est une activité compromettante : Jean Bourrut Lacouture est rapidement taxé de collaborateur à la Libération. Cette dernière « n’offre pas des lendemains qui chantent » pour les paysans. Enfin, si l’auteur parle à plusieurs reprises des femmes dans l’ouvrage et de la place qu’elles occupent dans les exploitations, c’est surtout sur les chefs d’exploitation que se concentre Jean-Marc Moriceau, reproduisant quelque peu l’invisibilisation du travail agricole féminin. Si l’auteur soutient que les épouses jouent de plus en plus un rôle de partenaire associé à l’orientation de l’exploitation, il ne donne aucune indication qui prouverait que ça n’était pas le cas avant le XXe siècle, et n’étaye cette idée que par quelques exemples peu développés.