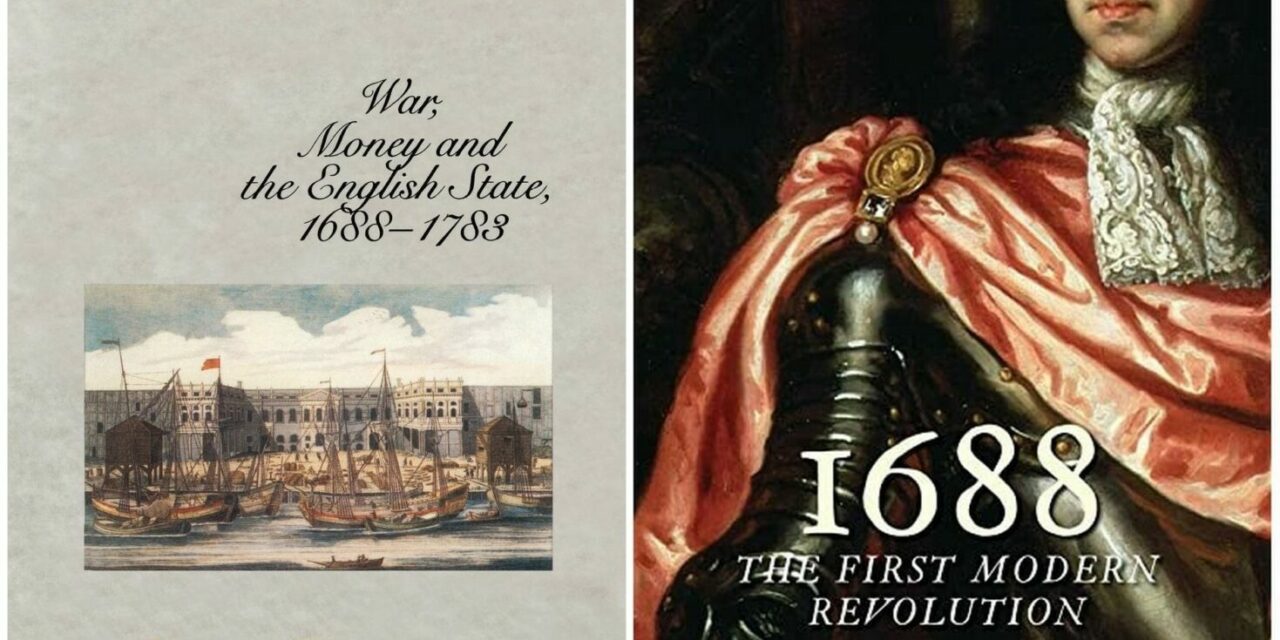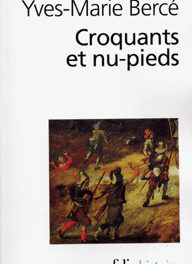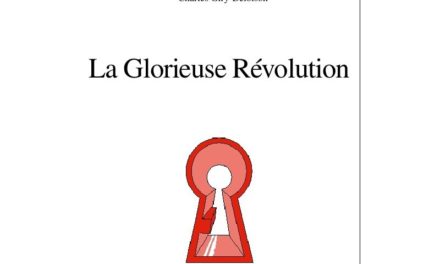La question de la transformation de l’Etat de justice en un Etat militaro-fiscal est au cœur de la question d’histoire moderne au concours de l’agrégation, en particulier au moment de la Glorieuse Révolution d’Angleterre en 1688, de l’arrivée des Hanovre au pouvoir (1689) et des rivalités franco-anglaises au cours du XVIIIe siècle. Elle relève d’une historiographie très riche visant à créer une « new fiscal history ». Elle est organisée autour des travaux fondateurs de John Brewer (The Sinews of Power: War, Money and the English State (1688-1783), 1989), puis ceux de Lawrence Stone (colloque An Imperial State at War, 1993), Michael Braddick (The Nerves of State: Taxation and the Financing of the English State (1588-1714), 1996), Richard Bonney (The Rise of the Fiscal State in Europe (1200-1815), 1999), Christopher Storrs (The Fiscal Military State in the Long Eighteenth Century Europe, 2009), Steven Pincus (1688: the First Modern Revolution, 2009), Patrick O’Brien (The Rise of Fiscal States, 2012), Aaron Graham et Patrick Walsh (The British Fiscal-Military State, 2016) sur la question de l’Etat. Ces travaux ont en commun de remettre en question une historiographie whig classique depuis le XVIIIe siècle. Cette fiche propose une synthèse des réflexions qui pourront être à la fois utiles et nécessaires aux candidats. Elle se termine par un exemple personnel de rédaction d’une sous-partie de dissertation à ce sujet, réalisé quand je préparais moi-même l’agrégation.
I. John Brewer, The Sinews of Power et le concept d’Etat militaro-fiscal en Angleterre
L’ouvrage, paru en 1989, est passé inaperçu en France lors de sa publication. John Brewer invente pourtant un concept central aujourd’hui: celui d’« Etat militaro-fiscal ».
Comme l’écrit Philippe Minard, « il s’agit au départ de comprendre comment l’Angleterre (ou, plus largement, la Grande-Bretagne après 1707) est devenue, en deux ou trois générations, au tournant des XVIIe et XVIIIe siècles, l’une des plus grandes puissances européennes, sur les plans militaire (et singulièrement naval), impérial et commercial. Ou encore, comment un État longtemps périphérique s’est transformé en l’un des poids lourds de l’équilibre européen et de l’ordre géopolitique mondial, connaissant un apogée éclatant en 1763, quand le traité de Paris consacre ses victoires militaires et diplomatiques. L’objet du livre est précisément d’analyser les ressorts cachés, les nerfs (sinews) de la puissance anglaise. Alors qu’une longue tradition historique avait mis en avant l’image d’un État « faible », léger, discret, ayant su éviter les boursouflures d’un Léviathan administratif, on découvre un appareil fiscal et militaire sans égal dans l’Europe du XVIIIe siècle. De fait, la guerre sans merci pour l’hégémonie européenne et mondiale qui oppose l’Angleterre et la France a entraîné un formidable développement de l’appareil militaire, mais aussi administratif : la relation causale est manifeste entre guerre, finance et bureaucratie. Selon J. Brewer, c’est « l’habileté des administrateurs gouvernementaux à établir une routine dans la collecte de l’impôt, la mobilisation de l’argent et l’approvisionnement des troupes qui fait la différence entre la victoire et l’humiliation ».
Le concept permet de comprendre comment l’Etat anglais s’est transformé pour se rendre capable de soutenir un effort de guerre de plus en plus coûteux, grâce à une augmentation de la fiscalité et de la dette publique, tout en développant une administration civile inédite vouée à gérer cet effort fiscal et militaire.
Pour des informations complémentaires, voir la fiche de lecture sur l’article de Philippe Minard, L’Etat militaro-fiscal anglais au XVIIIe siècle sur Clio-prépas. L’original est disponible sur CAIRN.
La Glorieuse Révolution de 1688-1689 marque un tournant fondamental, ouvrant une longue séquence d’affrontements militaires, à la fois terrestres et maritimes, de plus en plus coûteux contre la France.
Pour affronter des problèmes logistiques d’une ampleur inédite, l’État devient le plus grand dépensier du pays, le plus gros emprunteur et le plus grand employeur.
Les effectifs militaires alloués par le Parlement explosent en temps de guerre, entre 63 000 (guerre de succession d’Autriche) et 108 000 (guerre d’indépendance américaine). La milice, vouée au maintien de l’ordre intérieur et à la défense du territoire, est réorganisée après la rébellion jacobite de 1745-1746 et les craintes d’une invasion française pendant la guerre de Sept Ans (Militia Act de 1757).
Priorité est donnée à l’effort naval. Le pays se singularise par une « politique de la mer » (« Blue-Water Policy ») qui repose sur la complémentarité et un soutien réciproque entre puissance navale et puissance commerciale : la Roayl Navy protège les routes et têtes de pont commerciales, elle soutient l’essor du négoce colonial, tandis que les profits commerciaux contribuent au financement d’une marine de guerre toujours plus puissante. Ainsi, les vaisseaux de la Navy protègent la Grande-Bretagne de toute invasion, tandis que sa puissance maritime lui assure une hégémonie mondiale, de nature plus commerciale et géopolitique que proprement coloniale : grâce à ses bateaux, « Britannia rules the waves ».
Ayant rompu avec l’isolationnisme des deux siècles précédents, le pays assume le prix à payer pour cet effort de guerre d’une ampleur absolument inédite. L’expansion coloniale en Amérique et les nécessités d’empêcher la France de Louis XIV de devenir trop puissante ont accéléré cette transformation. Lors du Traité d’Utrecht de 1713, la Grande-Bretagne est consacrée comme la nouvelle grande puissance européenne et atlantique. Mais les dépenses sont colossales, et en augmentation exponentielle. Il faut des hommes et de l’argent, en quantités énormes. Les chiffres que rassemble John Brewer sont édifiants. Entre les années 1670-1680 et les années 1780, les dépenses militaires annuelles sont quasiment multipliées par 15 (passant de 2 millions de livres sterling à presque 30 au plus fort du conflit américain). Au cours du XVIIIe siècle, les dépenses de guerre représentent entre 61 et 75 % des dépenses de l’État (par comparaison, en France, vers 1780, on est à 25 %). Vers 1750, la simple maintenance de la flotte engloutit plus d’un demi-million de livres par an. Encore faut-il avoir construit ces bâtiments : au cours du siècle, les coûts unitaires de la construction navale ont doublé.
Cette politisation de la question militaire pose question, dans une société civile hostile à toute militarisation intérieure et vigilante face au renforcement de la puissance de l’Etat. Tout d’abord, en temps de paix, l’armée est utilisée à des tâches de police intérieure. Le long des côtes, où la fraude est la plus active, et sur les frontières écossaises, on l’utilise pour traquer les contrebandiers. Elle est aussi mobilisée pour maintenir l’ordre en cas de fortes tensions sur les prix des grains ou d’agitation ouvrière. Enfin, dans les Lowlands écossaises, elle est employée à réprimer les rébellions jacobites. Autant de tâches de police qui contribuent à faire voir dans l’armée une force bien plus oppressive que la marine. En deuxième lieu, pendant la première moitié du XVIIIe siècle, les purges contre les officiers jacobites et les plaidoyers du Premier ministre Walpole en faveur d’une armée régulière forte pour soutenir la dynastie des Hanovre accentuent l’image négative de l’armée et les craintes d’une instrumentalisation politique au service du « despotisme » : l’armée de métier est alors vue comme le symbole de l’illégitimité de l’oligarchie whig. Enfin, les modalités de recrutement des forces militaires demeurent impopulaires. Quand l’appel au volontariat ne suffit pas à répondre aux besoins, le recours à la « presse » et aux enrôlements forcés suscite des réticences voire des manifestations d’opposition. Mais sous ce dernier angle, la Navy n’a rien à envier à l’armée, car lorsqu’il s’agit de recruter des fantassins, les autorités civiles sont consultées et peuvent prononcer des exemptions, mais il n’en est rien pour les marins : la « presse » paraît alors totalement arbitraire. Il reste que, dans l’ensemble, si l’on excepte ces méthodes brutales de recrutement forcé, la marine, contrairement à l’armée permanente, n’est pas perçue comme une menace pour les « libertés anglaises ». Il est vrai qu’avec l’avènement de George III en 1760, l’hypothèque de l’attachement au Hanovre continental étant levée, et les victoires de la guerre de Sept Ans manifestant tous les bénéfices d’une bonne coordination entre armée et marine, la poussée de nationalisme chauvin qui anime l’opinion fait voir l’armée comme tout aussi « britannique » que la Navy, et réduit les méfiances politiques à son égard.
Une question importante est posée par J. Brewer : depuis la Révolte des Barons de 1215 et avant l’arrivée de Guillaume d’Orange en 1688, les différents gouvernements avaient rarement réussi à surmonter les restrictions fiscales imposées par le Parlement qui ne voulait pas leur accorder les moyens d’une politique de puissance qui pouvait servir à briser les libertés anglaises. Les députés anglais ont toujours craint la tyrannie. C’est ce sentiment qui semble changer après 1688. La Couronne parvient, avec l’appui de Westminster, à financer ses interventions militaires. Pourquoi les Communes ont-elles consenti un tel effort?
Avec la guerre de Neuf Ans (1689-1697), c’est bien l’appareil fisco-militaire étatique qui s’est trouvé renforcé. Pour Guillaume, il importe de faire barrage aux ambitions françaises, tandis que la majorité des Anglais se soucient avant tout de préserver les acquis de 1688 et d’éviter le retour de Jacques II, avec le catholicisme et les dérives absolutistes. S’ils consentent à la guerre, c’est dans les limites de la « Blue Water Policy » : ils se soucient plus de préserver les acquis commerciaux et coloniaux que l’équilibre des pouvoirs en Europe, et préfèrent la Navy à l’armée. Depuis la guerre civile, les marins sur les navires ont toujours été considérés comme moins dangereux que les fantassins positionnés sur le sol anglais. Aussi les Communes, en 1697-1701, ont-elles voté des lois visant à limiter les effets politiques intérieurs de l’engagement militaire extérieur. Puis, les provocations de Louis XIV, sa reconnaissance du Prétendant Stuart et ses attaques contre le commerce anglais ont conduit même les plus fervents partisans de l’isolationnisme à comprendre que la guerre était imminente.
Le paradoxe s’explique ainsi : la Glorieuse Révolution n’a pas été seulement une révolution protestante, mais aussi un acte patriotique de défense du pays soucieux de préserver la foi anglicane comme religion officielle et de réduire les pouvoirs du gouvernement central. Mais pour défendre le pays et les libertés acquises contre ses ennemis, il a fallu augmenter les pouvoirs de l’Etat. Cette contradiction est au coeur de la réflexion sur l’Etat militaro-fiscal. Les opposants parlementaires ont bien dû reconnaître que l’Etat pouvait protéger les libertés anglaises, à condition de lui garantir les moyens de le faire. Ainsi, en encadrant l’essor de l’Etat militaire, le Parlement a rendu politiquement possible et supportable le renforcement de l’Etat fiscal nécessaire à la protection des intérêts et des libertés de la nation, au sens de 1688.
Les travaux de Peter G. M. Dickson (, 1967) avaient déjà insisté sur la « révolution financière » anglaise de la fin du XVIIe siècle, dans le sillage de la création de la Banque d’Angleterre en 1694. Brewer, lui, ne délaisse pas le crédit ; mais il démontre que le levier de la fiscalité devient tout aussi important.
Depuis la Restauration, d’importantes transformations du système d’imposition avaient été mises en place. Charles II et son successeur Jacques II avaient mis fin à l’affermage des impôts et amélioré la collecte sur le terrain. L’administration de l’Echiquier a établi de nouvelles procédures comptables plus fiables, posant les bases d’un véritable budget de l’Etat. Après la Glorieuse Révolution, la Hearth Tax (taxe sur les feux) disparaît au profit de la seule Land Tax (taxe foncière).
Une autre source de rentrée fiscale est donnée par les douanes. Celles-ci représentent entre 20 et 25% des recettes. Mais leur augmentation est rendue difficile car elle risque à la fois de gêner le commerce en taxant les exportations, et de pousser au développement d’une contrebande active qu’il serait difficile d’empêcher.
Restent alors, depuis 1643, les droits d’excise sur les produits de consommation (d’abord les alcools, puis sel, savon, charbon, cuir, bougie, papier fin, argenterie, et même carrosses) : ces taxes sont indolores ou presque, puisque producteurs et distributeurs les répercutent de façon peu visible sur leurs prix de vente. L’excise constitue autour de 30 % des recettes fiscales dans les années 1710, et autour de 50 % dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. The Sinews of Power a mis en évidence l’importance de cet impôt.
La collecte de l’excise est assurée par un corps d’agents compétents, dont on veille à empêcher une trop longue implantation locale par une rotation périodique. Cette administration, jusqu’alors peu étudiée, est décrite par J. Brewer comme une véritable bureaucratie hiérarchisée, professionnalisée, relativement qualifiée et bien payée. Les agents des Bureaux de l’Excise sont présents sur l’ensemble du territoire britannique. Il apparaissent comme l’incarnation d’une forme moderne d’administration, rigoureuse, active et déterminée.
Après 1688, les besoins de la guerre contre la France ont entraîné le développement rapide de ces bureaux. Entre 1690 et 1782, le nombre d’employés permanents du Navy Board, du Board of Trade et du Secretary of State’s Office ont été multipliés par 4! Les effectifs de l’administration de l’Echiquier ont été multipliés par 3 dans la même période!
J. Brewer parle de véritables véritables « fonctionnaires » : emplois à plein temps, salaires (et non pas gages), grille d’avancement et carrière, retraites, gratifications, éthique de service du public et de la probité, tout est posé. Autrement dit, un compromis s’est dessiné entre clientélisme et fidélités politiques d’une part, et efficacité administrative de l’autre. Il faut certes des soutiens pour accéder aux postes élevés, mais c’est impossible sans compétences avérées.
L’essentiel de l’effort fiscal repose donc sur les impôts indirects, administrés directement par les agents du gouvernement central, dès lors qu’il a fallu augmenter les recettes fiscales de manière à la fois efficace et moins ostensible. Patrick O’Brien a montré que l’augmentation des rentrées fiscales ne peut s’expliquer par la seule croissance économique : c’est la création de nouveaux impôts, et la hausse des taux de ceux qui existent déjà, qui expliquent la hausse des recettes. En l’occurrence, l’essentiel provient de l’augmentation du nombre de produits soumis à l’excise.
L’efficacité de son système fiscal assure à l’État britannique un revenu régulier et garanti qui rend les emprunts à la fois peu coûteux et relativement faciles, d’où la hausse exponentielle de l’endettement public. Après 1707, le service de la dette n’a jamais représenté moins de 30 % des recettes de l’État, et à la fin du XVIIIe siècle, il est patent que le financement de la guerre dépend de plus en plus des emprunts.
A l’issue de chaque conflit international, l’État consolide les dettes qu’il vient de contracter en transformant la dette flottante à court terme en dette à long terme, et même, à partir de 1713, en rentes perpétuelles dont les intérêts sont assis par le Parlement sur des recettes fiscales dédiées. Autrement dit, l’histoire du crédit public au XVIIIe est celle de la conversion de dettes à court terme en emprunts à long terme, et de l’augmentation de la fiscalité indirecte pour assurer le service de la dette.
Pour Philippe Minard, « J. Brewer nous offre une synthèse inédite et de précieux outils d’interprétation pour mieux comprendre la transformation radicale de l’État britannique, qui acquiert au tournant des XVIIe et XVIIIe siècles toutes les caractéristiques d’un puissant État militaro-fiscal : des impôts élevés, une administration civile de plus en plus nombreuse et bien organisée, une armée de métier, et la volonté de la Grande-Bretagne de jouer un rôle de grande puissance mondiale ».
II. Une historiographie traditionnelle battue en brèche
En 2009, Steven Pincus publie 1688: the First Modern Revolution, puis « La Révolution anglaise de 1688 : économie politique et transformation radicale » (Revue d’histoire moderne et contemporaine, 2011, p. 7-52) Il dénonce particulièrement l’historiographie traditionnelle libérale de la Glorieuse Révolution depuis le XIXe siècle. Il rompt également avec les historiographies marxistes plus modernes qui interprétaient l’évènement comme une véritable révolution libératrice contre la tyrannie des Stuarts. Le récit canonique ayant conduit à la chute de la dynastie Stuart est résumée de manière très accessible par Karim Ghorbal, « Repenser la Glorieuse Révolution de 1688 : à propos de Steven Pincus, 1688, the first modern revolution » (Revue d’histoire moderne et contemporaine, 2018, p. 144-161). Pincus rejette une « interprétation whig de l’histoire ». Ce concept, créé par Herbert Butterfield en 1931, visait au départ la tendance des historiens britanniques à assumer le rôle de « redresseurs de torts », prenant position contre « l’oppresseur » et soutenant la cause de « l’innocent ». La croyance en une destinée particulière de l’Angleterre, dont la mission aurait été d’instituer la liberté et la tolérance religieuse sur son sol, puis de répandre ses valeurs et sa culture à travers le monde, a constitué le fondement idéologique de cette tendance théorique. Autrement dit, la Whig History se caractérise par une vision téléologique de l’histoire, où la position occupée par la Grande-Bretagne au XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle représente le point d’aboutissement de la marche du monde ; elle est profondément exceptionnaliste, puisque la Grande-Bretagne se trouve être la seule capable d’engendrer et d’accompagner une telle ambition ; et en définitive, elle se révèle très nationaliste car, à de rares exceptions près, la Grande-Bretagne aurait toujours fait les bons choix.
Cette tendance historiographique a dominé l’écriture de l’histoire britannique depuis Thomas Macaulay (History of England, 1848), Leslie Stephen, William Edward Hartpole Lecky, George Trevelyan. Elle oppose le camp de la Tradition à celui du Progrès, et affirme la puissance de la volonté de liberté du peuple anglais, par son refus de la tyrannie et son désir de tolérance. Pour eux, la Révolution avait été pacifique, consensuelle, aristocratique et surtout raisonnable. Elle était aussi protestante et aurait confirmé la nature fondamentalement exceptionnelle du caractère national anglais. Enfin, l’économie anglaise n’aurait commencé à croître et à prospérer qu’à partir du moment où le droit à la propriété fut garanti par la Révolution, et l’absolutisme rendu impossible en Angleterre.
Timothy Harris, lui, se refuse à voir dans la Glorieuse Révolution un coup d’Etat organisé par une poignée de parlementaires ralliés autour de la défense des libertés anglicanes. C’est une interprétation classique, qui s’inspire de Mark Goldie : une « révolution anglicane » visant à tuer dans l’œuf la politique d’ouverture religieuse et politique menée par Jacques II en direction des catholiques et des dissidents religieux ; une révolution conservatrice face à un roi qui caressait l’espoir d’une conversion progressive de ses royaumes au catholicisme et à l’absolutisme de droit divin.
Dans les années 1970, une autre historiographie dite « révisionniste », a véhiculé un contre-mythe conservateur. Selon Jonathan Clark et John Morrill par exemple, si la Glorieuse Révolution fut bien pacifique et conservatrice, c’est parce qu’il ne s’est pas passé quelque chose d’extraordinaire en 1688 et 1689, et sûrement pas la victoire d’un peuple anglais épris de liberté en lutte contre la tyrannie. Selon eux, Guillaume III n’a pas libéré l’Angleterre d’un despote : il l’a envahie et, à la suite d’un coup d’État, en a pris la tête ; la Déclaration des Droits de 1689 n’a que peu affaibli la monarchie anglaise, toujours capable de décider souverainement de l’entrée en guerre du royaume ou de sa politique étrangère ; l’Église anglicane est sortie plus forte que jamais de cette « révolution » : en définitive, les évènements strictement politiques des années 1688 et 1689 ne furent que les conséquences d’une lutte acharnée pour le pouvoir au sein de l’oligarchie anglicane et aristocratique, que le peuple anglais observait de manière plus ou moins passive. Après l’arrivée de Guillaume d’Orange sur le trône, l’Angleterre est demeurée la société d’Ancien Régime qu’elle était avant cette date, fondée sur une alliance solide entre le roi et l’Église, comme dans la plupart des autres États européens. La Glorieuse Révolution n’aurait donc pas été glorieuse car elle n’était tout simplement pas une révolution.
III. Steven Pincus réinterprète la Glorieuse Révolution en Angleterre
La thèse de Pincus est différente : la Glorieuse Révolution est le résultat d’une lutte entre deux camps rivaux – d’un côté, Jacques II et ses partisans tories, et de l’autre, leurs rivaux whigs –, chacun proposant une vision différente de la manière dont la Grande-Bretagne doit moderniser l’État, l’économie et l’Église. Bien que ces visions concurrentes soient profondément enracinées et incompatibles, elles ne conduisent à la révolution que lorsque Jacques II met en œuvre certains éléments-clés de sa politique. Un malaise considérable s’ensuit, les whigs et leurs partisans adoptant une position inflexible, ce qui donne l’opportunité aux Hollandais, sur ordre du Stathouder, de risquer l’envoi d’une large flotte et d’hommes vers l’Angleterre.
Selon l’auteur, Jacques II n’était pas un roi bigot, maladroit, stupide ; la Glorieuse Révolution ne fut ni courte, ni pacifique, ni aristocratique, ni anglicane, ni raisonnable, ni conservatrice, ni consensuelle ; en revanche, elle est la « première révolution moderne ». Elle est similaire à bien des égards aux révolutions françaises, russes, chinoises ou iraniennes qui la suivront ensuite, car elle est le résultat de l’affrontement de deux visions et de deux volontés modernisatrices opposées. En effet, les Révolutions naissent la plupart du temps lorsque les autorités politiques en place admettent le besoin de se moderniser. Elles créent nécessairement du ressentiment. D’autre part, en légitimant le processus de modernisation par la nécessité de rompre avec le passé, les autorités ouvrent la voie aux mouvements d’opposition, qui n’ont plus besoin de justifier leur refus du mode de vie traditionnel. Il ne s’agit pour eux que de convaincre de la supériorité de leur modèle. A la fin, c’est la vision modernisatrice de Jacques II qui s’incline face à celle de Guillaume d’Orange.
Le point important de sa thèse est celle des volontés modernisatrices dans chaque camp, et en particulier dans le camp des Stuarts. Jacques II faisait peur aux députés de Westminster non parce qu’il était stupide, mais parce qu’il était efficace. Le roi idéalisait sans doute le modèle absolutiste louis-quatorzien et souhaitait que son propre royaume s’oriente dans cette direction: non pour prendre les décisions seul (c’est-à-dire sans tenir compte des cours intermédiaires), mais pour y développer une bureaucratie centralisée, une armée professionnelle permanente, une marine efficace, qui ferait de l’Angleterre une grande puissance européenne.
Deux modèles de puissance étaient alors possibles : soit chercher à créer un empire continental, soit développer un empire maritime (fondé sur la production manufacturière, le commerce extérieur, la maîtrise des routes d’échanges et le contrôle des océans). Comme, à la fin du XVIIe siècle, les Provinces-Unies étaient le seul pays capable de concurrencer économiquement l’Angleterre et d’établir une domination maritime qui aurait risqué de couper la métropole anglaise de ses possessions impériales, Jacques II choisir d’imiter le modèle maritime hollandais afin de l’affaiblir durablement (et de se protéger par la même occasion) plutôt que le modèle continental français.
Le problème de Jacques II est alors que ses volontés réformatrices ont favorisé la croissance d’un contre-modèle de développement au sein de l’opinion publique anglaise, rigoureusement antagoniste au sien. Ce sont en effet deux conceptions du monde et de la richesse qui s’opposent. Les Tories considèrent que toute richesse provient de la terre : elle est par conséquent limitée mais peut être étendue par la conquête (coloniale). Les Whigs considèrent qu’elle provient du travail, qu’elle est donc potentiellement infinie et doit être encouragée par l’intervention de l’Etat. Le conflit s’est ouvert au début du règne de Charles II, au moment des réflexions autour de la création d’une Banque nationale. Pour les Whigs, la création de la Banque d’Angleterre permettrait d’encourager l’activité manufacturière et commerciale, par le biais du développement du crédit. Pour les Tories, il faut mieux conforter les monopoles des grandes compagnies qui existent déjà : l’East India Company (fondée en 1600) et la Royal African Company (fondée par Jacques II en 1672).
C’est de la confrontation entre ces deux projets de confrontation, l’un porté par le roi et le pouvoir exécutif, l’autre par la partie whig du Parlement, qui provoque la Glorieuse Révolution. Ce conflit n’oppose donc pas le conservatisme au libéralisme, ni le fanatisme catholique du roi Stuart à la modération protestante du peuple anglais. Selon Pincus, le fondement principal de l’opposition qui mène à la Révolution consiste en un différend quant à la nature de la richesse.
« A mon sens, la Glorieuse Révolution ne peut pas être considérée comme le triomphe des modernisateurs contre les défenseurs de la société traditionnelle : elle a en effet opposé deux catégories de modernisateurs, chacune essayant pour se légitimer de séduire les esprits réactionnaires, dans un schéma révolutionnaire typique. En effet, les révolutions naissent la plupart du temps lorsque les autorités politiques en place admettent le besoin de se moderniser. […] En légitimant le processus de modernisation par la nécessité de rompre avec le passé, les autorités ouvrent la voie aux mouvements d’opposition, qui n’ont plus besoin de justifier leur refus du mode de vie traditionnel. Il ne s’agit pour eux que de convaincre de la supériorité de leur modèle. Le pouvoir en place ne peut plus compter sur la loyauté habituelle des élites. Ce schéma politique, qui s’est réitéré de nombreuses fois, a été inauguré par les révolutionnaires anglais de la fin du XVIIe siècle » (Steven Pincus, « La Révolution anglaise de 1688 : économie politique et transformation radicale » (Revue d’histoire moderne et contemporaine, 2011, p. 7-52).
A cette rivalité interne à la vie politique anglaise, il faut ajouter une compétition entre l’Angleterre et les Provinces-Unies sur le plan de la puissance maritime. Il faut enfin ajouter un 3e plan : celui des rivalités familiales, liées à des querelles confessionnelles. Jacques II est un fervent catholique et a pris plusieurs mesures favorisant le catholicisme depuis 1685, notamment en Irlande. Il perd alors le soutien de ses deux filles protestantes. Anne est mariée au roi Georges de Danemark ; Marie est l’épouse de Guillaume d’Orange depuis 1677, Stathouder des Provinces-Unies. Guillaume d’Orange est donc un prétendant sérieux au trône d’Angleterre. De surcroît, il est protestant et écrit une lettre dans laquelle il promet de défendre la liberté et l’anglicanisme. La naissance d’un fils de Jacques II le 10 juin 1688, baptisé dans la religion catholique, met le feu aux poudres. Le 30 juin, 7 Lords anglais écrivent à Guillaume d’Orange pour lui offrir le trône d’Angleterre.
IV. Les transformations de l’Etat en un Etat militaro-fiscal en Angleterre
Ainsi, il faut considérer Jacques II comme un « prince extrêmement sophistiqué », qui défend les intérêts de l’Angleterre en s’attachant à moderniser son royaume. Steven Pincus a montré que Jacques II s’inspire de son cousin Louis XIV pour y jeter les fondements de l’Etat absolutiste moderne. Or, un Etat moderne doit posséder une armée modernisée. Le problème des rois d’Angleterre est que cette question du contrôle de l’armée empoisonne les relations avec le Parlement depuis le règne de Charles Ier (1625-1649) et de Charles II (1660-1685). L’Angleterre n’a pas encore connu sa révolution militaire et ne possède que des marins sur les navires de la Navy et des milices locales qui protègent les côtes et assurent les missions de police. En 1685, 300 hommes mal armés suffisent à ébranler le pouvoir central, lorsque le duc de Monmouth, bâtard de Charles II, se proclame plus légitime que le frère du roi, converti secrètement au catholicisme. La crise surmontée, Jacques II s’efforce de renforcer l’armée pour se protéger des séditions.
La flotte doit elle aussi être modernisée. Avant d’être roi, Jacques Stuart était à la tête de l’Amirauté. Dès 1677, il avait lancé la construction de navires de guerre. C’est lui qui développe la Royal Navy qui combat pendant la Guerre de Neuf Ans (1689-1697) et la Guerre de Succession d’Espagne (1702-1713).
La construction de l’Etat moderne en Angleterre n’est donc pas uniquement le fait de Guillaume III. Steven Pincus rappelle le rôle important joué par Jacques II. En revanche, il est indéniable que le nouveau roi a considérablement modernisé l’Angleterre, en particulier sur la question économique. C’est à cette condition que l’Angleterre devient un Etat militaro-fiscal.
Pour créer un Etat absolu interventionniste, le nouveau roi est conscient que les besoins financiers seront colossaux. Jacques II et ses conseillers avaient imaginé qu’un vaste empire ultra-marin et centralisé (réunissant l’Inde, l’Amérique du Nord et les Caraïbes) serait le meilleur moyen d’assurer la fortune nécessaire. Ses opposants conçoivent eux aussi un Etat centralisé, mais s’inspirent davantage du modèle hollandais que de la monarchie absolue française. Pour parvenir à la croissance économique capable de soutenir le développement de l’Etat, ils privilégient la participation politique, la tolérance religieuse, l’encouragement de l’esprit d’initiative, le développement des manufactures.
C’est dans le domaine de l’économie politique que se trouve la véritable révolution. C’est Carew Reynell qui a le mieux défendu l’économie politique commerciale, dans un texte publié en 1685. Il est convaincu que « le commerce et le nombre de ses habitants constituent la force d’une nation ». Le travail et les manufactures importent donc plus que la terre ou les matières premières.
Si Reynell était certain que l’Angleterre pouvait tout à fait voir sa richesse augmenter très fortement, et avec elle sa puissance, il y avait une nécessité pour l’Etat d’intervenir pour soutenir le commerce. Il fallait non seulement éliminer les lois et règlements nuisibles à l’activité économique, mais aussi créer des services d’État pour aider le commerce. Comme le résume Steven Pincus, « la liberté des échanges, les naturalisations, l’accroissement de la population, la tolérance religieuse, la fin des arrestations arbitraires, la garantie de la propriété, des droits de douane faibles, des avantages pour les marchands, des crédits avantageux, des endroits pour secourir les malheureux, et des emplois pour tous ceux qui le souhaitaient : tels étaient pour Reynell les moyens à employer pour encourager l’activité économique […]. Pour Reynell, le commerce n’est intéressant que s’il permet de rapporter en Angleterre des matières premières transformables en produits manufacturés. L’East India Company, qui ne rapportait que des produits à réexporter, pouvait bien être utile à ses actionnaires, elle ne l’était pas pour la nation ».
Les propositions de Carew Reynell sont prolongées par le philosophe John Locke et par sir John Lowther dans ses Règles pour l’essor du commerce. La pensée whig est donc convaincue que la richesse, créée par le travail et par le commerce, est potentiellement infinie. Elle n’est limitée que par la volonté industrieuse des peuples, et non par l’étendue des possessions du royaume. Le meilleur moyen de garantir l’accès des secteurs les plus productifs de l’économie aux capitaux serait de créer une banque nationale publique, qui permettrait d’élargir l’accès au crédit.
Du point de vue des Tories, les conceptions sont bien différentes. Le principal conseiller de Jacques II sur ces questions est Josiah Child. Ce dernier a pris le contrôle de l’East India Company à la fin du règne de Charles II, en devenant le plus influent des Messieurs. Avec l’aide du roi, il remplace les administrateurs whigs par des courtisans catholiques et tories. Dès lors, l’EIC devient étroitement liée à la monarchie sous Jacques II. Ceci n’a maintenant rien de surprenant. Jacques II lui-même investit une part de sa fortune personnelle dans la Compagnie. En échange, la Compagnie soutient la volonté de Jacques II de lever des impôts sans l’accord du Parlement, et se donne elle-même un pouvoir sans limite dans ses possessions.
Pour le gouvernement en place jusqu’à la Glorieuse Révolution (largement influencé par la pensée économique de Josiah Child), la propriété n’est que naturelle et terrienne. La richesse n’est que mobilière. Elle est donc limitée. Plutôt que de créer une banque nationale, il vaudrait mieux soutenir les privilèges des grandes compagnies commerciales. Il s’agit d’une doctrine mercantiliste classique, la même que celle de Colbert en France (ce pays étant un modèle d’Etat dont s’inspire étroitement Jacques II).
Dans les années 1685-1688, les rivalités entre l’EIC et ses partenaires tourne au procès. A partir de 1685, les compagnies à charte sont de plus en plus soutenues contre des marchands qui risquent de menacer la solidité de la compagnie. Le King’s Bench condamne en janvier 1685 le marchand Thomas Sandy qui commerçait sans autorisation. Dans ces mêmes années, l’EIC passe d’une association marchande à une puissance militaire en Inde, dont les possessions sont menacées par les Hollandais. L’EIC exige de Jacques II, allié à Louis XIV, une guerre contre les Provinces-Unies (alors que les whigs préfèrent s’en inspirer pour combattre la France). Pour les Tories et les Messieurs, les Hollandais représentaient les seuls concurrents commerciaux de l’Angleterre.
Après la victoire de Guillaume d’Orange, les Whigs mettent en place une série de transformations économiques qui accélèrent la formation de l’Etat militaro-fiscal. La Chambre des Communes réoriente rapidement la politique fiscale de l’Angleterre. Les Tories, sous Charles II, étaient parvenus à créer un nouvel impôt (la Hearth Tax) sur le nombre d’âtres dans chaque maison. Cette taxe a provoqué de nombreuses révoltes, en particulier celle des forgerons de Birmingham (1672). Les Whigs abrogent donc la Hearth Tax.
Leur seconde cible est évidemment l’East India Company. Les libéraux avancent de nombreux arguments en faveur de sa dissolution, ou au moins de sa profonde réorganisation.
Mais rapidement, une nouvelle tâche anime les Whigs et Guillaume III : obtenir de Louis XIV qu’il reconnaisse la nouvelle dynastie sur le trône d’Angleterre, et cesse de financer les tentatives de Restauration des Stuarts réfugiés en France. Il faut, au cours de la Guerre de Neuf Ans, combattre ardemment la puissance française. Or, la conduite de la guerre pose rapidement des problèmes financiers. En 1692, l’alternative est simple : soit battre en retraite face à Louis XIV, comme le préconisaient les Tories (qui défendaient l’idée de buts de guerre plus limités), soit endosser les conséquences radicales de l’économie politique whig (et les réformes préconisées depuis longtemps par les adversaires de Josiah Child). En 1694, Guillaume III était prêt à soutenir les Whigs.
La réorientation de l’économie vers les manufactures devrait, selon les Whigs, permettre de financer la guerre contre Louis XIV. Pour cela, il fallait nécessairement créer une Banque nationale capable de motiver l’esprit d’entreprise et la création de manufactures. la fin de la session parlementaire très tendue de 1694, le Parlement créa la banque d’Angleterre. De nombreux adversaires de l’EIC, tels que John Cholmley, Sir John Chardin, Sir Robert Clayton, Sir James et Abraham Houblon, John Ward, Thomas Pitt et John Paige figuraient parmi les premiers actionnaires de la banque.
Pour le parlementaire whig John Toland, la création de la Banque d’Angleterre illustre l’émergence de l’Angleterre comme puissance économique majeure. Ceci n’a été possible que parce que les Anglais ont, sous le coup du changement dynastique, osé modifier leur attitude vis-à-vis de leur propre économie. D’après les travaux de John Pocock, la révolution financière de la fin du XVIIe siècle aurait été davantage imposée de l’extérieur qu’issue des débats idéologiques intérieurs qui opposaient Whigs et Tories. Elle n’aurait été qu’une conséquence des événements de 1688-1692. Les Anglais auraient même, durablement, développés des arguments farouchement opposés à cette révolution du paradigme financier. Peter Dickson, quand il analyse les transformations des années 1690, considère lui aussi que les réactions du public à la révolution financière ont été hostiles.
Selon Steven Pincus, il y a bel et bien eu une révolution dans le champs de l’économie politique ; mais c’est le résultat d’une situation très conflictuelle. La transformation radicale des années 1690 est le produit d’un débat entre deux programmes économiques modernes rivaux. Tous reconnaissaient le caractère commercial de la société anglaise (une « nation de boutiquiers », dit Napoléon un siècle plus tard). Mais ils s’affrontent sur la direction à prendre : agrandir l’empire outre-mer ou développer les manufactures en Angleterre ? La création de la Banque d’Angleterre est le fruit de ces débats et le symbole de la victoire des partisans de la seconde voie sur les défenseurs de la pensée Stuart. La Banque d’Angleterre a été une création whig combattue par les Tories.
Après la création de la Banque d’Angleterre, le vote du Triennal Act (1694) et la transparence des comptes de l’Echiquier, publiés chaque année, permet au Parlement de contrôler l’action du gouvernement, ce qui était la condition sine qua non de la permission de développer sa puissance militaire. En 1694, le Mutiny Act autorise le maintien de l’armée en plus de la Royal Navy. En 1699, le Parlement autorise 12000 en Irlande et 7000 soldats dans le reste de la Grande-Bretagne en temps de paix.
Dès lors, d’autres historiens (Aaron Graham, Patrick Walsh, Michael Braddick, Christopher Storrs…) ont montré que la Grande-Bretagne devient un véritable Etat militaro-fiscal, capable de soutenir une action à grande échelle grâce à son système fiscal innovant. Il crée des institutions de crédit, l’administration qui gère efficacement la fiscalité nationale, et contrôle sa dette. La répétition des guerres contre Louis XIV a permis le développement de l’Etat moderne britannique. Au XVIIIe siècle suivant, la capacité de l’Etat moderne à financer les armées et les flottes navales actives dans des théâtres d’opération de plus en plus lointains, devient le principal critère de la puissance.
Comme les intérêts sont financés par la fiscalité indirecte (les excises), le Parlement (qui doit être réuni régulièrement depuis le Triennal Act de 1694, et qui vote chaque année le Militia Act ainsi que le budget accordé à la monarchie) renforce la confiance des prêteurs. La transparence des comptes de l’Echiquier, publiés chaque année, et la réunion fréquente du Parlement, permettent alors à la monarchie de bénéficier de taux d’intérêts diminués, ce qui allège le service de la dette. L’Etat peut donc continuer d’emprunter à long terme, tout en restant perpétuellement solvable. Cet Etat militaro-fiscal fait la force de la monarchie britannique jusqu’à la guerre d’Indépendance américaine, qui remet alors en cause sa solidité.
V. Exemples de rédactions de sous-parties
Sur l’Etat militaro-fiscal (sujet Guerre et Etat ou Transformation de l’Etat)
Dès le début de notre période, les exigences de la guerre pèsent de plus en plus lourdement sur les Etats et les incitent à se moderniser. En France, la guerre contre l’Espagne (1635-1659) puis les guerres européennes et canadiennes (à partir de 1667) font de l’Etat de justice un Etat de finance ou « fisco-financier », selon l’expression de Daniel Dessert. Outre-Manche, l’historien John Brewer a montré en 1989 (The Sinews of Power) qu’après la « révolution financière » (Peter Dickson), l’Etat anglais s’est transformé en un « Etat militaro-fiscal ». Cet Etat a été capable de soutenir un effort de guerre de plus en plus coûteux, grâce d’une part à une augmentation radicale de la fiscalité, et d’autre part à la mise en place d’une administration civile efficace pour gérer cet effort fiscal et militaire d’une ampleur inédite. Selon Brewer et ses successeur (Aaron Graham, Patrick Walsh, Christopher Storrs, Michael Braddick, Patrick O’Brien…), la monarchie est parvenue, à la fin du XVIIe siècle, à imposer une fiscalité et une armée permanente, ainsi qu’une redoutable marine de guerre. Elle y est parvenue avec la collaboration du Parlement, des grands financiers et d’une administration publique plus efficace. D’après Brewer, cette transformation radicale aurait débuté sous la Restauration, lorsque Jacques II a supprimé l’affermage des impôts et s’est efforcé d’obtenir des Communes l’entretien d’une flotte de guerre (rappelons que le duc d’York a été Lord Amiral jusqu’en 1673) et d’une armée permanente. Elle s’est poursuivie et accélérée après la Glorieuse Révolution, entre 1689 et 1714, dans le contexte de la guerre menée par Guillaume III et Anne Stuart contre Louis XIV. La puissance de l’Etat militaro-fiscal britannique repose alors sur la Banque d’Angleterre (fondée en juillet 1694) et sur la transformation de la dette flottante en une dette nationale à long terme auprès des créanciers de la City. Ainsi, l’Etat peut emprunter les importantes sommes nécessaires au financement de la guerre à des financiers londoniens, en leur garantissant un remboursement sous la forme de rentes perpétuelles, assises sur des recettes fiscales dédiées. Comme les intérêts sont financés par la fiscalité indirecte (les excises), le Parlement (qui doit être réuni régulièrement depuis le Triennal Act de 1694, et qui vote chaque année le Militia Act ainsi que le budget accordé à la monarchie) renforce la confiance des prêteurs. La transparence des comptes de l’Echiquier, publiés chaque année, et la réunion fréquente du Parlement, permettent alors à la monarchie de bénéficier de taux d’intérêts diminués, ce qui allège le service de la dette. L’Etat peut donc continuer d’emprunter à long terme, tout en restant perpétuellement solvable. Cet Etat militaro-fiscal fait la force de la monarchie britannique jusqu’à la guerre d’Indépendance américaine, qui remet alors en cause sa solidité.
Une sous-partie imaginaire sur Steven Pincus
La Glorieuse Révolution a connu un grand nombre de révisions historiographiques successives. A la représentation libérale classique du sens de cet événement (la Whig History inaugurée par Thomas Macaulay en 1848) a répondu la vision révisionniste dont l’influence remonte aux critiques d’Herbert Butterfield en 1931, puis de Conrad Russel. Cependant, les historiens comme John Morrill, Mark Goldie, Quentin Skinner, Timothy Harris, continuent de voir dans 1688 une « révolution conservatrice », orientée vers la défense des libertés anglaises et de l’Eglise anglicane, face aux exigences de tolérance et de modernisation politique de Jacques II. Le changement de souverain aurait peu transformé l’Etat et peu affaibli la monarchie et l’Eglise: Guillaume III n’aurait pas libéré l’Angleterre d’un tyran, mais il l’aurait envahie et aurait pris le pouvoir grâce à un coup d’Etat sans violence.
En 2009, Steven Pincus a publié un ouvrage dans lequel il affirme que la Glorieuse Révolution n’aurait été ni courte, ni pacifique; ni modérée, ni consensuelle; ni raisonnable, ni conservatrice. Elle aurait au contraire été « la première révolution moderne ». Selon lui, 1688 n’aurait pas opposé un camp modernisateur à un camp conservateur, mais deux camps modernisateurs, mettant chacun en avant sa vision renouvelée de l’économie politique. Jacques II s’appuie sur Josiah Child, l’un des directeurs de l’East India Company, d’inspiration tory, pour qui la richesse est naturelle et forcément limitée. Par conséquent, le commerce ne se résume qu’à une compétition internationale féroce en vue de s’approprier des terres dont la possession est à l’origine de tout pouvoir. Pour les Tories, l’Etat doit protéger les compagnies à monopole et leur accorder d’immenses privilèges. Face au roi et à ses soutiens, les Whigs (tels que Carew Reynell) entrevoient, dès le milieu du XVIIe siècle, les potentialités offertes par une société commerciale, dans un monde où la richesse serait produite par le travail, et donc illimitée. L’Etat doit donc soutenir le commerce en éliminant les monopoles et les règlements nuisibles à l’activité économique. Il doit également permettre la liberté des échanges, la garantie de la propriété privée, la facilité d’accès au crédit, les avantages aux marchands. La rivalité entre les tendances whigs et tories est donc davantage économique que politique. C’est la confrontation de ces deux voies de la modernisation de l’Etat qui aurait conduit à la Glorieuse Révolution.
Guillaume III, après avoir conquis le pouvoir par les armes en Angleterre (débarquement à Torbay le 5 novembre 1688), en Irlande (Williamite War jusqu’au traité de Limerick en octobre 1691) et en Ecosse (massacre de Glencoe le 13 février 1692), aurait choisi, selon Pincus, d’adhérer au modèle whig. Il aurait réorienté l’économie britannique vers les manufactures, la banque, le commerce colonial. La stratégie militaire aurait été tournée vers la « Blue Water Policy », qui consiste à développer la Royal Navy dont les navires protègent les navires et les routes commerciales entre l’Angleterre et ses colonies américaines et indiennes. Ainsi, la « révolution financière » étudiée par Peter Dickson fut une réalisation whig dans les années 1690. Elle est la conséquence d’un conflit brutal entre deux visions économiques antagonistes.