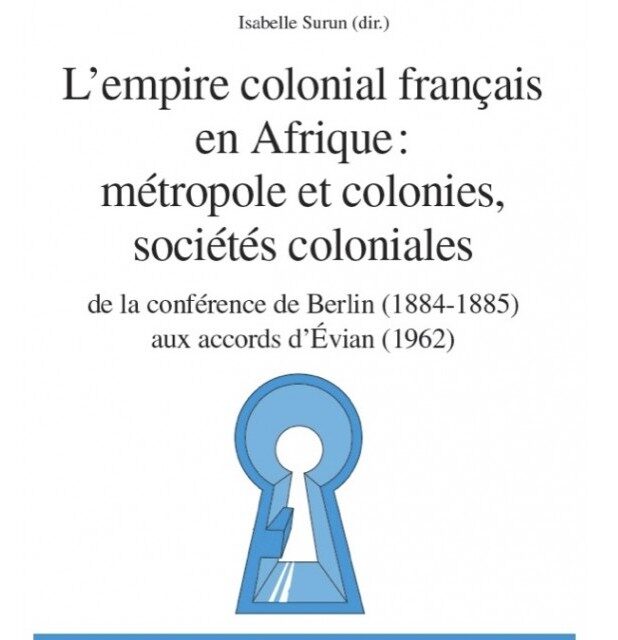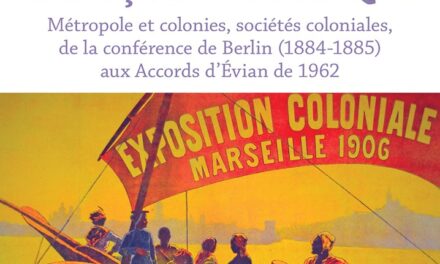Une fiche épistémologique très intéressante qui présente clairement différentes approches de l’historiographie et de l’histoire des empires et des sociétés coloniales depuis le XIXe siècle. Les différents ouvrages résumés d’après le site de leur éditeur, ou d’après des comptes-rendus scientifiques, permettent de mettre en évidence le parcours historiographique qui conduit à la mise en place de la nouvelle question de concours. Elle vaut autant pour une approche heuristique de la question de CAPES (les relations entre la société colonialiste française colonialiste et les sociétés colonisées en Afrique depuis le XIXe siècle) que pour la question d’agrégation (les relations entre les acteurs de l’histoire africaine en-dehors du continent africain au XXe siècle).
Cette approche épistémologique peut gagner à être mise en relation avec d’autres fiches présentes sur Clio-prépas :
- Christian Delacroix, François Dosse, Patrick Garcia et Nicolas Offenstadt [dir.], Historiographies, coll. Folio, Gallimard, 2010
- Lexique d’Historiographie
- Différencier les formes historiographiques de l’histoire globale
INTRODUCTION
Empire colonial français en Afrique : espace vaste et hétérogène mais bien délimité. Il est marqué par une grande diversité dans les statuts des territoires.
D’abord placée sous la tutelle du ministère de la Guerre pendant la conquête, l’Algérie dépendit ensuite du ministère de l’Intérieur, puisqu’elle était considérée comme partie intégrante du territoire français : elle était divisée en trois départements (Oran, Alger, Constantine) depuis 1848. Au sein de cet ensemble impérial français : l’Algérie constitue une exception au regard de la chronologie et de son mode d’administration, mais surtout du fait qu’il s’agit de la seule colonie de peuplement de la France en Afrique – en dehors de ce continent, il faudrait ajouter la Nouvelle-Calédonie.
La Tunisie et le Maroc relevaient du régime des protectorats qui conservait en principe la souveraineté interne des États « protégés », en l’occurrence la monarchie chérifienne au Maroc et le beylicat de Tunis, et dépendaient à ce titre du ministère des Affaires étrangères.
Les territoires d’Afrique subsaharienne ont été regroupés en fédérations de colonies : l’Afrique occidentale française (AOF), créée en 1895 et dont la capitale est Dakar depuis 1902, rassemble 8 colonies (Sénégal, Soudan Français, Guinée, Côte d’Ivoire, Dahomey, Haute Volta, Niger et Mauritanie) et l’Afrique équatoriale française (AEF), dont le siège est à Brazzaville, en regroupe 4 depuis 1910 (Gabon, Oubangui-Chari, Moyen Congo, Tchad).
Quant à Madagascar, annexée en 1896, elle se voit adjoindre la colonie de Mayotte et dépendances (les Comores) en 1912. À cela s’ajoute le petit territoire enclavé de la Côte française des Somalis, constitué administrativement en 1896 autour de Djibouti.
Enfin, les Quatre communes du Sénégal (Saint-Louis, Gorée et Rufisque, anciens comptoirs de la France d’Ancien Régime, puis Dakar créée en 1857) constituent une particularité dans cet ensemble : elles connaissent le même régime juridique que les « vieilles colonies ». Leurs habitants, appelés les « Originaires » (des Quatre communes), sont citoyens français depuis 1848, et non sujets français comme les habitants de tous les territoires incorporés dans l’Empire après cette date. Les colonies d’Afrique subsaharienne ont été administrées par un sous-secrétariat d’État aux Colonies rattaché au ministère de la Marine, ou brièvement au ministère du Commerce (1881-1882 et 1891-1894), jusqu’à la création d’un ministère des Colonies (1894).
1884-1885 : Conférence de Berlin – qui marque dans les représentations communes, le partage de l’Afrique (processus étendu sur plusieurs décennies – des années 1880 aux années 1910, voire bien au-delà, la délimitation de certains territoires n’étant pas toujours achevée au moment des décolonisations) par les puissances européennes.
Toutefois, la conférence de Berlin n’est pas le point de départ de la colonisation française en Afrique : l’Algérie intégra ainsi l’Empire français à partir de 1830, et certains autres territoires africains avant les années 1880. L’expansion impériale en Afrique constitue un phénomène international (au-delà du seul empire français).
1962 : Accords d’Évian ; Indépendance de l’Algérie – qui marque dans les représentations communes, la fin de l’histoire de la colonisation française, sous la forme que celle-ci adopta au cours du XIXe siècle. Entre 1956 et 1962 : sortie des territoires africains de l’Empire colonial français. L’année 1960 voyant à elle seule la naissance de 15 nouveaux États africains – anciennement sous souveraineté ou tutelle française. Des exceptions : les Comores, qui se déterminent par référendum pour l’indépendance en 1974 (sauf Mayotte, qui vote en faveur du maintien dans la République française) et le Territoire français des Afars et des Issas (ancienne Côte française des Somalis), qui doit attendre jusqu’en 1977.
Source de la carte: Webdossier L’histoire
HISTORIOGRAPHIE
Le grand public français a redécouvert la part coloniale de son histoire à la faveur des controverses qui l’ont porté sur la place publique :
– BERTRAND Romain, « Les sciences sociales et le « moment colonial » : de la problématique de la domination coloniale à celle de l’hégémonie impériale », Questions de Recherche, n°16, juin 2006.
La place prise par l’hypothèse – souvent devenue postulat – de la » permanence » ou de la » rémanence » contemporaines des imaginaires et des pratiques de domination propres aux » situations coloniales » invite à essayer d’esquisser un premier état des lieux du renouveau de l’historiographie du fait colonial. Après avoir passé en revue les principales lignes de force de cette historiographie, l’on s’efforcera de montrer, au regard du cas sud-est asiatique, que la compréhension des dynamiques du moment colonial des sociétés politiques non européennes gagne à être raccordée à une interrogation comparatiste sur la notion d’hégémonie impériale. Il s’agira plus précisément de rappeler que les sociétés politiques d’Asie du Sud-Est vivaient, à la veille de leur » rencontre coloniale » avec l’Europe, sous le régime de modes spécifiques d’entrée en modernité étatique – et, ce faisant, de pointer les phénomènes d’enchâssement des historicités impériales. Analyser le moment colonial de l’Insulinde ou de l’Indochine non plus comme l’unique point d’origine des entrées en modernité (étatique, capitaliste, individualiste), mais comme une séquence d’une histoire impériale »eurasiatique » de » longue durée « , c’est en effet se donner les moyens de penser l’histoire des sociétés asiatiques dans son irréductible spécificité.
– BERTRAND Romain, Mémoire d’empire. La controverse autour du « fait colonial », Paris, Editions du Croquant et Savoir/Agir, 2006.
Cet essai retrace l’histoire des débats et des mobilisations autour de la loi du 23 février 2005 sur le » rôle positif » de la colonisation française, qui a pavé la voie à la montée en puissance du thème des » guerres de mémoire « . Il s’interroge à cette fin aussi bien sur les stratégies des députés de la majorité, qui ont voté et défendu ce texte, que sur le discours et les tactiques des organisations militantes qui ont réclamé son abrogation. Revenant en détail sur les relations clientélaires entre les élus et les associations de » rapatriés » d’Algérie, il s’efforce de mettre au jour les processus politiques- non pas exceptionnels mais terriblement ordinaires qui ont concouru à la « mise en controverse » du « fait colonial ». Chemin faisant, il montre de quelle façon l’argument de la » République coloniale » brandi par les indigènes de la République et les associations du mouvement autonome de l’immigration a été dévoyé pour imposer une grille de lecture spécifique des « émeutes urbaines » d’octobre-novembre 2005 référées non plus à des problèmes concrets d’exclusion et de discrimination appelant une action (et une auto-critique) des pouvoirs publics, mais à d’élusifs ressentiments mémoriels. Il dresse de ta sorte l’inventaire des mécanismes, et surtout des conséquences, de l’émergence d’un nouvel espace de débat où la « question (post) coloniale » en vient à éluder la « question sociale ».
Des documentaires :
– BALL Marc, MISKÉ Karim et SINGARAVÉLOU Pierre, Décolonisations, Arte, 2020 :
Les auteurs y brossent une fresque transimpériale de l’histoire coloniale incarnée dans des personnages emblématiques qui portent, chacun à sa façon, des luttes contre la domination coloniale depuis le milieu du XIXe siècle. Considérant que la décolonisation commence au premier jour de la colonisation, ils adoptent le point de vue des « colonisés » avec finesse et sensibilité, mettant à l’honneur leurs capacités d’action sans en escamoter les contradictions. L’histoire de la résistance des peuples colonisés débuta dès l’arrivée des premiers colons. Face à la supériorité militaire européenne, des stratégies alternatives sont adoptées, de la désobéissance civile à la révolution communiste, en passant par le football et la littérature. Des figures oubliées sont évoquées telles que la reine de Jhansi, Manikarnika Tambe, ou le Sénégalais Lamine Senghor.
– BLANCHARD Pascal, KORN-BRZOZA David, Décolonisations : du sang et des larmes, France 2, 2020 :
Dès les années 30, alors que l’empire colonial français est à son apogée, les premières revendications d’indépendance se font entendre mais la France reste sourde à ces manifestations. La seconde guerre mondiale va rabattre les cartes et remettre en question un système de domination qui semblait jusque-là immuable. S’engage alors un cycle de répressions qui va durer un quart de siècle. Du Sénégal à l’Indochine et de Madagascar à l’Algérie en passant par le Maroc et la Côte d’Ivoire, la France va tenter coûte que coûte de conserver ses colonies. En vain. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, alors que la France étend sa domination sur plus de cent dix millions d’hommes et de femmes à travers les cinq continents, son empire colonial s’enfonce brusquement dans près d’un quart de siècle de sang et de larmes. Une déchirure indélébile qui va durablement éprouver les corps et les esprits de part et d’autre ; une rupture indépassable qui continue de nous façonner. De la diversité culturelle de la France à la ségrégation des banlieues, du principe d’intégration à la persistance du racisme et de la discrimination, du vivre ensemble à la peur de l’Autre, cette histoire est loin d’être soldée. Il s’agit désormais de la raconter dans toutes ses complexités et ses paradoxes pour enfin appréhender plus sereinement ce passé dont nous somme tous les héritiers. Réalisée à partir d’images d’archives en grande partie inédites et mise en couleur, la série documentaire Décolonisations – Du sang et des larmes donne la parole aux témoins, acteurs et victimes de cette page douloureuse de notre histoire. À travers ce documentaire, la décolonisation française est retracée de façon plus contestable et spectaculaire. Cela tend à affirmer que la lisière reste poreuse entre histoire et mémoire.
Les renouvellements de l’histoire de la colonisation française :
L’histoire de colonisation française est rédigée au départ exclusivement par des administrateurs et des hommes politiques qui sont eux-mêmes associés à l’entreprise impériale. Jusqu’aux années 1960, rares ont été les historiens qui remettaient en cause le fait colonial, comme le fit Charles-André Julien.
– JULIEN Charles-André, Une pensée anticoloniale, Paris, Sindbad, 1979 :
Charles-André Julien fut l’un des pionniers du socialisme en Algérie, l’interlocuteur de Jaurès, de Lénine et Trotski… Il fut encore un militant très actif de la décolonisation… Il faut l’avoir connu téléphonant aux ministres, défiant les présidents, rédigeant les manifestes… Sa vie est un long J’accuse, qui fait de lui comme le Zola de la décolonisation. Ce jugement de Jean Lacouture justifie, a posteriori, ce livre rassemblant – grâce à Magali Morsy – les écrits anticoloniaux les plus marquants de Charles-André Julien : interventions, articles et préfaces, essentiellement consacrés au Maghreb, mais aussi à la Syrie et au Congo, à Schoelcher et à Toussaint-Louverture. Jusqu’au cri de lucidité et de cohérence du texte-épilogue. Loin de renier mes changements d’opinion, au cours d’une longue expérience, je crois qu’ils marquent les positions que j’ai cru devoir prendre selon la conjoncture. Au soir de ma vie, je me demande si ce n’est pas ce que j’ai fait de mieux.
Les premiers travaux s’intéressent aux modes d’administration des colonies ; à la législation qui avait permis de définir le statut des sujets coloniaux ; à la participation d’auxiliaires indigènes à l’administration et à l’idéologie qui sous-tendait l’entreprise coloniale. Débat international sur la place des facteurs économiques dans la colonisation et sur la rentabilité des investissements réalisés dans ce secteur. Samir Amin dénonce le pillage dont avaient été victimes les pays colonisés, passage d’une économie coloniale à la « mise en valeur ». D’autres historiens mirent plutôt en avant le rôle des facteurs politiques dans l’émergence de l’impérialisme européen (Brunschwig, 1960) dans la lignée de la controverse soulevée par les Britanniques. L’étude quantitative du commerce et des investissements de la France dans ses colonies permit de juger finalement décevant l’intérêt économique de l’empire. Troisième approche : l’histoire sociale des populations colonisées – en particulier rurales – mais portant aussi sur de nouvelles catégories sociales comme les ouvriers.
– BRUNSCHWIG Henri, Mythes et réalités de l’empire colonial français, 1871-1914, Paris, Armand Colin, 1960 :
Henri Brunschwig passe ici en revue les composantes, réelles ou fantasmées, de l’impérialisme colonial français ; nationalisme continental et origines de l’impérialisme colonial, nationalisme et libéralisme au XIXe siècle, origines de l’impérialisme colonial français, Léopold II en Afrique, les débuts de la rivalité franco-belge, le protectorat tunisien depuis ses origines jusqu’à sa dégradation. Mais aussi le protectionnisme, le chauvinisme, le parti colonial français. Il nous explique encore, notamment, à qui bénéficiait la politique coloniale française.
Histoire coloniale et « aires culturelles » : fossé entre la théorie et la pratique concernant l’histoire des colonisateurs et celle des colonisés (contradiction). Vision trop européocentriste. Travaux privilégiés du « précolonial » inscrivant l’Afrique dans une historicité de longue durée. Cloisonnement entre spécialistes de l’Afrique. L’articulation entre l’histoire coloniale et les études africanistes mis en avant par Catherine Coquery-Vidrovitch à travers des problématiques d’histoire sociale, économique, politique ; Odile Goerg pour l’histoire urbaine et culturelle.
– COQUERY-VIDROVITCH Catherine (dir.), L’Afrique occidentale au temps des Français. Colonisateurs et colonisés, c. 1860-1960, Paris, La Découverte, 1992 :
L’Afrique » vue d’en bas » : c’est sur une histoire méconnue que ce livre original lève le voile ; Malgré sa brièveté relative, l’épisode colonial a profondément marqué les États de l’ancien Ouest africain français. Ils sont neuf aujourd’hui, d’ouest en est et du nord au sud : Mauritanie, Sénégal, Niger, Burkina-Faso, Guinée, Côte d’Ivoire, Bénin, Togo. Or, tandis que la politique » métropolitaine » commence à être bien connue, il n’en va pas de même de la rencontre entre colonisés et colonisateurs, de l’histoire vécue sur le terrain, tour à tour et à la fois lutte, dialogue et échanges. L’histoire de la colonisation s’est inscrite dans le face à face des institutions, des esprits et des cultures. Ce regard croisé est à l’origine de ce livre, fruit d’un travail d’équipe mené depuis plusieurs années par les meilleurs spécialistes africains et français, qui ont mobilisé des archives ouvertes parfois depuis peu, et les souvenirs oraux d’acteurs souvent encore en vie. La première partie traite de thèmes communs à l’ensemble : la politique et la géopolitique françaises, l’armée coloniale, les objectifs économiques, les dynamiques sociales, le rôle de l’islam. La seconde partie rassemble les monographies consacrées à chacun de ces » États coloniaux » : ils ont été marqués par une histoire chaque fois différente, suivant des milieux géographiques contrastés, des péripéties antérieures, des héritages démographiques et culturels anciens, et les modalités spécifiques de la pénétration française. Au total, un ouvrage de référence indispensable pour comprendre, dans les États francophones de l’Afrique de l’Ouest, l’unité et la diversité des soubresauts et des aspirations d’autrefois et d’aujourd’hui.
– GOERG Odile et HUETZ DE LEMPS Xavier, La ville coloniale (XVe-XXe), in Jean-Luc PINOL (dir.), Histoire de l’Europe urbaine, Paris, Seuil, 2003 :
De la fin du XVe siècle au milieu du XXe siècle, la ville a joué un rôle primordial dans le processus d’expansion de l’Europe dans le monde. De Manille à Mexico, de Dakar à New Delhi, de Hong Kong à Washington, ce livre analyse les tentatives de transposition outremer de conceptions de la ville, de modes d’organisation, de techniques constructives et d’aménagement, de styles architecturaux inspirés des métropoles européennes. Fruits d’interactions incessantes et uniques, entre des acteurs individuels et collectifs, publics et privés, colons et colonisés, les villes coloniales ne sont jamais de purs réceptacles. À leur tour, ces expériences ultramarines anticipent parfois des développements appliqués ultérieurement dans les villes européennes. Cet ouvrage permet de comprendre combien cette forme de colonisation européenne par la ville a profondément modelé les espaces et les sociétés, au point que nombre d’agglomérations du monde actuel en portent encore les traces.
– GOERG Odile, Fantômas sous les tropiques. Aller au cinéma en Afrique coloniale, Paris, Vendémiaire, 2015 :
Les séances ont commencé dans les rues, les cours ou les cafés. Puis surgirent les salles aux noms grandioses, tout droit venus d’Europe : Rex, Vox, Palace ou Palladium… Nous sommes en Afrique subsaharienne, sous domination française ou britannique, dans la période de l’entre-deux-guerres : Fantômas, Tarzan, Les Trois Mousquetaires, King Kong font désormais partie d’un paysage culturel partagé. Tandis que John Wayne ou Gary Cooper deviennent des modèles pour des générations de jeunes gens en quête de repères. Le 7e art est bien perçu par les populations comme un moyen d’échapper, provisoirement, à un quotidien marqué par la colonisation. Et le lieu de la projection comme un espace étrange où Noirs et Blancs se côtoient sans se mêler, où s’exerce une censure qui ne dit pas son nom, où l’on apprend, aussi, que les Européens ne sont pas invincibles, que leurs mœurs ne sont pas irréprochables et leur système politique pas exempt de critiques…
Des politiques coloniales à l’ordre colonial : « idée coloniale » (Girardet, 1972), champ d’application de politiques coloniales décidées en métropole, et de l’administrateur, la figure clef de ce transfert unilatéral d’autorité et de valeurs, agent d’une domination incontestée. L’histoire des institutions coloniales (Collot, Mbaye) avec des débats sur les modes d’administration directe ou indirecte, constitue un grand classique. Études sur Lyautey (Rivet) ou sur des gouverneurs de l’AOF (Conklin). Pratiques électorales et aux déplacements de la ligne de partage entre « indigènes » et citoyens en Algérie comme en Afrique subsaharienne (Jalabert, Joly, Weber). Question de la citoyenneté dans le cadre des empires (Burbank et Cooper) faisant apparaître la notion de « sujets français » qui dissocie la nationalité de la citoyenneté. Notion « d’indigénat » a donné lieu à des débats ayant permis de préciser les contours du statut d’indigène et la mise en œuvre du régime pénal de l’indigénat. Contradictions et dysfonctionnements de l’administration et des institutions coloniales à travers les affaires qui provoquent des commissions d’enquête, comme la mission confiée à Brazza lorsqu’éclate le scandale du Congo (affaire Gaud-Toqué), l’abus de pouvoir ; la violence ordinaire. En effet, la question de la violente est très présente : certains insistent sur sa dimension coercitive et le définissent par une violence radicale allant jusqu’à l’extermination ; d’autres soulignent la diversité des formes de violence qu’il revêt (physique, sociale, économique, culturelle, symbolique).
– GIRARDET Raoul, L’idée coloniale en France de 1871 à 1962, Paris, La Table Ronde, 1972 :
En 1972 Raoul Girardet montrait que, même au temps de son apogée, l’idée coloniale n’a cessé d’être contestée. En trois parties chronologiques, Raoul Girardet analyse la progressive mise en forme de « l’idée coloniale », puis son apogée aux alentours de l’exposition de Vincennes de 1931 et enfin son reflux avec les guerres de décolonisation. Situant son travail sur le plan de « l’histoire collective des idées, des sentiments et des croyances », il identifie les acteurs majeurs de la propagande en faveur de la politique de colonisation, les moyens par lesquels ceux-ci ont entrepris de conquérir l’opinion publique et les innombrables débats auxquels l’idée coloniale a donné lieu, distinguant notamment avec soin les différentes formes historiques de l’anticolonialisme. Loin d’une histoire classique des idées, Girardet, en tentant de mesurer la force de pénétration de l’idée coloniale dans l’opinion publique, livre des analyses que l’on doit inscrire dans la généalogie de l’histoire des représentations et des imaginaires sociaux. Girardet montre que, même au temps de son apogée, l’idée coloniale n’a cessé d’être contestée – au point que « le débat colonial » aurait peut-être été un titre plus approprié à son livre. Étonnamment, il observe que, au moment de la parution de celui-ci, en 1972, « le débat colonial semble définitivement clos ». Le constat peut nous paraître étrange, aujourd’hui que le passé colonial est omniprésent dans l’espace public. Mais il est peut-être aussi la raison qui fait que, malgré les engagements personnels de l’auteur, son histoire de l’idée coloniale, réduite aux conditions de son émergence, de son triomphe et de sa disparition, est si apaisée, « dix ans après les accords d’Évian ».
– COLLOT Claude, Les institutions de l’Algérie durant la période coloniale, 1830-1962, Paris, Editions du CNRS/Alger, Office des publications universitaires, 1987 :
Une vision de l’histoire de l’Algérie qui s’intéresse à son organisation administrative, ses finances, sa justice et ses libertés publiques.
– MBAYE Saliou, Histoire des institutions coloniales françaises en Afrique de l’Ouest (1816-1960), Dakar, Imprimerie Saint-Paul, 1991 :
Cet ouvrage se présente comme un manuel décrivant les institutions mises en place par le colonisateur français dans l’ancienne Afrique occidentale française. La période coloniale étudiée, 1816-1960, donne, de manière inévitable, pour sa première partie plus d’importance au Sénégal qu’aux sept autres pays du groupe, de même que la similitude des problèmes et des institutions mises en place permet, pour les vingt dernières années, des allusions à l’ancienne A.E.F. ou à Madagascar, voire à des parties plus éloignées de l’Empire colonial français. Ce manuel conçu par un archiviste, au sein des Archives du Sénégal qui abritent, on le sait, les archives de l’ancienne A.O.F., se veut au service de ceux qui travaillent dans les Archives, comme archivistes pour les mettre en valeur et les rendre plus utilisables ou comme chercheurs et historiens pour les exploiter. C’est dire qu’il est une illustration et une bonne illustration de la liaison que l’on connaît entre archives et institutions ; c’est dire aussi toute l’utilité qu’on peut en attendre. Certes les instruments de travail, guides, inventaires divers, études de sources ne manquent pas pour les archives de l’Afrique de l’Ouest depuis quatre-vingts ans que les archivistes en rédigent, mais cette étude des institutions productrices de sources historiques manquait et ce manuel vient à son heure.
– RIVET Daniel, Le Maroc de Lyautey à Mohammed V. Le double visage du protectorat, Paris, Denoël, 1999 :
S’il fut de courte durée – moins d’un demi-siècle -, le Protectorat sur le Maroc a laissé une trace majeure dans l’histoire de la France coloniale et a suscité de nombreux ouvrages dominés par la personnalité exceptionnelle de Lyautey l’Africain. Mais l’ouverture récente des » archives de gestion » et l’apport de multiples témoignages permettent de porter un regard neuf sur le processus déclenché en 1912 dans un très vieux royaume par sa mise sous tutelle, et d’y déceler la succession de deux Protectorats. Pendant douze ans, Lyautey, » un vieux lord colonial de la IIIe République « , impose avec éclat – au point d’être taxé d' » indigénofolie » – des conceptions qui sont à l’opposé de celles du milieu ultra-colonial dominant alors à Paris. À la période exaltante et créatrice de ce premier Protectorat, succèdent trois décennies durant lesquelles les Marocains redeviennent peu à peu, après la fin de la » pacification » et la dure guerre du Rif, les acteurs de leur propre histoire, sous le règne du sultan Mohammed ben Youssef. Le deuxième Protectorat s’engage sur une phase déclinante : l’expérience de Lyautey n’a pas été comprise ; ses successeurs – parfois ses disciples comme Noguès ou Labonne – sont paralysés par la carence de Paris qui ne peut définir une politique nord-africaine ; et si le Maroc n’est pas pour l’Etat républicain la bonne affaire que vante la propagande impériale, il l’est pour nombre d’expatriés venus d’Europe. Après la Seconde Guerre mondiale, qui a vu la montée des nationalismes dans tous les empires coloniaux, le Protectorat se prolonge inutilement et le rêve de Lyautey s’achève en 1956 sur le retour triomphal de Mohammed V, après l’ultime et honteux faux pas de la IVe République qui avait déporté le futur roi à Madagascar.
– CONKLIN Alice, A Mission to Civilize. The Republican Idea of Empire in France and West Africa, 1895-1930, Stanford, Stanford University Press, 1997 :
Ce livre aborde une question centrale mais souvent ignorée dans l’histoire de la France moderne et du colonialisme moderne : comment la IIIe République, très appréciée pour ses valeurs démocratiques professées, s’est-elle laissée séduire par l’attrait insidieux et persistant d’une idéologie « civilisatrice » aux connotations racistes distinctes ? En se concentrant sur un groupe particulier de fonctionnaires coloniaux dans un contexte spécifique – les gouverneurs généraux de l’Afrique occidentale française de 1895 à 1930 – l’auteur soutient que l’idéal d’une mission civilisatrice spéciale a eu un impact décisif sur l’élaboration des politiques coloniales et sur l’évolution du républicanisme français moderne en général. Les idées françaises de civilisation – à la fois républicaines, racistes et modernes – ont encouragé les gouverneurs généraux dans les années 1890 à attaquer des institutions africaines « féodales » telles que le régime aristocratique et l’esclavage d’une manière qui renvoyait à la propre expérience française du changement révolutionnaire. Ironiquement, les administrateurs locaux des années 1920 ont également invoqué ces mêmes idées pour justifier des politiques réactionnaires telles que la réintroduction du travail forcé, arguant que la coercition, qui inculquait une éthique du travail à l’Africain « paresseux », légitimait sa perte de liberté. En invoquant constamment les idées de « civilisation », les décideurs politiques coloniaux de Dakar et de Paris ont réussi à occulter les contradictions fondamentales entre les « droits de l’homme » garantis dans une démocratie républicaine et l’acquisition par la force d’un empire qui viole ces droits. En sondant la dimension « républicaine » de la colonisation française en Afrique de l’Ouest, cet ouvrage apporte également un éclairage nouveau sur l’évolution de la IIIe République entre 1895 et 1930. L’un des principaux arguments de l’auteur est que l’idée d’une mission civilisée a subi des changements spectaculaires, en raison des transformations idéologiques, politiques et économiques qui se produisent simultanément en France et dans ses colonies. Par exemple, les révoltes en Afrique de l’Ouest ainsi qu’un climat plus conservateur dans la métropole après la Première Guerre mondiale ont produit chez les gouverneurs généraux un nouveau respect pour les chefs « féodaux », que les Français méprisaient autrefois mais qu’ils réintégraient maintenant comme moyen de contrôle. Cette découverte d’une « tradition » africaine renforce à son tour la réaffirmation des valeurs traditionnelles en France alors que la IIIe République s’efforce de reconquérir le monde qu’elle a « perdu » à Verdun.
– JOLY Vincent, Guerres d’Afrique. 130 ans de guerres coloniales, l’expérience française, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2009 :
Issu d’une habilitation à diriger des recherches, le livre de Vincent Joly se présente comme une synthèse détaillée des guerres coloniales françaises de la prise d’Alger en 1830 à la guerre d’indépendance algérienne de 1954 à 1962. Après un premier chapitre consacré aux « thèmes et débats » relatifs aux « guerres et violences coloniales », l’auteur adopte une logique chronologique consistant à présenter les différents théâtres d’opérations de l’armée française, essentiellement dans la phase de conquête antérieure à 1914. Un chapitre de comparaison européenne conclut d’ailleurs cette partie majeure de l’ouvrage. La période postérieure à la Première Guerre mondiale est plus rapidement traitée, d’où un caractère synthétique accentué aux dépens de l’analyse qui aurait pu, sur le XXe siècle, être plus développée. L’auteur suit trois fils conducteurs. Le premier traite de l’évolution de la stratégie et de la tactique des Français, contraints d’inaugurer, en terre africaine, de nouvelles façons de faire la guerre; cet aspect intéressera les spécialistes de la technique militaire, dans une veine proche de celle des travaux que Jacques Frémeaux a consacrés à la seule Algérie. Le deuxième retrace l’émergence, sur ce terreau, de spécialistes de la guerre coloniale en Afrique, de Bugeaud à Lyautey, en passant par Faidherbe et Gallieni qui, s’ils constituent la lignée des « héros » français de l’aventure militaire coloniale, n’en portaient pas moins des conceptions différentes de l’administration dans les territoires conquis, que Vincent Joly expose avec précision. L’emploi de soldats recrutés localement dans l’armée française, enfin, est analysé à travers les questions cruciales qu’il posait aux contemporains : quel statut et quelle place leur accorder, entre intégration aux corps traditionnels et formation d’une force spéciale – la fameuse « force noire » ? Faut-il les employer sur des théâtres d’opérations européens ? Peut-on le faire, et à quelles conditions ? Globalement, l’ouvrage prend à bras-le-corps la question des effets de retour, sur l’armée française et en métropole, des guerres menées en Afrique, même s’il n’oublie pas les « résistances », celle d’Abd el Kader en particulier, à qui un chapitre est réservé. Il ne faut pas se fier, néanmoins, à l’accent mis sur l’Afrique dans le titre. Le terrain asiatique des guerres coloniales françaises n’est pas oublié, même si l’on peut regretter que son traitement soit déséquilibré. Seule la guerre d’Indochine se voit consacrer un chapitre. Le mérite de l’ouvrage est de proposer une mise au point claire, fondée sur une bibliographie riche incluant les très nombreux travaux anglo-saxons consacrés à ces questions. Comme tel, il se présente comme un point d’entrée dans l’histoire militaire de l’entreprise coloniale française. Il sera très utile à quiconque souhaite s’initier à cette histoire et cherche à repérer des références bibliographiques sur un de ses aspects particuliers. Le revers d’un tel ouvrage d’initiation et de référence, toutefois, tient dans cette qualité même : parce que le livre embrasse un champ très large tout en étant précis sur chaque question qu’il aborde, le lecteur peine à en dégager une [End Page 105] démonstration d’ensemble. Ce n’était pas, il est vrai, l’objectif de l’auteur qui se proposait de livrer un tableau de l’expérience coloniale de l’armée française. Présenter le « savoir-faire » de cette dernière en la matière, alors que le débat public a érigé le fait colonial et ses héritages en thèmes majeurs…
– BURBANK Jane et COOPER Frederick, « Empires, droits et citoyenneté de 212 à 1946 », Annales. Histoire, sciences sociales, 2008, avril-juin, n°3, p. 495-531 :
En 1946, alors que l’Assemblée nationale constituante française débattait des articles relatifs à la nouvelle Constitution de l’empire français outre-mer, un député évoqua le précédent de l’empereur romain Caracalla, qui avait accordé la citoyenneté romaine à tous les hommes libres de l’empire en 212 de notre ère. Cet exemple prouvait qu’il était possible d’être citoyen d’un empire sans pour autant renoncer aux « civilisations locales ». Les auteurs étudient les différentes significations de la citoyenneté et des droits au sein des empires, en s’appuyant sur deux modèles distincts – un modèle romain et un modèle eurasien -et en s’attachant à différents exemples en Russie impériale, en URSS, et dans la France du XXe siècle. L’étude va au-delà de l’association communément établie entre citoyenneté et État-nation, et entre droits et démocratie. La construction et le maintien d’un empire supposaient d’intégrer des peuples divers au sein d’une unité politique, tout en maintenant des éléments de distinction et de hiérarchie. Le fait qu’une république du XXe siècle puisse évoquer un précédent remontant à l’époque classique montre à quel point l’imaginaire et les structures impériales ont gardé leur importance. Cet article plaide en faveur de la reconnaissance de la vaste palette de modalités selon laquelle l’appartenance politique, la différence culturelle et les droits peuvent être analysés, envisagés et compris. En 1946, alors que l’Assemblée nationale constituante de France débattait des articles sur l’empire français d’outre-mer en vue d’une nouvelle constitution, un député a cité un précédent : en 212, l’empereur romain Caracalla a étendu la citoyenneté romaine à tous les sujets masculins et non esclaves de l’empire. L’exemple, a-t-on fait valoir, montre que les gens peuvent être citoyens d’un empire sans renoncer aux « civilisations locales ». Cet article explore les différentes significations de la citoyenneté et des droits dans les empires, en mettant l’accent sur deux modèles différents – romain et eurasien – et en se concentrant sur les exemples contrastés de la Russie impériale, de l’URSS et de la France du XXe siècle. La discussion va au-delà de l’association commune de la citoyenneté avec l’État-nation et des droits avec la démocratie. La construction et le maintien d’un empire, disons-nous, impliquaient de trouver un équilibre entre l’incorporation de diverses personnes dans une unité politique et le maintien de la distinction et de la hiérarchie. Le fait qu’une république du XXe siècle puisse s’inspirer d’un précédent classique suggère l’importance continue des imaginaires et des structures impériales ; Le régime politique n’était pas caractérisé par une distinction binaire entre un noyau et une périphérie subordonnée, mais plutôt par une combinaison multiplex de différents territoires et de différentes personnes qui pouvaient être gouvernés différemment. L’article appelle à la reconnaissance du large éventail de façons dont l’appartenance politique, la différence culturelle et les droits peuvent être analysés, envisagés et compris.
Maintien de l’ordre et « ordre colonial » : « il n’y a pas eu d’âge d’or de la bienveillance » (Bertrand, 2006). Notion « d’hégémonie » : propose un modèle où la domination ne se réduit pas à la coercition mais engage aussi la « direction culturelle et idéologique » qui s’exerce sur la société civile en lui imposant un consensus. Question de la négociation : « transactions hégémoniques impériales » (Bayart et Bertrand) par lesquelles les colonisés peuvent faire entendre leur voix, mettant en œuvre des stratégies d’évitement ; vecteurs de la « reproduction du legs impérial » (élites évoluées : instituteurs, interprètes, fonctionnaires indigènes, notabilités « cooptées » par l’administration coloniale). Fruit d’une relation dissymétrique inscrite dans un contexte de domination, mais cette domination ne se réduit pas au seul exercice de la violence et à l’aliénation des populations autochtones : affaire d’interactions, d’accommodements et d’appropriations, repose sur une solidarité des élites coloniales et autochtones.
– BLANCHARD Emmanuel, DELUERMOZ Quentin, GLASMAN Joël, « La professionnalisation policière en situation coloniale : détour conceptuel et explorations historiographiques », Crime, histoire et sociétés, 2011, vol. 15, n°2, p.33-54 :
L’historiographie des polices européennes et d’Amérique du Nord aux XIXe et XXe siècles a beaucoup mis l’accent sur un mouvement de spécialisation et de professionnalisation favorisant la contention de la violence des forces de l’ordre. Ces évolutions furent concomitantes de l’émergence de polices coloniales. Dans ces espaces dominés, le caractère hybride des forces civiles et militaires est resté plus prégnant que dans les métropoles impériales. Surtout, les connections entre ces espaces se sont traduites par des circulations de pratiques, d’acteurs et de référentiels. Ainsi, l’étude du format des forces armées, de l’usage de formes létales de violence, de l’articulation entre unités nouvelles et vernaculaires ou des relations entre populations et agents en situation coloniale invite à nuancer le topos d’une professionnalisation policière vectrice d’une civilisation du maintien de l’ordre.
– DENIS Vincent, DENYS Catherine, Polices et empires coloniaux, XVIIIe-XXe siècles, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2012 :
Les policiers furent les figures les plus visibles et les plus symboliques de la domination coloniale dont ils formaient le premier maillon. Au contact quotidien des populations, chargés des tâches les plus diverses, sous des dénominations très variables, ils jouaient cependant pleinement leur rôle dans la « mission civilisatrice de l’homme blanc ». Cet ouvrage entend montrer quelle fut leur contribution à l’émergence d’un nouveau mode de gestion colonial des populations, des années 1750 à la veille de la Grande Guerre. De Buenos Aires à Sydney, en passant par Rio, Montréal, Bombay, Le Cap ou Batavia, du Suriname aux Indes néerlandaises, les contributions réunies ici retracent l’histoire des forces de l’ordre des empires coloniaux européens, l’intense circulation des pratiques, des conceptions policières et des hommes au sein des empires. Loin d’être la projection des structures des polices métropolitaines, les polices des territoires coloniaux ont été des terrains d’expérimentation, sans cesse adaptés aux contraintes matérielles et politiques des sociétés locales. À bien des égards, les colonies furent le laboratoire de la modernité policière, présentée comme une innovation des métropoles du XIXe siècle. Fruit d’une enquête collective, rassemblant douze études inédites de spécialistes internationaux, cet ouvrage se veut une contribution à l’histoire de l’État et des empires coloniaux, ainsi qu’à celle des polices.
– BAT Jean-Pierre, COURTIN Nicolas, Maintenir l’ordre colonial. Afrique et Madagascar, XIXe-XXe siècles, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2012 :
Polices, justices, armées, renseignements, prisons : chaque dispositif concourt à maintenir l’ordre colonial. L’histoire de l’ordre en situation coloniale ne saurait ainsi être séparée de l’histoire de son maintien tout comme l’histoire de la police de celle de l’armée, de la violence extrême, du droit, de la justice et de la prison. L’étude du maintien de l’ordre dans les colonies contribue d’une part à la mise en perspective du maintien de l’ordre en métropole et d’autre part à la clarification du legs colonial de l’Afrique contemporaine en matière d’ordre. Basée sur des sources inédites dépouillées par de jeunes historiens, cette recherche novatrice suit l’émergence et les évolutions des formes du colonial policing dans les colonies d’Afrique et de Madagascar aux XIXe et XXe siècles, ainsi que l’emploi de méthodes et de techniques sophistiquées de contre-insurrection ou de renseignement. De Madagascar au Soudan britannique, du Cameroun à la Mauritanie, en passant par le Dahomey et la Haute-Volta, ce premier ouvrage du Groupe d’études sur les mondes policiers en Afrique (GEMPA) fait ainsi vivre des corps inconnus ou très mal connus – tels que les méharistes, les gardes indigènes ou les premiers policiers en uniforme. Il éclaire le rôle largement ignoré de services de police et de renseignement – tels que le service spécial des affaires musulmanes et des informations islamiques (SSAMII), le service de sécurité extérieure de la Communauté (SSEC) ou le service de coopération technique internationale de police (SCTIP). Il offre enfin une histoire à hauteur d’hommes, donnant chair et réalité à des figures étonnantes et inattendues de policiers aux parcours singuliers, comme Hubert Kho, l’inspecteur Georges Conan, le commissaire Artine Hamalian ou les frères Xavier et Achille Béraud.
Empire hétérogène : Jane Burbank et Frederick Cooper définissent les empires comme de « vastes unités politiques, expansionnistes ou conservant le souvenir d’un pouvoir étendu dans l’espace » qui maintiennent la distinction et la hiérarchie à mesure qu’elles incorporent de nouvelles populations. Expansion territoriale et incorporation politique sont donc associées à une « politique de la différence » qui joue à plusieurs échelles, par le maintien de distinctions entre centre et périphéries, entre les peuples incorporés – différemment administrés – et, enfin, au sein de chacun des territoires de l’empire, entre diverses catégories de sujets. Tout empire a besoin, pour administrer ses territoires, de pouvoir s’appuyer localement sur des alliés ou des relais et distingue à cet effet, des groupes ou des individus susceptibles de jouer le rôle d’intermédiaires. L’empire est ainsi une formation politique en perpétuelle tension, qui loin d’imposer une domination absolue de façon homogène sur toute l’étendue de son immense territoriale, relève d’une forme de « bricolage » administratif qui recèle des failles, des discontinuités, des contradictions.
Les fondements historiographiques des études coloniales :
• Une histoire sociale qui dans la lignée des Subaltern Studies indiennes, s’attache au point de vue des acteurs les plus modestes des sociétés coloniales et met en évidence les limites de la domination qu’ils subissent en montrant leur capacité à agir de façon autonome.
• Une histoire culturelle fondée sur les apports critiques des Postcolonial Studies, plutôt portée sur l’analyse et la « déconstruction » des discours coloniaux et des critères discriminants qu’ils mobilisent (race, genre, culture).
• Une histoire à la fois sociale et culturelle qui réactive la notion de « situation coloniale », forgée par le sociologue et anthropologue français Georges Balandier, pour s’interroger sur la nature des sociétés coloniales, entre dualisme et pluralisme, hétérogénéité et hybridité.
– BALANDIER Georges, « La situation coloniale : approche théorique », Cahiers internationaux de sociologie, vol. 11, 1951, p.44-79 :
« La notion de situation coloniale », article publié d’abord en 1951 dans les Cahiers internationaux de sociologie puis repris en 1955 et dans les éditions ultérieures de Sociologie actuelle de l’Afrique noire est aujourd’hui très connu. La formule est communément utilisée sans qu’on sache toujours ce qu’elle recouvre. L’enjeu de cette contribution est de revenir sur l’approche socio-historique proposée en son temps par le jeune Balandier, sous l’angle d’une lecture historienne prenant en compte l’étude des contextes coloniaux et leurs effets d’héritage.
Les Subaltern Studies : prônent une histoire « par le bas » (history from below) et s’inscrivent dans un contexte politique particulier, où les désillusions liées à l’échec social de l’indépendance se faisaient de plus en plus visibles en Inde, poussant la jeunesse intellectuelle vers la radicalisation […]. Remettre en cause les visions élitistes jusqu’alors dominantes dans l’historiographie. Résistance populaire à la colonisation : participation des paysans et des ouvriers au mouvement de lutte pour l’indépendance nationale. « Rétablir le peuple » comme sujet de sa propre histoire et en finir avec les interprétations qui le considéraient comme un agent passif pour reconnaître sa libre capacité d’initiative. Ainsi, « subaltern » est le résultat du processus de domination subi. Notion d’agency pouvant être mobilisée dans les luttes sociales contemporaines. Fin des années 1980 : travail de déconstruction du discours des élites – dans un contexte intellectuel où l’influence du postmodernisme et des travaux d’Edward Said devenait de plus en plus prégnante. Déplacement du champ d’analyse de l’économie et du social vers le champ culturel. Le courant subalterniste abandonne son projet fondateur d’histoire sociale, passant de l’étude du rapport entre élites et subalternes à celle du rapport entre modernité occidentale et culture autochtone. Mais certaines critiques persistent : s’enfermer dans une problématique du discours et de la représentation, renoncer à analyser la réalité des formes de domination ou d’oppression produites par le colonialisme.
– SAID Edward, L’Orientalisme. L’Orient créé par l’Occident, Paris, Seuil, 1978 :
« L’Orient » est une création de l’Occident, son double, son contraire, l’incarnation de ses craintes et de son sentiment de supériorité tout à la fois, la chair d’un corps dont il ne voudrait être que l’esprit. À étudier l’orientalisme, présent en politique et en littérature, dans les récits de voyage et dans la science, on apprend donc peu de choses sur l’Orient, et beaucoup sur l’Occident. C’est de ce discours qu’on trouvera ici la magistrale archéologie.
Apports et limites des Postcolonial Studies : les études postcoloniales envisagent les productions culturelles des sociétés impérialistes (discours, images, représentations) comme parties prenantes du processus de domination coloniale, assujettissement à travers l’orientalisme par exemple. Mise en question de la capacité des travaux scientifiques à rendre compte du point de vue des dominés. Place des marginaux et des « sans voix » avec en plus, la question de l’intersectionnalité. Distinguer racisme scientifique et processus de racialisation (réduction de l’identité d’un individu à la couleur de sa peau, par une assignation extérieure émanant du pouvoir colonial, processus interne d’aliénation). Question du genre : levier essentiel pour comprendre les sociétés coloniales (histoire des représentations, nouveaux modèles de masculinité et de domesticité en métropole en relation avec l’idée d’une masculinité impériale) ; mise en évidence d’un féminisme colonial. Le corps, la sexualité, l’intime sont devenus des objets privilégiés des Colonial Studies. En France : l’historiographie africaniste a d’abord adopté la perspective de l’histoire des femmes avant de prendre le tournant sur les études du genre.
De la « situation coloniale » aux sociétés coloniales : René Maunier définit ainsi la colonisation comme « un contact entre des races différentes placées en situation d’avoir cohabiter plus ou moins facilement ». Discours sur le colonialisme d’Aimé Césaire : absence de contact entre des groupes culturellement hétérogènes dont les membres sont assignés à des rôles antagonistes. Mise en lumière de la relation coloniale, relation entre colonisateur et colonisé (la fabrique des colonisateurs et des colonisés) par Albert Memmi. Par ailleurs, Georges Balandier montre comment la colonisation distingue et hiérarchise les groupes selon des critères culturels et raciaux et oppose en dernier ressort une « majorité numérique » qui se trouve placée en situation de « minorité sociologique ». En effet, la société autochtone dominée devient une société colonisée. La société colonisée est traversée de divisions ethniques, religieuses, sociales, générationnelles – certains d’entre elle ayant été apportées ou accentuées par la colonisation. Tandis que la société coloniale connaît des tensions entre administratifs, privés, militaires et missionnaires : un système social qui fonctionne comme des clans.
– CÉSAIRE Aimé, Discours sur le colonialisme, Paris, Présence africaine, 1955 :
Comme naguère Jean-Jacques Rousseau dénonçait le scandale d’une société fondée sur l’inégalité, avec la même clarté, et un bonheur d’écriture que seule peut inspirer la passion du juste, Aimé Césaire prend ses distance par rapport au monde occidental et le juge. Ce discours est un acte d’accusation et de libération. Sont assignés quelques ténors de la civilisation blanche et de son idéologie mystifiante, l’Humanisme formel et froid. En pleine lumière sont exposées d’horribles réalités : la barbarie du colonisateur et le malheur du colonisé, le fait même de la colonisation qui n’est qu’une machine exploiteuse d’hommes et déshumanisante, une machine à détruire des civilisations qui étaient belles, dignes et fraternelles. C’est la première fois qu’avec cette force est proclamée, face à l’Occident, la valeur des cultures nègres. Mais la violence de la pureté du cri sont à la mesure d’une grande exigence, ce texte chaud, à chaque instant, témoigne du souci des hommes, d’une authentique universalité humaine. Il s’inscrit dans la lignée de ces textes majeurs qui ne cessent de réveiller en chacun de nous la générosité de la lucidité révolutionnaires. Le Discours sur le colonialisme est suivi du Discours sur la Négritude, qu’Aimé Césaire a prononcé à l’Université Internationale de Floride (Miami), en 1987.
– MEMMI Albert, Portrait du colonisé précédé du Portrait du colonisateur, Paris, Buchet-Chastel, 1957 :
» J’ai entrepris cet inventaire de la condition du colonisé d’abord pour me comprendre moi-même et identifier ma place au milieu des autres hommes Ce que j’avais décrit était le lot d’une multitude d’hommes à travers le monde. Je découvrais du même coup, en somme, que tous les colonisés se ressemblaient ; je devais constater par la suite que tous les opprimés se ressemblaient en quelque mesure. » Et Sartre d’écrire : » Cet ouvrage sobre et clair se range parmi « les géométries passionnées » : son objectivité calme, c’est de la souffrance et de la colère dépassée. » Cet essai est devenu un classique, dès sa parution en 1957 : il soulignait combien les conduites du colonisateur et du colonisé créent une relation fondamentale qui les conditionne l’un et l’autre.
Au-delà du dualisme : l’entre-deux, le contact et ses limites : mettre en évidence les zones grises de l’entre deux, tout en complexifiant la description des relations entre groupes et entre individus au sein d’une société coloniale globale. Importance du métissage. Rôle des intermédiaires coloniaux et des élites cooptées. Il s’agit de caractériser l’interaction telle qu’elle se produit de part et d’autre. En effet, si les situations sociales en contexte colonial sont largement déterminées par la relation coloniale, elles ne le sont pas toutes. Attention portée au hors-champ de la situation coloniale peut ainsi révéler des formes de résilience des sociétés autochtones (capacité à maintenir et à préserver les normes qui règlent les conduites de leurs membres). Fait colonial : ensemble de situations vécues.
Histoire impériale versus histoire coloniale : rompre avec une ancienne histoire coloniale française très centrée sur la métropole conçue comme centre de décision, pour déplacer la focale vers les sociétés et les situations coloniales. Aujourd’hui : réévaluation de l’intérêt de l’échelle impériale comme cadre d’analyse.
La « nouvelle histoire impériale » : mettre en évidence des phénomènes de construction des empires et des nations (définition des catégories de la citoyenneté, connecter l’histoire de la métropole et celle de l’empire en montrant comment dialoguent les manières de poser ces questions entre colonies et métropoles). Renversement de la perspective de l’histoire impériale classique : ce n’est plus un État métropolitain européen qui crée son empire par la conquête et la domination, mais c’est l’empire qui forge la nation. Cette historiographie à l’échelle des empires a aussi permis de mettre en évidence des phénomènes de circulation intra-impériale (circulation des élites) ; ou transimpériale (migrations de travail entre empires). L’indigénat (dispositif central de la domination impériale française) a été récemment étudié au prisme des circulations impériales, entre Algérie, Indochine, Afrique subsaharienne et Nouvelle-Calédonie. Histoire des savoirs dit coloniaux : relation métropole/colonies. Notion d’ethnie fit l’objet d’investigations approfondies, tendant à la présenter comme une construction coloniale. Ces savoirs étaient étudiés – non seulement comme des discours produits en métropole, mais aussi à travers les pratiques de collecte sur le terrain africain – ainsi que dans leurs implications en retour sur les espaces coloniaux.
Un postcolonialisme à la française ? : Pascal Blanchard (représentant du postcolonialisme en France), reprend aux études postcoloniales le projet de déconstruire les discours et les représentations coloniales, sans les enfermer dans un passé révolu. Question de la propagande coloniale (l’imprégnation, la fixation et l’apogée) pour former la nation au colonial. Formes de propagande impériale : instrument de manipulation de l’opinion, diffusion de l’impérialisme dans la culture populaire. Etudes sur la fabrique des héros impériaux (Brazza, Marchand ou Lyautey) dans le façonnement d’une adhésion populaire à l’empire. Mais des critiques sur l’empire persistent : zoos humains, désignant les exhibitions anthropologiques lorsqu’elles ont lieu dans de véritables zoos, tout spectacle mettant en scène des individus ou des groupes présentés au public européen en raison de leurs caractéristiques « exotiques » (humiliation, violence). Vouloir restituer aux dominés leur dignité d’acteurs.
– BLANCHARD Pascal, BANCEL Nicolas, LEMAIRE Sandrine (dir.), Culture post-coloniale. Traces et mémoires coloniales en France, 1961-2006, Paris, Autrement, 2006 :
Plus de cinquante ans après le début de la guerre d’Algérie et la défaite indochinoise, la France redécouvre son passé colonial. Néanmoins, il lui reste à découvrir qu’elle est aussi une société postcoloniale, que la colonisation a « fait retour » en métropole et a marqué des champs de la culture, de la politique et les débats sur les mutations contemporaines de la société française. Ainsi, au cours des dernières décennies, bien des phénomènes demeurent liés à la période coloniale et à ses héritages : la coopération s’est installée, la francophonie a émergé, les immigrations postcoloniales se sont poursuivies, le débat sur l’esclavage est réapparu, la concurrence des mémoires s’est envenimée, les représentations du monde et de l’Autre se sont vu liées au « temps des colonies », la littérature s’est abreuvée d’influences et d’auteurs issus des ex-colonies, le « tourisme ethnique » est devenu un produit de consommation courante… Tout cela forme notre culture postcoloniale contemporaine, faite d’héritages métissés, recomposés, qu’il s’agit d’interroger dans la longue durée. Le surgissement de mémoires coloniales concurrentes, les rebondissements législatifs de février 2005 liés au rôle supposé « positif de la colonisation », le discours de Dakar, la crise de l’immigration (2005-2010), la montée du Front national et des discours d’exclusion (2007-2011) nous obligent à considérer dans toutes ses dimensions la question postcoloniale.