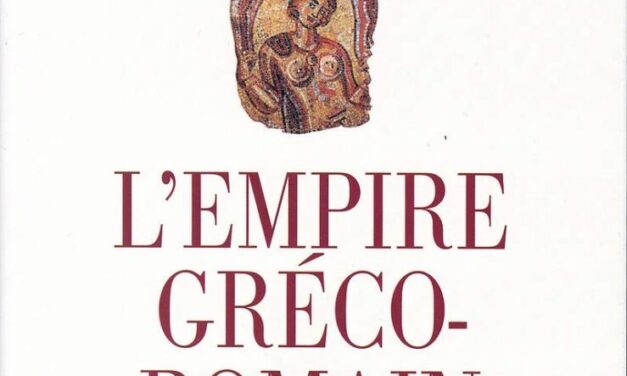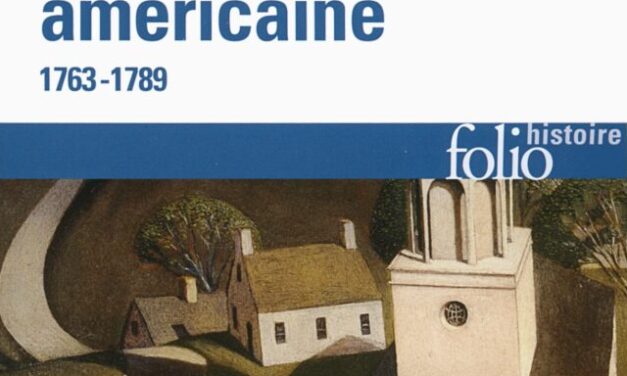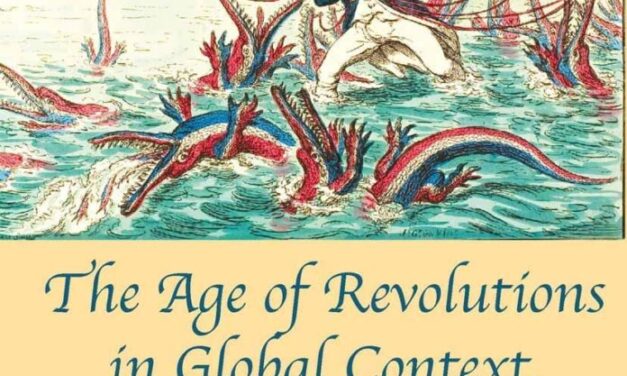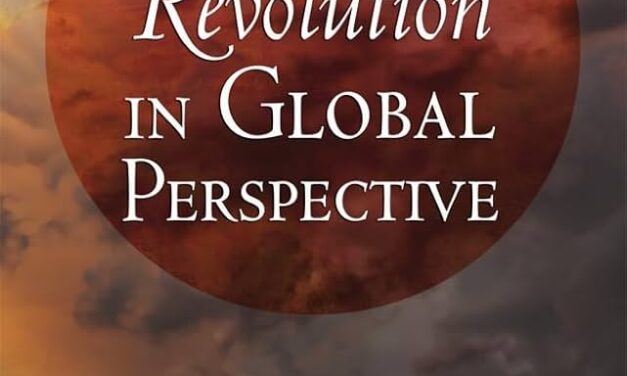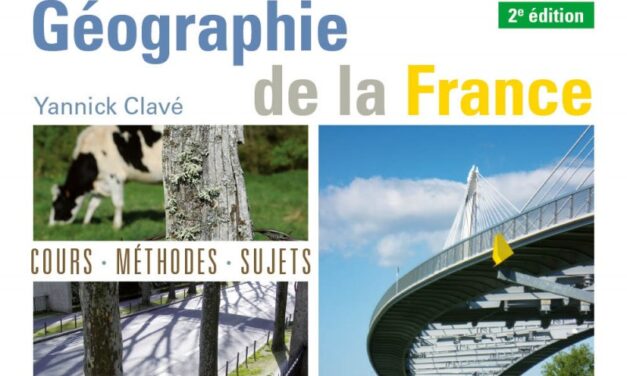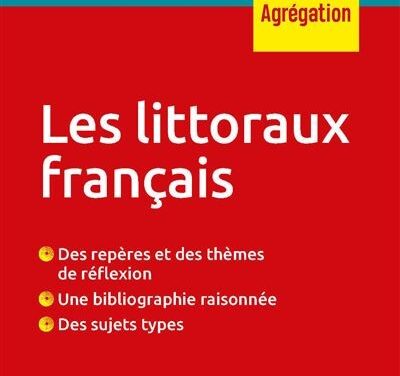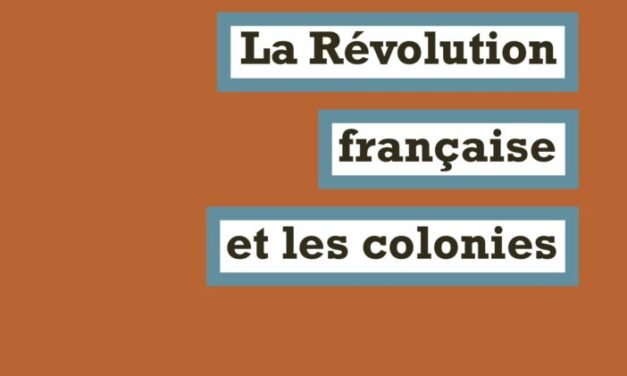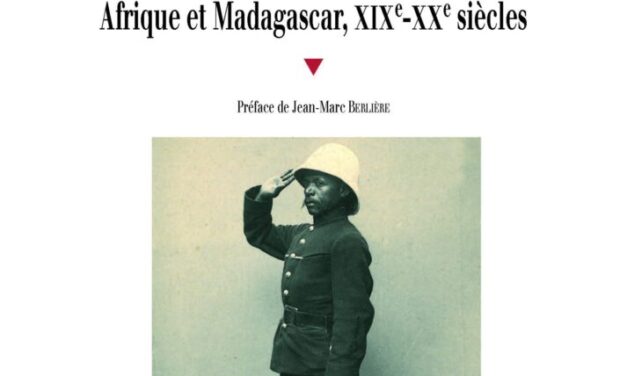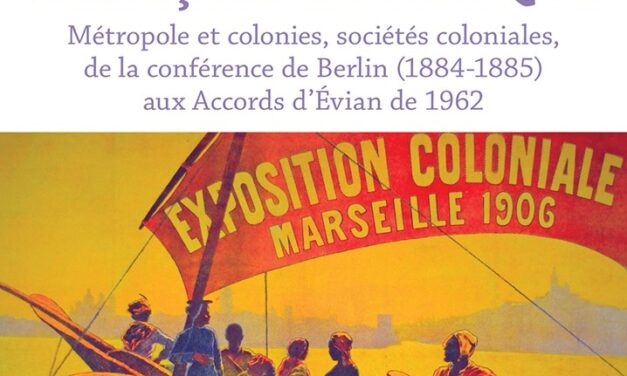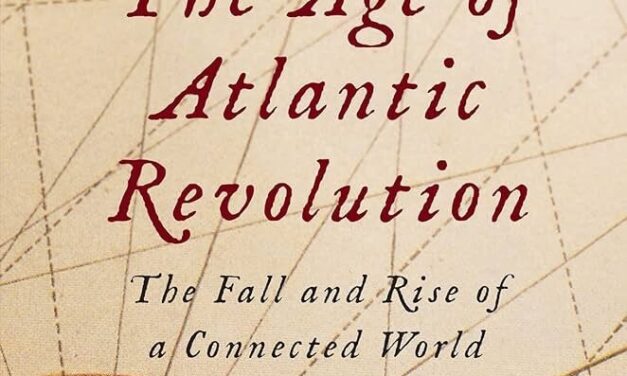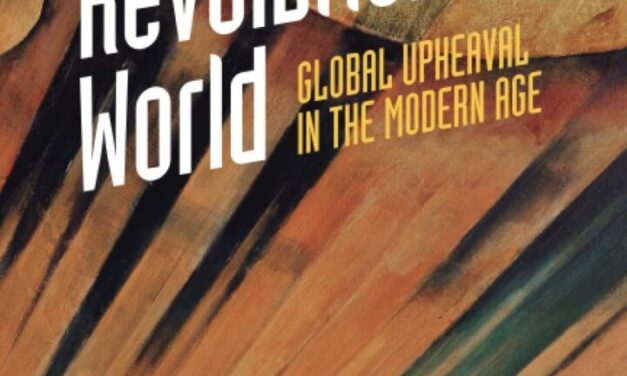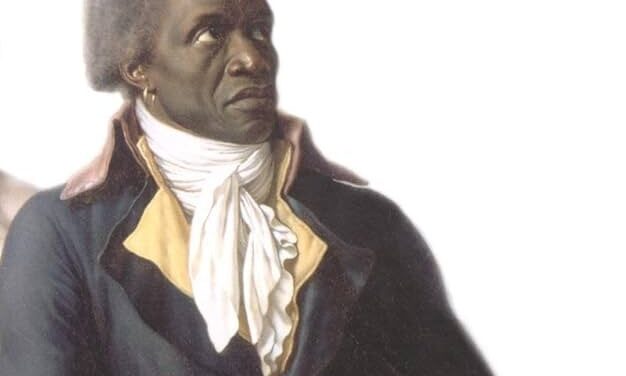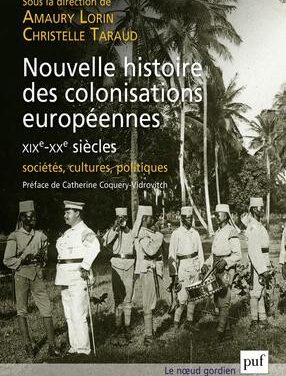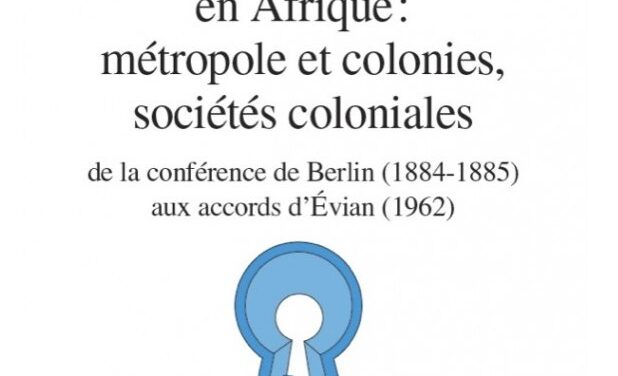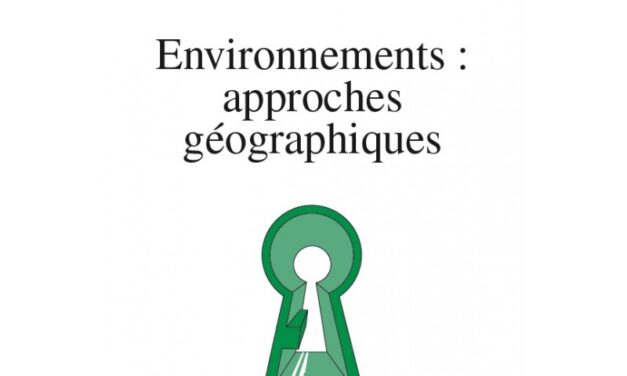Préparation au concours du CAPES et Agrégation
Capes et Agrégation en Histoire et Géographie
Le CAPES et l'agrégation en histoire et en géographie se déclinent en différentes catégories. Externes et internes, pour les agrégations comme pour le CAPES.
Les question au programme se recoupent souvent, l'agrégation d'histoire comporte par exemple quatre questions d'histoire et de de géographie, c'est le contraire pour l'agrégation de géographie. Pour le CAPES d'histoire-géographie, il y a deux questions dans chacune des matières, soit un total de quatre.
Les concours internes sont accessibles après une certaine durée d'ancienneté dans l'exercice du métier. Les concours externes de l'agrégation d'histoire, de l'agrégation de géographie, du CAPES d'histoire géographie, sont accessibles aux étudiants au niveau du Master.
Les ressources disponibles sur Clio Prépas sont réalisées par les candidats sur la base d'un cahier des charges précis, avec une relecture validation assurée par les référents, professeurs en activité, lauréats des concours, membres des jurys et préparateurs de ces mêmes concours. Au-delà des manuels de base sur chacune des questions, la rédaction de Clio Prépas s'attache à fournir une variété de supports, non disponibles en accès ouverts, pour apporter une plus-value aux préparants.
L’empire gréco-romain
Cette fiche porte sur le chapitre 12 de l’ouvrage de Paul Veyne. Il s’institule « La prise de Rome en 410 et les Grandes Invasions”. Le chapitre porte sur la fin de l’empire romain d’Occident. La fiche est augmentée par d’autres lectures qui permettent de compléter le chapitre.
Lire …La Révolution américaine (1763-1789)
Flora Meneï | 8 Déc 2025 | L’âge des révolutions (années 1770-1804) - France, États-Unis, Saint-Domingue, Irlande, Pays-Bas autrichiens et Provinces-Unies
Cette fiche de lecture se concentre sur les dates permettant de parcourir et de faire le point sur la révolution américaine ainsi que celles pouvant servir d’exemple dans une copie d’agrégation. Elle est accompagnée de plusieurs citations de l’ouvrage, puis d’une synthèse du chapitre 10 qui regroupent les publications qui ont tenté de comprendre le sens profond de la révolution américaine, un point historiographique et le portrait de trois pères fondateurs : Washington, Jefferson et Franklin.
Lire …The age of revolutions in global context, c1760-1840
Mickaël Lauquin | 3 Déc 2025 | L’âge des révolutions (années 1770-1804) - France, États-Unis, Saint-Domingue, Irlande, Pays-Bas autrichiens et Provinces-Unies
Un ouvrage majeur pour la préparation de la question d’agrégation. Les auteurs montrent que l’ère des révolutions ne peut être comprise qu’en faisant une histoire connectée. Les différents articles fichés ici sont souvent cités dans les travaux d’historiens comme des références. Leurs auteurs et leur contenu doivent être connus et utilisés dans une dissertation.
Lire …The French Revolution in Global Perspective
Mickaël Lauquin | 2 Déc 2025 | Les révolutions dans l'espace atlantique : Amérique, France, Saint-Domingue (1775-1804)
Cette fiche propose une synthèse de l’introduction de l’ouvrage. Le grand intérêt de l’approche est que chaque auteur s’efforce de replacer la Révolution française dans une dimensions globale ou mondiale: les événements qui ont marqué la France ont autant inspiré le reste du monde (colonial, le plus souvent) qu’ils ont été inspirés en retour par ce qui se produisait dans le reste du monde.
La Révolution française n’est donc pas traitée comme un événement « franco-français », mais comme un moment « connecté ». L’approche va plus loin que « l’âge des révolutions »: les auteurs insèrent la Révolution dans la longue histoire de l’espace atlantique d’une part, et dans le moment de la crise impériale mondiale de la fin du XVIIIe siècle d’autre part.
Cette introduction se poursuit avec un résumé de chacun des chapitres du livre.
Lire …Tourisme et loisirs : pratiques, territoires, nouveaux enjeux
Thibaut BAQUE | 2 Déc 2025 | Géographie de la France
Fiche de lecture du chapitre 9 de l’ouvrage de Yannick Clavé, sur les pratiques du tourisme en France.
Lire …Les littoraux français
Adam Garnell | 16 Nov 2025 | Les littoraux
Chiffres-clés : 5500 km de littoraux en France, 6,16 millions d’habitants résident dans les...
Lire …La Révolution française et les colonies
Louise Pinilla | 10 Nov 2025 | L’âge des révolutions (années 1770-1804) - France, États-Unis, Saint-Domingue, Irlande, Pays-Bas autrichiens et Provinces-Unies
Cette fiche apporte un résumé très précis de l’histoire révolutionnaire qui frape les colonies de l’empire français dans les Antilles. C’est le lien entre révolution et colonies, entre l’Assemblée nationale à Paris et les zones de révolte dans les territoires serviles, qui est développé ici.
Lire …Maintenir l’ordre colonial. Afrique et Madagascar, XIXe-XXe siècles
Wanda Oiry-Lecoutre | 10 Nov 2025 | L'empire colonial français en Afrique: métropoles et colonies, sociétés coloniales 1884-1962
Cette fiche porte sur un thème longtemps négligé : le maintien de l’ordre colonial. Au cours des années 2010, un renouveau s’est fait autour des questions d’ordre et de police, en particulier en situation coloniale. Les auteurs soulignent l’omniprésence de cette question dans le fonctionnement quotidien de l’Etat colonial. Une riche introduction programmatique et historiographique. Une étude précise de la police et de l’Etat à Madagascar. La deuxième partie dresse une série de portraits de policiers coloniaux.
Lire …L’Empire colonial français en Afrique : métropole et colonies, sociétés coloniales, de la conférence de Berlin (1884-1885) aux Accords d’Évian de 1962: la France, les Français, les Algériens et la guerre d’Algérie 1954-1962
Nathalie Biyard | 10 Nov 2025 | L'empire colonial français en Afrique: métropoles et colonies, sociétés coloniales 1884-1962
Cette fiche de lecture concerne le chapitre 3 du manuel de préparation au concours de l’agrégation. Le chapitre est rédigé par Yannick Clavé. Il porte sur la guerre d’Algérie (1954-1962).
Lire …The age of Atlantic Revolution. The Fall and Rise of a Connected World
Mickaël Lauquin | 27 Oct 2025 | L’âge des révolutions (années 1770-1804) - France, États-Unis, Saint-Domingue, Irlande, Pays-Bas autrichiens et Provinces-Unies
La philosophie de l’ouvrage, écrit par un spécialiste de l’Atlantic History, correspond parfaitement à l’esprit de la question d’agrégation interne. L’ouvrage montre parfaitement les liens, les connexions et les interdépendances qui tissent la toile du monde atlantique à partir du premier Traité de Paris qui met fin à la fin de la Guerre de Sept Ans (1756-1763). Les exemples abordés traitent de tous les endroits évoqués par la lettre de cadrage (l’auteur insiste aussi sur l’Amérique latine et le Proche-Orient, deux régions du monde qui sont négligées dans cette fiche puisqu’elle ne fait pas partie du sujet d’agrégation) : Amérique du Nord, Caraïbes (Saint-Domingue + Cuba), Irlande, France, Grande-Bretagne, Républiques sœurs de la République française… Patrick Griffin montre en particulier que l’Age des révolutions est marqué par 3 émotions majeures, qu’il traite successivement en 3 chapitres, mais qui sont inséparables : l’espoir d’un monde nouveau, la peur d’une destruction de l’ordre, la diffusion de la guerre comme moyen de ramener la stabilité. La fiche est donc très complète et elle offre aux candidats un aperçu complet de ce qui doit être maîtrisé pour la dissertation d’histoire.
Lire …Revolutionary World. Global Upheaval in the Modern Age
Mickaël Lauquin | 27 Oct 2025 | L’âge des révolutions (années 1770-1804) - France, États-Unis, Saint-Domingue, Irlande, Pays-Bas autrichiens et Provinces-Unies
Cet ouvrage collectif dirigé par David Motadel montre que tout au long de l’ère moderne, des révolutions simultanées se sont propagées à travers les frontières des Etats, engloutissant des régions entières, des continents et, parfois, le globe. Les auteurs examinent la propagation des soulèvements au cours des grands moments révolutionnaires de l’histoire moderne. Les chapitres explorent la nature de ces vagues révolutionnaires, retraçant l’échange d’idées radicales et les mouvements des révolutionnaires à travers le monde. Ici ne sont traités que l’introduction et le chapitre 1. Les autres chapitres portent sur des Révolutions globales postérieures à la question de l’agrégation interne, telles que le Printemps des Peuples de 1848, les Communes de 1871, les révolutions bolchéviks de 1917, la révolution islamique, l’anticommunisme de 1989 ou encore les Printemps Arabes de 2011.
Lire …Atlantic History, Révolution américaine
Mickaël Lauquin | 27 Oct 2025 | L’âge des révolutions (années 1770-1804) - France, États-Unis, Saint-Domingue, Irlande, Pays-Bas autrichiens et Provinces-Unies
Mémoire d’HDR de Marc Bélissa portant sur la révolution américaine intégrée à l’Atlantic History et à l’étude d’un trickster: La Fayette.
Lire …La Révolution aux Antilles françaises
Nicolas ROSE | 27 Oct 2025 | L’âge des révolutions (années 1770-1804) - France, États-Unis, Saint-Domingue, Irlande, Pays-Bas autrichiens et Provinces-Unies
Cette fiche de l’ouvrage de Paul Butel (professeur émérite d’histoire moderne à Bordeaux et spécialiste des circulations transatlantiques, de la société bordelaise au XVIIIème siècle et du premier empire colonial français) porte sur le développement des idées révolutionnaires, émancipatrices et de la Révolution aux Antilles françaises. Pour Paul Butel, il est important d’écrire une histoire des Antilles en convoquant tous les acteurs de ces sociétés coloniale.
Lire …Nouvelle histoire des colonisations européennes (XIXe-XXe siècles)
pauline pattein | 21 Oct 2025 | L'empire colonial français en Afrique: métropoles et colonies, sociétés coloniales 1884-1962
Cette fiche de lecture porte sur l’introduction de l’ouvrage ainsi que sur des chapitres essentiels sur les colonisations, pour la préparation de la question d’agrégation : chapitres 1, 2, 6, 10, 12.
Lire …Les formes de la domination impériale en Afrique au XIXe et au XXe siècle
Gerard Besse Miquelarena | 16 Oct 2025 | L'empire colonial français en Afrique: métropoles et colonies, sociétés coloniales 1884-1962
Fiche de lecture d’un des chapitres des « Thèmes » du manuel Atlande sur la question d’agrégation interne portant sur l’empire colonial français en Afrique des conquêtes aux indépendances.
Lire …Environnements : approches géographiques
laurent busson | 24 Sep 2025 | Environnements: géographies
Cette longue fiche du manuel Atlande fournit un complément utile et des exemples mondiaux sur la question de l’environnement.
Lire …L’Anthropocène
laurent busson | 24 Sep 2025 | Environnements: géographies
Cette fiche de lecture porte sur le numéro de la Document Photographique à propos de l’ère de l’Anthropocène. Elle évoque des sujets qui parleront aux connaissances de la géographie, de l’histoire et de la sociologie de l’environnement: l’Anthropocène, les limites planétaires, les perturbations globales, la transition écologique et énergétique, ou encore les risques d’effondrement de la biodiversité (en particulier marine et sous-marine).
Lire …Fiche méthode de la préparation des oraux de l’agrégation interne d’histoire- géographie
Mickaël Lauquin | 24 Sep 2025 | Méthodologie, Préparation au concours du CAPES et Agrégation
Cette fiche méthode pose clairement au propre les exigences de rigueur pour la préparation des oraux de l’agrégation.
Lire …Fiche méthode de la dissertation d’histoire à l’agrégation interne d’histoire-géographie
Mickaël Lauquin | 24 Sep 2025 | Méthodologie, Préparation au concours du CAPES et Agrégation
Cette fiche pose clairement au propre les exigences de rigueur pour la méthode de la dissertation d’histoire à l’agrégation.
Lire …La mer dans le monde romain (introduction d’une dissertation)
Mickaël Lauquin | 24 Sep 2025 | Méthodologie, Préparation au concours du CAPES et Agrégation
Un exemple d’introduction schématisée au brouillon puis rédigée au propre, sur le sujet La mer dans le monde romain. Cette fiche met en lumière la manière dont les différents éléments d’une introduction d’agrégation (interne ou externe) doivent s’enchaîner avec logique pour présenter au correcteur tous les intérêts et tous les enjeux du sujet donné.
Lire …SOUTENEZ LES CLIONAUTES
PRIX CINEMA DES ENSEIGNANTS 2026
Votez pour le film offrant selon vous le meilleur potentiel pédagogique
Les Clionautes s’associent à ce concours avec nos partenaires de Parenthèse Cinéma